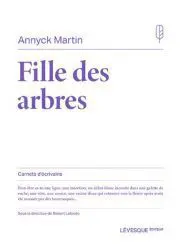Cette Fille des arbres n’a rien de strictement bucolique. Elle nous convie plutôt à une exploration du mystère de vivre et autres plongées en soi.
La nature, la nôtre et celle qui nous entoure, les mondes végétal et minéral, l’eau des lacs et des ruisseaux, retiennent ici l’attention du lecteur, dans les fragments que livre Ann May, celle à travers qui Annyck Martin accède à une dimension d’elle-même qui trouve malaisément sa place « au sein des regroupements humains ». Si j’ai bien compris ou si ce que je fabrique a du sens, Ann May recompose Annyck Martin qui, adulte, se découvre autiste Asperger, et d’une intelligence supérieure à la moyenne, lui dit-on, intelligence qui ne lui est cependant pas d’un absolu secours. Qu’est-ce que le diagnostic clinique vient faire ici, est-on tenté de se demander ? Encore une fois, ce qui n’est peut-être qu’un rapport différent à l’existence se voit étiqueté, médicalisé et compris comme « maladie ». Si on ne fonctionne pas comme tout le monde, on doit donc avoir une maladie. « J’ai passé une grande partie de ma vie dans l’incompréhension de qui je suis, de comment je fonctionne », écrit l’auteure. Bienvenue dans le club, suis-je tenté d’ironiser.
Annyck le soupçonnait peut-être : la traversée sereine de la vie n’est pas qu’affaire d’intelligence. Surtout pas. Ann le lui confirme. Tantôt au je, tantôt au elle, les fragments qui forment cette Fille des arbres alternent selon une perspective qu’une lecture unique ne permet pas de saisir. Ce qui ne change rien à la cohérence du propos, tant Ann et Annyck sont indivises et interchangeables. Elles le sont autant qu’un livre, qui est fait à la fois de mots et d’arbre, si je puis dire.
Toutes différences mises de côté (leurs projets respectifs, leurs origines familiales, leurs parcours), Martin me rappelle encore vaguement la Alexie Morin d’Ouvrir son cœur : « J’ai par exemple passé près de vingt ans dans le même village sans arriver à créer de contacts signifiants », écrit Martin. Angoisses voisines ou méfiances similaires devant l’Autre. Ann ou Annyck est « une solitaire, limite sauvage », spontanément plus près des arbres et de la nature que de ses (dis)semblables, les êtres humains. « Il m’arrivait de figer, de ne rien répondre lorsque des étrangers s’adressaient à moi. » Son attitude suggère que la vie est un combat entre le monde et soi, un combat au cours duquel l’écriture peut s’avérer notre alliée. L’écriture et la photographie, car Martin pratique aussi la photo, et quelques-unes de ses œuvres accompagnent le carnet, en prolongent le sens et illustrent certaines des fascinations et des propositions de l’auteure.
Ann May, l’utilisation de ce pseudonyme m’a rappelé la Tina de Marité Villeneuve (voir son récit Mon frère Paul), Villeneuve que cite d’ailleurs Martin ; Ann May est un alter ego qui facilite la prise d’une parole autrement douloureuse ou dont la singularité effraie peut-être celle qui tient le stylo.
Plusieurs des fragments qui forment ce carnet touchent de très près l’essai ; certains relèvent de la stricte prose poétique ; d’autres, enfin, composent un récit autobiographique en bonne et due forme. Le lecteur passe des uns aux autres dans une forêt aux essences diverses.
Ce carnet est le onzième de la collection des Carnets d’écrivains que dirige Robert Lalonde.