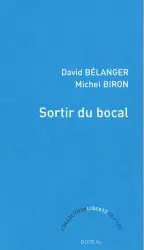Né en 1989, David Bélanger est chargé de cours en littérature à l’Université du Québec à Montréal. Michel Biron fait quant à lui partie de la génération X et enseigne depuis plusieurs années à l’Université McGill. Deux interlocuteurs, deux générations, un même sujet : au cours d’un été paralysé par la pandémie de coronavirus, les épistoliers prennent la plume pour briser la solitude et discuter de littérature québécoise, tous deux libérés un temps des contraintes formelles d’ordinaire imposées par la réflexion savante, universitaire.
Avant Sortir du bocal, la formule du dialogue a favorisé des réflexions fécondes sur la littérature. Pensons à La littérature et le reste de Gilles Marcotte et André Brochu, que Biron mentionne d’ailleurs d’entrée de jeu. La rigueur du raisonnement, cet exemple le confirme, y est donc tout sauf accessoire. Seulement, Bélanger et Biron le montrent bien, le genre offre en prime une souplesse salutaire en ouvrant grand la porte aux digressions et volte-face. Il favorise, autrement dit, la pensée sinueuse, brute et incertaine.
Une question traverse néanmoins Sortir du bocal, comme une piste de cailloux blancs semée au travers d’un bois touffu. C’est celle de l’ironie littéraire et de ses fonctions. D’hier à aujourd’hui, du Survenant de Germaine Guèvremont à Document 1 de François Blais, l’ironie joue double jeu. Elle marque tout en démarquant. En raillant, elle rallie des communautés discursives.
Mais que brocarde-t-elle, au juste ? Du temps de Guèvremont, c’était la culture avec un grand C, et avec elle la suffisance et l’afféterie. Aquin ironisait sur la culture mondiale, à prétention universelle. Aujourd’hui, « l’âge de l’institution » a fait naître chez ses légataires une volonté de s’inscrire contre cette même institution, contre ce bocal du titre dont l’ironie contemporaine s’attache à éprouver les parois. L’ironie, dans ce cas, braque la littérature contre elle-même.
Dans d’autres cas, elle en établirait la souveraineté, selon que l’on adhère ou non à ce lucide aveu d’impuissance formulé en guise de conclusion : « [L]a culture qui me touche, au contraire, avance Bélanger, sait qu’elle n’a aucun moyen, qu’elle est une pure irrationalité, une dépense toujours excessive ». Prendre la littérature pour elle-même, comme une dépense excessive, mais non moins stimulante : cet essai y invite splendidement.