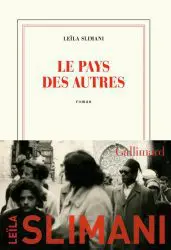Entre le personnel et le politique, les luttes pour la liberté animent d’un grand réalisme ce roman qui porte un regard nouveau et féministe sur le Maroc colonial.Le pays des autres reprend les thèmes chers à l’auteure : la maternité, la sexualité féminine et la liberté sous toutes ses formes. Là où ses premiers romans s’inscrivaient dans l’extrême contemporain avec un style épuré, celui-ci constitue une ambitieuse fresque historique à la narration documentaire. À partir de fragments intimes et de scènes du quotidien du Maroc colonial, l’auteure dépeint habilement la décennie entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’indépendance du Maroc.Au printemps 1947, Mathilde et Amine s’installent dans une modeste ferme sur la terre familiale près de Meknès. L’Alsacienne, une jeune femme sensuelle et frivole, peine à s’adapter aux coutumes d’un pays étranger et aux rigueurs d’une vie de recluse. Le Marocain, ancien combattant de l’armée française, veut devenir agriculteur et moderniser l’agriculture de son pays. Malgré son travail acharné, il s’échine à faire prospérer la terre, aride et ingrate. L’amour passionné de ce couple qui défie toutes conventions se complique peu à peu, alors que les tensions politiques déchirent le pays. La quête de liberté des personnages fait écho à la soif d’indépendance du pays : la fillette du couple explore les limites du domaine familial, la tante a l’audace d’aller au cinéma et de fréquenter un amoureux tandis que l’oncle rêve d’un Maroc débarrassé à la fois de ses « envahisseurs » et des nouvelles mœurs que ses compatriotes leur ont empruntées.Slimani crée des images d’un réalisme cru. Des repas où on mange des sardines avec les doigts sales, des enfants qui vomissent en voiture, une servante qui sent la sueur ; ces images très peu poétiques montrent l’humain sous toutes ses coutures. Malgré la justesse de cette narration, ou peut-être à cause de son implacabilité, les personnages sont vus sans jamais tout à fait être ressentis. L’auteure n’épargne aucun travers, aucune misère, et une certaine distance demeure entre le lecteur et les images du roman. Malgré la violence du propos, parfois la laideur des images, l’ensemble est d’une beauté qui touche au grandiose. Les rêves des personnages sont rattrapés par l’impitoyabilité du quotidien, tout comme l’idéalisme qui se heurte à l’inéluctabilité de l’histoire.Enfin, les nombreux personnages féminins permettent de réfléchir sur la condition des femmes au Maroc, prises entre traditions et modernité, religion et émancipation. Par des descriptions de moments historiques, le motif des femmes revient, discret mais insistant : les femmes font entendre leurs youyous, crient « Indépendance ! » ou refusent de serrer la main aux Français dans une intéressante réécriture d’une histoire qui omet trop souvent la femme. Grâce au mélange du personnel et du politique, de l’illustration des rapports de pouvoir entre les personnages et les différents groupes auxquels ils appartiennent, l’œuvre est résolument féministe.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...