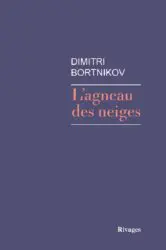« Ça a commencé par une naissance sans un cri. Une naissance silencieuse… Maria a vu le jour quand la Révolution s’est mise à table pour dévorer ses enfants. » Ainsi débute ce magnifique et bouleversant roman de Dimitri Bortnikov.
Elle est née avec un pied bot cette petite Maria, un soir de blizzard, au bord de la mer Blanche dans le nord de la Russie. Personne ne s’attend à ce que cette petite chétive et infirme survive. Pourtant, elle y parviendra. Elle traversera les convulsions de la Révolution. Elle connaîtra les affres de la famine, la douleur de perdre tous ceux qu’elle aime, tout en étant protégée, cependant, par l’ange tutélaire que fut sa marraine, Sérafima, qui a veillé sur son enfance, l’initiant aux mystères de la nature et lui apprenant « ce qui fait vivre et ce qui tue dans une forêt ».
Lancée sur la trace de sa mère et de ses frères qui ont fui la famine en mettant le cap vers le sud, cachée dans des wagons de train, elle survit grâce à la générosité de quelques bons samaritains : un gamin qui lui glisse des os de moutons à sucer pour qu’elle ne meure pas de faim, une fillette qui lui donne un bout de pain séché et un bout de lard, un médecin qui la soigne et veut la mettre sous la protection d’un confrère qui habite Leningrad, où elle finira dans un orphelinat au service des enfants qui y ont été abandonnés.
Ici s’ouvrent les passages les plus lumineux du roman. Dans ce havre où l’on s’attendrait à trouver la plus grande misère se trouvent des femmes et des hommes humbles et dignes tous attachés à assurer, tant bien que mal, le bien-être des « chérubins déchus » et des « angelots déçus » qui leur ont été confiés. Après un chapelet de malheurs, Bortnikov sème dans son récit quelques petits moments de bonheur à propos, par exemple, d’un arbre de Noël à trois têtes, de jeux extérieurs par grand froid quand les enfants ont joues et mains graissées de beurre pour leur éviter l’engelure et qui, une fois rentrés, sentent le pain frais, à propos encore d’un coq acariâtre et « picosseur » de jarrets trop coriace pour être mangeable ou des joyeuses excursions en forêt où Maria révèle à sa marmaille les secrets de la nature que Sérafima lui a transmis.
Puis, le 22 juin 1941, arrive la guerre. Fin de la récréation. Pendant 900 jours, les Allemands assiégeront Leningrad. Forcée de fuir la famine et les bombardements pour sauver les enfants, Maria trouvera refuge dans une cave avec une douzaine de ses petits protégés en attendant des secours. La description de cette longue attente constitue la matière des pages les plus déchirantes du roman. Les plus touchantes aussi. Il se termine comme il avait commencé : sur l’image d’une Maria silencieuse sur laquelle tombe une neige qui semble sans fin.
À travers l’histoire de cet agneau des neiges humble et soumis aux aléas du destin auxquels il ne résiste pas, mais tente plutôt de s’adapter, l’auteur condense toute l’histoire du peuple russe, appelé depuis toujours à composer avec le pire. Ce douloureux destin collectif est décrit ici au plus près de chacun des personnages qui peuplent le roman et qui tous continuent de nous habiter longtemps après que nous avons refermé le livre, tant est grand leur poids d’humanité.
L’agneau des neiges raconte le parcours d’un être ballotté par l’histoire avec une sensibilité, une humanité et une compassion exemptes de toute sensiblerie ou mièvrerie. Avec une économie de mots qui cache une grande pudeur, dans un staccato de phrases écrites à la kalachnikov, la plume de Bortnikov nous va droit au cœur par la force de son pouvoir d’évocation. Peu importe si, au passage, il abuse, aux yeux de certains, du point d’exclamation ou des trois points, de l’ellipse ou de l’hyperbole. Ces « abus » sont constitutifs de l’oralité de son style, ils en sont la musique. Tant pis pour ceux qui y resteront sourds. Qu’on se le dise ! L’agneau des neiges est un très beau livre et Dimitri Bortnikov, un grand écrivain.