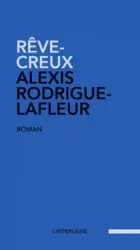On sait depuis Freud que les rêves ont un sens que l’on peut interpréter ; mais les écrivains comme Jean-Jacques Rousseau ont démontré que les rêveries peuvent également avoir, dans certains cas, une valeur littéraire.
« Le rêve est toujours en avance sur la vie », écrivait Louis Althusser. L’intrigue de Rêve-creux débute candidement : au fil des jours, un brave père de famille recueille en alternance les récits de rêves d’angoisse de ses enfants, devenus adolescents. Chacun des chapitres relatant des rêves, puis des discussions autour de leur analyse subséquente, oscille sur cette ligne floue, démarquant imprécisément le songe et la réalité, le fantastique et le réalisme, le vrai et le faux. Dans ce deuxième roman, Alexis Rodrigue-Lafleur alterne entre les récits de rêve proprement dits et les épisodes de réveil, de reconstruction/remémoration du rêve, mais aussi de rêve-éveillé, de somnambulisme, un peu comme à l’époque des écrits oniriques de Robert Desnos et même du jeune Salvador Dalí (voir son essai Rêverie, 1930). Cependant, Rêve-creux se situe dans un contexte typiquement québécois, avec un choix de mots d’ici : « Kèskia ? », « Pleeeeeease », « Ayoye », « Ben là », « Heille ». De plus, ce roman proche du fantastique comporte dans sa deuxième moitié une dimension introspective et une volonté exploratoire, en évoquant parcimonieusement certains concepts anthropologiques (comme le shamanisme), mais aussi quelques termes médicaux (somnambulisme, épilepsie) afin de mieux saisir la dynamique du rêve et structurer le récit. Une touche d’ésotérisme se greffe au mystère, en introduisant le paranormal, et notamment la xénoglossie, pouvant survenir « lorsque quelqu’un dans un état de conscience modifié est capable de parler une langue qu’il ne connaissait pas au préalable ». Des allusions aux spiritualités orientales s’ajoutent à cette quête de soi.
Le style d’Alexis Rodrigue-Lafleur est spontané, alerte, composite ; ses débuts de chapitres empruntent aux didascalies du théâtre et aux indications scénaristiques, avec une prépondérance de dialogues et des scènes brèves. On imaginerait bien une adaptation pour la scène ou à l’écran de ce texte. Il y a en général très peu de descriptions, sauf dans certains chapitres s’apparentant à un conte, qui cependant éviterait le macabre. On déplorera la surabondance de mots anglais, d’anglicismes et d’expressions alambiquées qui s’insèrent d’une manière contrastée – et quelquefois boiteuse – dans certains passages parfois plus recherchés, mais sans être tout à fait littéraires. On retient que Rêve-creux est un roman comportant beaucoup de jeunes personnages et qui se destine sans doute à un lectorat adolescent.