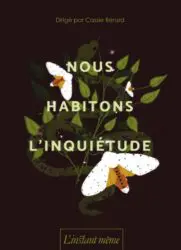Admettons, avec Maurice Blanchot, que la littérature commence au moment où elle devient une question. Pressés de toutes parts par d’incessantes interrogations, nous sommes ici en pleine lecture littéraire.
Cassie Bérard enseigne la création littéraire à l’UQAM. Elle dirige ce collectif de neuf jeunes écrivains qui conjuguent écriture et inquiétude. Le recueil s’inscrit sous le double patronage de Fernando Pessoa et de Blanchot, deux noms qui indiquent la teneur des textes et la perspective dans laquelle les auteurs travaillent. Bérard signe l’essai d’ouverture, une cinquantaine de pages génériquement hybrides et d’une lecture à la fois simple et ardue. Il y a quelque chose de Kafka et peut-être de kafkaïen dans son essai, un essai qui, pour sa part, conjugue aussi fiction et examen critique (ça n’a rien d’un reproche). Nature et frontière de la fiction, fonction de l’écriture : les préoccupations de Bérard sautent aux yeux à chaque page, mais elles ne privent en rien les textes suivants de leurs qualités propres, de leur individualité et de leur force. Il y a du talent chez les auteurs qu’elle parraine. Je ne peux même pas dire : du talent brut, parce que c’est déjà fignolé, c’est déjà senti et mûri, certaines tournures me rendent jaloux, certaines images ou façons de montrer me fascinent.
Dans l’ensemble, toutes les nouvelles forcent la réflexion. Hermétiques, ces nouvelles m’ont obligé à réfléchir tantôt avec la tête, tantôt avec le ventre et le cœur, tour à tour. « Derrière l’aquarium » d’Alizée Goulet, dense et labyrinthique, m’a rappelé Cortázar et Sarraute. Plus aéré, « La répétition » d’Élise Warren respire mieux, même si le texte, lui, suggère une oppression métaphorique. Le dérangeant « Les jumeaux ou bien » de Catherine Anne Laranjo voisine au plus près de la poésie, par la forme et la langue ; il est de ces textes qui exigent relecture. Sorte de concentré d’œuvre à naître, « Le plan » de Jennyfer Chapdelaine ébranle nos habitudes de lecture. Avec sa chute, « Dans un sac » de Joëlle Turcotte se rapproche le plus d’une nouvelle classique, mais son écriture travaillée suggère beaucoup plus qu’elle n’impose. Julie Roy avec « L’écririenne » joue le surplace narratif, plus près de l’expression d’une émotion que d’un récit, lequel émerge pourtant dans les bribes de souvenirs, à coup de courtes narrations enchâssées : « Je préfère m’abstenir », « j’ai grandi avec cette idée », « Je me souviens que », « Je préfère vivre avec », etc. Peu de verbes d’action, peu d’actions franches, juste une mince avancée narrative qui se faufile dans le portrait d’un rapport angoissé à la maladie et à la mort. Portrait du vide et de l’absence, métaphore du néant (et de notre condition ?), il y a de ça dans la dernière nouvelle du recueil, « La machine » de Jean-Philippe Lamarche. L’incipit ouvre le bal : « Il n’y a rien ici, sauf le vide ». Plus loin on lit : « Rien n’a jamais réellement existé… » Plus loin encore : « Le temps arrange tout, à ce qu’on dit ». J’ai posé le recueil en me disant ça, que le temps favoriserait ma compréhension de ces textes. Je me suis dit que j’allais relire « Semi-détachées » de Marie-Ève Fortin-Laferrière pour l’habile construction de ce touchant récit du passage du temps vitesse grand V et du vieillissement. Et reprendre « L’article 34 », de Marie-Pier Lafontaine, une histoire d’agression sexuelle qu’une lecture unique n’épuise surtout pas.
Je me suis même demandé (bonjour Pessoa !) si une malicieuse Bérard elle-même ne signait pas de dix patronymes l’ensemble des nouvelles, si elle ne se livrait pas à cet exercice à paliers qui consisterait à multiplier les noms et… Je me suis dit que non. Mais j’y ai rêvé. Après tout, Nous habitons l’inquiétude n’y invite-t-il pas un peu ?