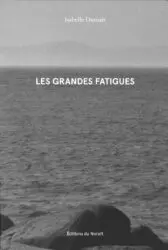Un livre de langueur, construit avec minutie et qui épouse le mouvement du souffle comme celui des vagues ; une invitation à danser avec la fatigue.
J’ouvre Les grandes fatigues un dimanche matin. C’est congé, il fait soleil, la maison est fraîche et les seuls mots qui me viennent à l’esprit sont ceux du Jean-Claude des Valseuses : « On n’est pas bien là ? » Je me laisse bercer par les deux brèves parties en forme d’allégorie sur des gens qui vivent en marge, sur le bord de l’eau, par les neuf sections qui creusent les profondeurs de la fatigue, par ces « Échos », où la poète ouvre sa bibliothèque sous mes yeux et mêle sa voix ou plutôt, dialogue, avec celles de René Lapierre, Maurice Blanchot, Sylvia Plath, entre autres, qui viennent boucler le livre.
Les premiers poèmes mettent en lumière une sensation d’égarement, de perte de sens, un désir de se poser. Narrés au nous, ils enveloppent, sont chaleureux. L’amorce se fait timide, les poèmes prennent leur temps, parfois, un seul vers habite la page, le compte d’une respiration : « Habiter çà et là est laborieux et bruyant ». La poésie d’Isabelle Dumais balance entre agitation, lutte et ouverture. Puis, elle devient plus réflexive. L’amour de l’autrice pour l’essai est bien présent, dans le ton, dans l’angle qu’elle a choisi pour embrasser son sujet.
La section « Le courage du lit » invite à s’étendre, à déposer les armes, sur le mode impératif, un brin mutin : « Déposons nos têtes de pioche aux pieds de murs de roches / pas de meurtrières trouées dans nos matières certes / démunis mais au frais ». Ce ton, j’aurais aimé le retrouver davantage tout au long du livre. L’autrice commande, à coups de « laissons, attendons, étendons, abandonnons, déposons ». Puis, elle adopte le vous, avec ce qu’il porte d’élégance, de distance, de pudeur et de beauté. Isabelle Dumais s’adresse aux épuisés, offre son empathie, sa sympathie et sa bonté, comme si elle savait qu’il ne sert à rien de résister, qu’il est bon au contraire de s’abandonner : « Je vous accorde du répit / façonne des étendues pour vos têtes lourdes / modestement et pour vrai ».
L’écriture est sobre, fluide et lente. Le sujet impose son rythme et l’autrice s’y plonge de façon délicate, subtile ; elle semble écrire du corps, mais aussi, nécessairement, de l’extérieur, liée à la nature qui l’entoure. L’eau surtout, mais aussi les végétaux, les fruits et la peau sont autant de motifs qui reviennent au fil des poèmes et qui viennent créer un équilibre entre le cérébral et l’organique.
À nos courses effrénées et souvent absurdes, la poète répond par de nombreux passages qui marquent l’esprit, par la justesse de ce qu’ils évoquent, soit un amour du monde, mais aussi un besoin de s’y réinscrire, hors de la vitesse, avec un certain détachement : « Ainsi couchée j’aime le monde / avec tendresse le laisse / être ce qu’il veut ». Par contre, certains poèmes répétitifs ou un peu moins percutants viennent diluer la force du propos. Cela dit, je sais que je suis en présence d’une poète qui construit, de livre en livre, une œuvre intelligente et profondément humaine, quand je lis : « Qui n’a pas un dos délicat n’a rien compris encore au poids du monde » ou encore : « Dans un siècle fatigué, ils ont appris à danser une valse intime avec cette compagne étrange qui à la fois massacre et déplie ». Et doucement, j’apprivoise mes propres essoufflements.