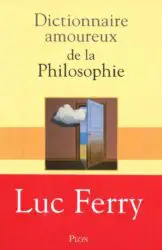Voilà un volumineux florilège des objets philosophiques affectionnés par l’essayiste, qui fut par ailleurs ministre français de l’Éducation nationale de 2002 à 2004.De l’« Absolu » au « Vin », Luc Ferry actualise les idées phares de ses publications antérieures, en y ajoutant ici et là quelques commentaires plus spontanés qui contribuent à alléger le ton de l’ouvrage. Les 260 entrées du dictionnaire abordent une grande variété de questions, des plus conceptuelles aux plus triviales. Ainsi, à la lettre « A », l’article « Altruisme » propose une réflexion sur le souci de l’autre, pouvant être conçu comme prolongement de l’égoïsme, mais également comme effet d’une rupture avec la tendance naturelle à tout ramener à soi. En comparaison, l’article « Automobile », où l’auteur affiche sa nostalgie d’une passion, est d’une portée, disons, moins universelle.Luc Ferry le philosophe étant doublé d’un homme politique, ses écrits accordent une place de choix aux fondements et aux orientations de la vie en société. Si l’essayiste a su au cours des trois dernières décennies poser un regard éclairant sur plusieurs phénomènes sociaux et politiques contemporains, il semble de plus en plus obnubilé par sa croyance en la supériorité définitive du monde des « démocraties libérales ».La tangente suivie par Ferry en philosophie politique l’amène à reprendre à son compte, dans l’article « Fin de l’histoire », la thèse de Francis Fukuyama élevant les régimes de démocratie libérale au stade ultime de l’évolution. L’exercice intellectuel se révèle ici plutôt indigent, le philosophe appuyant son raisonnement sur l’étonnante prémisse d’un alliage indissociable entre capitalisme et démocratie. Ainsi, dépasser le capitalisme aurait pour conséquence inévitable de nous priver de cette perfection que constitue la démocratie telle que nous la connaissons. Une telle conclusion contredit d’ailleurs l’article « Animalité et humanité », où Ferry fait sienne la notion de liberté chez Jean-Jacques Rousseau, soit la capacité de perfectionnement de l’humanité, tant individuelle que collective : « […] les sociétés humaines sont plongées dans une logique de changement incessant qui tient au fait que l’humain est liberté, écart par rapport à la nature ».Dans « Capitalisme et communisme », on lit à propos de Marx : « Autant la conclusion du raisonnement me paraît fausse […], autant le point de départ de l’analyse est intéressant ». Ferry (il n’est en cela aucunement original) se réfère aux idées de Marx pour définir le capitalisme, mais se base sur les dérives autoritaires et antidémocratiques des régimes marxistes pour juger du programme politique découlant du Capital. On retrouvera dans de nombreuses entrées divers arguments à la défense du capitalisme. Notamment, dans « Argent », le lieu commun selon lequel « pour redistribuer des richesses grâce à l’État providence, il vaut mieux d’abord les avoir produites grâce au système capitaliste ».Ferry résume pour une bonne part, dans l’article « Écologie », le propos élaboré dans son essai Le nouvel ordre écologique (1992), lequel dénonçait les dérives antihumanistes d’une certaine « écologie profonde », notamment le projet d’accorder des droits aux animaux sensibles. L’actualisation du thème prend toutefois ici une drôle de tournure. L’essayiste amalgame désormais en une mouvance indifférenciée les prétendus écologistes qui semblent vouloir en finir avec l’espèce humaine sur Terre et les militants anticapitalistes. Ferry ose même avancer en conclusion que la crise environnementale se réglera « en accentuant la croissance et la consommation ». Le même discours se retrouve, de manière redondante, dans plusieurs autres entrées, notamment « Animal », « Biosphère », « Décroissance » et « Nazisme et écologie ».D’autres articles s’avèrent plus intéressants à mes yeux. Dans « Islam, islamisme, islamophobie et islamonazisme », l’usage du terme « islamophobie » est critiqué, en tant que manœuvre idéologique des islamistes visant à confondre le racisme et la critique de l’aliénation religieuse. « Nation et nationalisme » défend la position selon laquelle « l’idée moderne de nation […] désigne tout à la fois une identité culturelle particulière et une prétention à l’universalité ». Finalement, sous « Philosophie », Ferry donne une définition de la discipline qui, au-delà d’une pratique de réflexion par soi-même, constituerait une « doctrine du salut sans Dieu, une ‘spiritualité laïque’ ». L’article rejoint, d’une certaine façon, le propos de l’essai L’homme-dieu ou le sens de la vie (1996). Il contient des arguments essentiels justifiant d’accorder une place beaucoup plus centrale à la philosophie dans les parcours scolaires si nous voulons qu’ils produisent de meilleurs citoyens.Il faut savoir gré à Luc Ferry de défendre, depuis La pensée 68 (1985), l’humanisme, la démocratie et la laïcité. Mais il faut également se méfier de sa propension à rejeter dans l’antihumanisme toute tentative de sortir du cadre socioéconomique mondialisé.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...