« Les fictions de France Daigle permettent la représentation d’une Acadie moderne, dégagée des clivages anciens et dont le sens reste ouvert » ; ce commentaire de Raoul Boudreau, paru dans un dossier que consacrait la revue Voix et images1 à Daigle en 2004, souligne l’importance de cette œuvre dans la littérature acadienne, mais il faut également noter, comme le font d’autres universitaires, que cette œuvre est l’une des plus importantes de la francophonie canadienne. Les trois volumes2 de la collection « Bibliothèque canadienne-française » (BCF) redonnent accès au cheminement de Daigle.
Deux cycles caractérisent l’œuvre de France Daigle : avant et après l’utilisation du dialogue. Les trois volumes regroupent tous les romans du premier cycle. À son tour, ce cycle se divise en deux parties : le roman poétique et le roman en tant que tel.
 « Les trois premiers livres forment une suite, une trilogie, probablement parce qu’ils sont clairement une sorte d’exploration de la forme. Cette exploration a continué avec les autres livres, Variations en B et K et La beauté de l’affaire. Puis, avec La vraie vie, j’ai essayé d’aller plus loin, de passer au roman proprement dit. Même si la forme était encore très visible, au moins les pages sont pleines et on ne dit plus : Ah ben, c’est de la poésie. Il y a autre chose qui s’y est glissé », affirme-t-elle dans l’entrevue qu’elle a accordée à Monika Boehringer (dossier Voix et images). Elle considère 1953 comme son premier véritable roman.
« Les trois premiers livres forment une suite, une trilogie, probablement parce qu’ils sont clairement une sorte d’exploration de la forme. Cette exploration a continué avec les autres livres, Variations en B et K et La beauté de l’affaire. Puis, avec La vraie vie, j’ai essayé d’aller plus loin, de passer au roman proprement dit. Même si la forme était encore très visible, au moins les pages sont pleines et on ne dit plus : Ah ben, c’est de la poésie. Il y a autre chose qui s’y est glissé », affirme-t-elle dans l’entrevue qu’elle a accordée à Monika Boehringer (dossier Voix et images). Elle considère 1953 comme son premier véritable roman.
Jusqu’à La vraie vie, Daigle organise la mise en espace des textes sur la page, qui rapproche ses romans de la poésie et propose une lecture dans laquelle les yeux du lecteur sont contraints de suivre le rythme qu’elle impose au récit : chaque roman a une disposition graphique qui lui est propre et qui naît de la façon dont elle entend dévoiler le sens de son propos.
De même, il n’y a pas de dialogue à proprement parler dans tous ces romans : « Ce n’est pas par hasard qu’il n’y a pas de dialogues dans mes premiers livres. Je trouvais que les dialogues en français standard sonnaient un peu faux et je ne voulais pas écrire en chiac3. » Seul Film d’amour et de dépendance fait appel au dialogue. Mais il est écrit en français standard et tient plus du récitatif poétique que de la conversation.
Sans jamais parler du vent s’oppose d’une certaine façon à la verve généreuse d’Antonine Maillet : à l’utilisation de l’oralité s’oppose la langue littéraire. Ainsi, Raoul Boudreau avait noté qu’à l’instar de Gaston Miron, Daigle « a trouvé une première solution au problème de la transposition littéraire d’une ‘syntaxe acadienne’4 ». Cette recherche d’une spécificité linguistique acadienne traverse toute son œuvre. Le sous-titre donne une clé de lecture : « Roman de crainte et d’espoir que la mort arrive à temps ». Elle y questionne la vie, le voyage, l’enfance, sa propre réalité.
Film d’amour et de dépendance raconte l’élaboration d’un scénario de film réalisé par deux femmes amoureuses l’une de l’autre. On ne saura pas grand-chose du film si ce n’est qu’il sera tourné à Saint-Édouard-de-Kent, première incursion d’un lieu acadien dans l’œuvre de Daigle. Une fois de plus, le sous-titre, « chef-d’œuvre obscur », donne une piste. Le cheminement des réalisatrices représente celui de l’auteure, elle aussi à la recherche de la façon de se dire. Pour Jean Royer, « cette jeune romancière est actuellement la plus importante parmi les écrivains d’Acadie. Après seulement deux romans, France Daigle se révèle, en fait, un des auteurs les plus intéressants de toute la nouvelle littérature francophone. Il y a dans ses romans une façon nouvelle d’aborder et d’exprimer le sentiment de vivre actuel : un style à la fois très moderne et tout à fait séduisant, qui se tient près du mystère de son sujet5 ».
Histoire de la maison qui brûle est une métaphore qui symbolise la destruction de la première Acadie, tout comme elle peut représenter l’intériorité. Le texte évoque Émile Lauvrière qui, en 1922, publiait La tragédie d’un peuple, qui raconte l’histoire de l’Acadie. Mais, plus que la mince intrigue, c’est la réflexion sur l’écriture et le temps qui est ici fondamentale, réflexion tamisée par un humour discret qui permet de dépasser l’horreur de l’événement : le feu détruit, mais il est aussi renaissance.
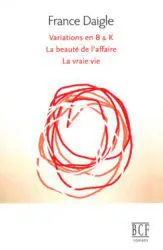 Variations en B et K introduit une forme qu’on retrouvera dans Pour sûr (2011) : au texte du roman placé dans le haut des pages répondent en tout petits caractères des informations factuelles, scientifiques ou historiques. Le haut des pages est le journal de la narratrice, qui campe au parc national de Kouchibouguac (le « K ») ; elle lit un livre sur les Bédouins (le « B ») qui donne lieu aux notes de bas de page. Un va-et-vient s’établit entre le monde des Bédouins et l’Acadie, en particulier avec la situation née de l’expropriation des habitants de Kouchibouguac. Comme l’écrit la préfacière Monika Boehringer, « voici donc un texte où s’entrecroisent librement, voire ludiquement, les fils narratifs, musicaux, iconographiques, techniques et savants6 ».
Variations en B et K introduit une forme qu’on retrouvera dans Pour sûr (2011) : au texte du roman placé dans le haut des pages répondent en tout petits caractères des informations factuelles, scientifiques ou historiques. Le haut des pages est le journal de la narratrice, qui campe au parc national de Kouchibouguac (le « K ») ; elle lit un livre sur les Bédouins (le « B ») qui donne lieu aux notes de bas de page. Un va-et-vient s’établit entre le monde des Bédouins et l’Acadie, en particulier avec la situation née de l’expropriation des habitants de Kouchibouguac. Comme l’écrit la préfacière Monika Boehringer, « voici donc un texte où s’entrecroisent librement, voire ludiquement, les fils narratifs, musicaux, iconographiques, techniques et savants6 ».
La beauté de l’affaire clôt le cycle des romans « formalistes » de France Daigle. Pour une dernière fois, la mise en page est plus proche de la tradition poétique que de celle du roman. Dans ce livre d’une cinquantaine de pages, trois histoires se croisent sans jamais se rencontrer. Les personnages sont à peine ébauchés, caractérisés simplement par un élément, une pensée, une action. En arrière-plan, La vie matérielle de Marguerite Duras, un livre dans lequel s’entrelacent essai et autobiographie, et dont le style inspire Daigle. Le sous-titre, « Fiction autobiographique à plusieurs voix sur son rapport au langage », donne une clé de lecture. Mais surtout, ce roman est un clin d’œil à l’écriture non exempte d’humour.
La vraie vie est le premier roman à utiliser toute la page. Par contre, le récit est encadré par une contrainte qui tient de la mathématique : deux parties de cinq sections qui ont dix paragraphes chacune. Si l’on excepte 1953, tous les romans qui suivront obéiront à des structures fermes qui, paradoxalement, libéreront son écriture. Six personnages issus d’horizons différents se croiseront. L’un d’entre eux, Élizabeth, un médecin français qui choisit de s’établir à Moncton, reviendra dans les romans subséquents. L’intrigue est mince, voire inexistante : les personnages vivent des situations, mais on ne peut pas parler d’évolution ou de métamorphose. Par contre les thèmes abordés sont nombreux : art, vie, mort, genre sexuel, identité… Si les épisodes semblent avoir été disposés d’une façon aléatoire, il s’en dégage tout de même un univers cohérent. Et Moncton devient un centre animé et où tout est possible, ville qui sera dorénavant au cœur de l’œuvre de Daigle. Comme l’écrit Réginald Martel, « malgré la narration neutre et l’absence de dialogues, les personnages qui se mettent à vivre sous nos yeux, en instantanés alternés, ont autant de vérité et d’intensité que les protagonistes de romans beaucoup plus traditionnels7 ».
D’un roman à l’autre, l’Acadie prend de plus en plus de place. D’implicite, elle devient explicite. 1953 sera le premier roman à faire de l’Acadie son centre. Sous-titré Chronique d’une naissance annoncée, 1953 raconte la naissance et les premiers mois de Bébé M. Ce « M » ne peut-être que le « Moi » de France Daigle, même si elle ne l’avoue pas : elle est née en 1953 et son père est journaliste au quotidien L’Évangéline, dont les reportages et éditoriaux forment le cœur de la matière du récit.
La mère de Bébé M. et garde Vautour, qui veille sur le bébé à l’hôpital en raison de sa maladie cœliaque, lisent attentivement le journal, dont elles commentent le contenu. Le ton est parfois critique, parfois humoristique, mais toujours pertinent. Il s’en suit une énumération des événements de l’époque qui encadrent la venue au monde de Bébé M., et qui, d’une certaine façon, fixent les paramètres de sa vie. À cette trame s’ajoutent celles d’Élizabeth et de Claude, deux personnages de La vraie vie, et de Brigitte, qui sont dans l’époque de l’écriture du roman, mais qui s’interrogent aussi sur le sens de la vie.
 C’est aussi, comme dans la plupart des œuvres de Daigle, une réflexion sur l’écriture : « L’écrivain ne vise pas par ses écrits à s’enrober de quelque banale immortalité personnelle, mais à s’inscrire dans la force qui avance, comme dans un courant ou un mascaret – pourquoi pas – remuant les poissons et les algues pour les oiseaux de rivage qui les attrapent au vol, pressés qu’ils sont eux aussi de faire échec au défaut de masse. Quelque chose comme l’âme débarrassée de toutes ses ficelles et entièrement libre de naviguer dans les sphères, flottement merveilleux et surnaturel, où la question de l’origine et du sens ne se poserait plus ».
C’est aussi, comme dans la plupart des œuvres de Daigle, une réflexion sur l’écriture : « L’écrivain ne vise pas par ses écrits à s’enrober de quelque banale immortalité personnelle, mais à s’inscrire dans la force qui avance, comme dans un courant ou un mascaret – pourquoi pas – remuant les poissons et les algues pour les oiseaux de rivage qui les attrapent au vol, pressés qu’ils sont eux aussi de faire échec au défaut de masse. Quelque chose comme l’âme débarrassée de toutes ses ficelles et entièrement libre de naviguer dans les sphères, flottement merveilleux et surnaturel, où la question de l’origine et du sens ne se poserait plus ».
Avec Pas pire (1998) apparaissent Carmen et Terry, qui seront au cœur des prochains romans et qui ouvrent ce qu’on pourrait appeler le cycle de Moncton. L’écriture s’enrichit du chiac qui caractérise la langue de Carmen et Terry et de certains personnages, et s’enracine dans cette ville qu’a si bien chantée Gérald Leblanc.
Les trois tomes de la BCF sont préfacés par Benoit Doyon-Gosselin, Monika Boehringer et François Paré. 1953 est suivi d’un choix de jugements, d’une biographie de Daigle et d’une bibliographie de la réception des œuvres.
1. Voix et images, no 87, printemps 2004.
2. France Daigle, rééditions dans la collection « BCF» : Sans jamais parler du vent [1983], Film d’amour et de dépendance [1984], Histoire de la maison qui brûle [1985], Prise de parole, Sudbury, 2013, 381 p. ; 17,95 $. Variations en B & K [1985], La beauté de l’affaire [1991], La vraie vie [1993], Prise de parole, Sudbury, 2016, 212 p. ; 15,95 $. 1953. Chronique d’une naissance annoncée [1995], Prise de parole, 2014, 197 p. ; 14,95 $.
3. Monika Boehringer, « Le hasard fait bien les choses », Voix et images, op. cit.
4. Le Papier, no 1, mars 1984.
5. Le Devoir, 15 décembre 1984.
6. Monika Boehringer, op. cit.
7. La Presse, 12 septembre 1993.
EXTRAITS
Le teint basané des charpentiers, les cigarettes qu’ils roulent à la main et qu’ils fument tout en travaillant, en choisissant leur bois. Ce qu’ils parlent peu ou avec assurance qu’un jour la tâche sera terminée. Parfois la scie, parfois le marteau. L’amour qui s’y cogne. Un grand film, un chef-d’œuvre obscur.
Film d’amour et de dépendance, p. 196.
— Albinoni, Tomaso Albinoni.
— De 1671 à 1750.
— Un concerto perdu.
— Que l’histoire laisserait fuir.
— S’échapper.
Film d’amour et de dépendance, p. 197.
Elle ne bouge pas, n’a toujours pas bougé. Depuis tout ce temps que je la regarde elle n’a même pas ouvert les yeux. Je commençai donc à comprendre que cela relevait vraiment de la fiction, même s’il n’était pas du tout évident que l’histoire allait de l’avant.
Histoire de la maison qui brûle, p. 308.
Cette page du manuscrit acadien selon laquelle les martyrs emportèrent comme suprême vision de la patrie les sanglantes lueurs d’un incendie qui dévorait granges, maisons, églises. Om.
Histoire de la maison qui brûle, p. 309.
L’architecte et sa femme sont immobiles dans l’ambiance feutrée de l’église. Son immobilité à elle tient d’une sorte d’enlignement, d’une capacité certaine à la droiture.
La beauté de l’affaire, page 109
Encore quelque chose entendu derrière le grillage. En soulevant un sac de ciment, une des travaillantes explique à un gars qui tient un boyau d’arrosage qu’avant on l’accusait d’avoir un problème de communication. La beauté de l’affaire c’est que maintenant qu’elle s’exprime davantage, on l’accuse d’avoir un problème de perception.
La beauté de l’affaire, page 109.
Élizabeth n’a pas eu de difficulté à décider d’accepter le poste qu’on lui offrait à Moncton. Elle avait déjà déménagé plusieurs fois depuis le début de sa carrière et contrairement à d’autres, elle avait plutôt aimé ces déplacements successifs. Elle aimait aussi l’idée de participer à la mise sur pied d’un nouveau centre de traitement du cancer.
La vraie vie, p. 147.
Élizabeth s’était sentie un peu moins coupable d’être médecin le jour où une cliente, une petite dame un peu âgée, lui a confié qu’elle trouvait merveilleux de penser qu’elle allait bientôt mourir. Parce qu’en choisissant la médecine, Élizabeth n’avait pas nécessairement opté pour la prolongation de la vie.
La vraie vie, p.148.











