Traduit de l’espagnol par Audrey Damas
Le 10 décembre dernier marquait le centenaire de la naissance de l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector. Toujours empreinte d’élégance, à la fois mélancolique et énigmatique, son écriture, au-delà des modes et des étiquettes, demeure inclassable.
Élevée au rang de mythe, sa prose novatrice et poétique nous transporte dans une atmosphère comparable à celle de la recherche mystique authentique, où le regard se tourne vers l’intime, dans une profonde introspection, pour tenter de trouver l’universel. Borges définissait le fait esthétique « comme l’imminence d’une révélation qui ne se produit pas ». Et c’est précisément là, dans cet océan éthéré, que se situe l’œuvre complète de la grande dame de Rio de Janeiro. À tout moment, comme dans une composition musicale, le rythme, la cadence et l’harmonie sont présents. Toutefois, elle peut s’en aller, revenir, voire improviser ou déformer chaque mot, chaque phrase, parvenir au seuil de la dissonance, mais sans jamais le franchir, comme s’il s’agissait d’une partition inaccessible. Cette tension – le fait d’être toujours à la limite de l’incertitude – est ce qui permet, en définitive, de faire jaillir le miracle de la création artistique.
Née le 10 décembre 1920, dans la localité ukrainienne de Tchetchelnyk, Chaya Pinkhasovna Lispector, dont la mère aurait été violée pendant la Première Guerre mondiale et aurait contracté la syphilis, fut délibérément conçue pour guérir la maladie de sa génitrice. À l’époque, en Europe de l’Est, il existait une croyance populaire selon laquelle la grossesse avait un pouvoir guérisseur. Finalement, lorsqu’elle atteignit l’âge de neuf ans, sa mère décéda et elle porta, toute sa vie, le fardeau de n’avoir pu remplir sa mission. Peut-être cet épisode explique-t-il la profonde mélancolie de sa personnalité que l’on retrouve dans bon nombre de ses textes : « L’histoire de chaque personne est l’histoire de son échec ». Elle était la troisième fille de Pinkhas et Mania. Sa naissance en Ukraine fut un hasard, conséquence de la fuite de ses parents, des Juifs russes. Son grand-père fut assassiné et son père, sans ressource, s’exila à l’autre bout du monde. À l’arrivée de la famille au Brésil, tous prirent des noms portugais et Chaya reçut celui de Clarice.
Au Brésil, grâce à la ténacité de son père qui gagnait sa vie en vendant des vêtements, mais réussissait à peine à subvenir aux besoins de la famille, Clarice put poursuivre ses études au-delà de ce qui était habituel pour une jeune fille de son rang social. Elle étudia le droit à l’Université du Brésil, une école d’élite où il n’y avait aucun Juif et seulement trois femmes. Cependant, ses études la marquèrent peu, ses rêves la conduisant dans les rédactions des journaux de la capitale, où sa beauté et son intelligence ne passaient pas inaperçues. C’était une jeune femme cultivée et exotique et elle ne perdit jamais son accent yiddish. D’une maturité peu commune chez une étudiante universitaire d’à peine vingt et un ans, son premier roman, Près du cœur sauvage, reçut le prix Graça Aranha. « Elle rompait avec la tradition baroque du récit brésilien », selon les mots du critique Basilio Losada.
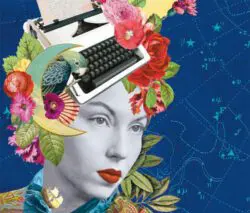
En 1943, pendant ses études de droit, elle épousa le diplomate Maury Gurgel Valente. Elle vécut à Naples, à Berne et aux États-Unis, mais resta toujours en contact avec les journaux de son pays, avec lesquels elle avait commencé à collaborer du haut de ses quinze ans. Elle se sépara en 1959 et revint à Rio avec ses deux enfants, dont l’un était schizophrène.
Sujette à la dépression et créatrice inépuisable, « je pense que lorsque je n’écris pas je suis morte », Clarice aborde des sujets traditionnels et coutumiers qui mettent en évidence son besoin d’inventer et de transmettre des sensations au-delà des faits. Son style repose sur une recherche linguistique incessante et une instabilité grammaticale qui empêchent une lecture trop rapide, car on n’en comprend pas toujours le sens au premier abord. Certains attribuent cette particularité à l’influence de la mystique juive que son père lui a enseignée. Tout comme une méditation poétique, sa façon de raconter, labyrinthique et excessive, est un parcours introspectif des pensées, des peurs, des angoisses, des sentiments, en définitive de la vie, presque toujours mise en scène au travers de femmes qui vivent piégées dans des univers conventionnels comme le sien. Beaucoup ont écrit sur la maternité, les travaux ménagers et les enfants, mais personne, auparavant, ne l’avait fait comme elle. Cette fusion caractéristique de la vie quotidienne et de la réflexion métaphysique fait de sa littérature une confession authentique qui permet au lecteur attentif d’entrevoir, ne serait-ce qu’un instant, le monde intérieur insondable de l’auteure. Elle est l’une des écrivaines latino-américaines les plus populaires, mais les moins comprises. « Je n’écris pas pour plaire », répondait-elle naturellement quand on lui reprochait le fait que ses œuvres étaient difficilement compréhensibles.
Son deuxième roman, Le lustre, est publié en 1946 et trois ans plus tard paraît La ville assiégée. En 1954, un an après la naissance de son deuxième fils aux États-Unis, la première traduction de Près du cœur sauvage sort en français, avec une couverture d’Henri Matisse. En 1963, elle publie ce que la critique considère comme son chef-d’œuvre, La passion selon G.H., l’un des romans les plus perturbants et inquiétants du XXe siècle. Dans cet ouvrage écrit en quelques mois à peine, la protagoniste, une femme moderne, urbaine et indépendante, est confrontée, à travers une rencontre avec un cafard, à la matière première de la vie, à l’origine essentielle de l’existence.
Dans sa préface au livre Clarice Lispector. La náusea literaria, de la Mexicaine Carolina Hernández Terrazas, Elena Losada Soler écrit avoir trouvé la clé – « le mot rigoureux » – pour comprendre son œuvre : « La parole de Clarice Lispector est rigoureuse, car elle doit traduire quelque chose de beaucoup plus grand que le langage. Elle doit traduire le mystère et ce qui n’a pas de nom, elle doit pouvoir raconter l’instant et l’acte infime qui est à l’origine de tout. Et pour tout cela, les mots sont insuffisants ».
Le livre le plus abstrus de l’auteure brésilienne est probablement Água Viva (1973). Dans ses pages, dont l’histoire s’exprime librement sans être retenue par une quelconque attache, le lecteur, déconcerté, assiste, au travers de ses monologues lancinants, à une sorte de délire où l’on peut ressentir la quête ultime de ce qui, en réalité, ne peut être trouvé. « Je n’aime pas ce que je viens d’écrire ; mais je suis obligée d’accepter tout le paragraphe parce que c’est lui qui s’est imposé à moi. » Écrit avec une liberté à laquelle on n’est pas habitué, sans limites, pourrait-on dire, Água Viva explore des chemins incompatibles avec la rationalité, en une pure confusion onirique. Et à l’instar de toute expérience ascético-mystique, les allusions au désert et au silence sont réitérées comme étant l’expression physique du dépouillement.
Ce sont des livres de fiction, mais il n’y a rien de plus réel. Dans le dernier, L’heure de l’étoile (1977), l’un de ses rares romans au sens classique du terme, c’est-à-dire avec une intrigue, un développement et toutes les caractéristiques inhérentes à ce genre littéraire, on peut lire : « Si j’écris encore, c’est parce que je n’ai rien d’autre à faire en ce monde en attendant la mort ». En moins d’une centaine de pages, elle met en scène une jeune fille qui, comme elle il y a des années, voyage du Nordeste à Rio de Janeiro. Affligée face à l’immensité du monde, à l’impossibilité de l’embrasser, et encore moins de le comprendre, elle se sent profondément seule. Sans espoir, Clarice Lispector erre sans but, avec ses protagonistes, dans un vide qui ne la mène nulle part. Son œuvre nous parle de ce qui ne peut être trouvé, de ce qui est insaisissable, de la quête désespérée de sens, et de l’angoisse de savoir dès le début qu’il n’y a pas de solution à l’énigme. Le jeu est perdu d’avance, mais vous devez pourtant y jouer. C’est le paradoxe d’être vivant.
« Faisons comme si nous ne nous rendions pas à l’hôpital, comme si je n’étais pas malade et que nous allions à Paris », dit-elle à son amie Olga Borelli, qui était avec elle dans le taxi, peu de temps avant que la mort ne la surprenne. Elle est décédée le 9 décembre 1977, un jour avant son 57e anniversaire, victime d’un cancer de l’ovaire. Ses restes reposent au cimetière juif de Rio de Janeiro. Sur sa pierre tombale, une inscription simple en hébreu : Chaya Bat Pinkhas, « la fille de Pinkhas ».
La parution en 2009 de Why This World, la biographie monumentale que lui a consacrée le journaliste américain et chroniqueur du New York Times Benjamin Moser, l’a élevée au rang de « grand écrivain » en la mettant à la une de The New York Review of Books, faisant d’elle la première auteure brésilienne à s’attirer une telle reconnaissance.
Lire Lispector, c’est pénétrer dans un territoire risqué, à l’opposé du tourisme littéraire caractéristique de notre époque. On ne sort pas indemne de la lecture de ses livres. Il faut être prêt à faire un effort considérable pour vivre avec l’incertitude. Nous devrons apprendre à revenir de ces mondes lointains et secrets où elle nous entraîne. Celui qui revient n’est plus le même que celui qui est parti. Le lecteur qui fait de sa passion un métier, qui ne renonce pas devant la difficulté, ressentira le paradoxe de cette passion. D’une part, il souffrira de ne pouvoir comprendre ce qui se trouve, très souvent, devant lui, et de sentir que cela lui glisse entre les doigts sans qu’il puisse l’en empêcher. Mais de l’autre, cette passion se traduira par de l’enthousiasme et de l’émotion, car il saura qu’au-delà de la raison, il y a du vrai dans ce qu’il lit.
Ce texte est d’abord paru le 7 mars 2021 dans le magazine mexicain Replicante sous le titre « Clarice Lispector, la hija de Pinkhas » et le 25 mars dans le magazine littéraire espagnol Librújula sous le titre : « Clarice Lispector. Centenario de una autora de culto ».
** Photo de C. Lispector ©Miller of Washington/Clarice Lispector Collection/IMS
*** site.claricelispector.ims.com.br











