Introduction ou induction ?
– Pourquoi ne parles-tu pas de livres québécois dans cette série ?
– Parce que je réserve le meilleur pour la fin, le meilleur pour le rêve, celui agissant sur notre pauvre réalité défectueuse. Pour le rêve que presque tous les Québécois souffrent de réaliser faute de… Tu sais, un loustic m’a dit un jour : « Il y a tellement de gens qui ne peuvent se réaliser faute de moyens que je méprise ceux qui ne peuvent se réaliser faute d’eux-mêmes ». Voilà où en est rendu le brave peuple québécois, dirigé par les raclures d’une culture de l’annulation qui ne nous fait plus rêver, qui ne fait que nous culpabiliser pour tous les crimes que nous n’avons pas commis en commun dans un passé décomposé. Cela en dit long sur un peuple qui craint son identité, qui oublie de l’habiller de radieuses utopies au lieu de folles dystopies pseudo-égalitaires empruntées à l’Autre, ce touriste de passage qui n’arrête pas de nous bassiner avec la beauté et la grandeur du pays quitté, sans jamais y retourner pour l’habiter à demeure, parce que, vois-tu, quand on aime son pays, on l’habite. Et Nelligan, lui, l’a habité… jusqu’à la folie. Malgré lui.
– Tu parles d’une introduction… À part ça, t’es pas tanné de tous ces moustiques qui piquent ta pensée ?
– Si tu savais ce que je sais, sur ma vie comme sur mon histoire, sur mes moustiques comme tu dis… Si tu savais ce que je sais, tu fermerais ton mâche-patate.
– Ben là, accouche, même si tu n’es pas dans le genre transgenre.
Développement ou jugement péremptoire ?
Je n’y peux rien. Le Québécois attend toujours l’approbation de l’Autre au lieu d’agir en toute liberté. Et l’Autre n’en a rien à cirer de la nôtre ; il demeure silencieux devant notre malheur de ne pas être au monde. Nous fuyons notre identité pour mieux la perdre dans la ferraille destinée à la fonderie des peuples incapables de s’arrêter de rouiller. Bref, il n’y a plus rien d’inoxydable dans le Québécois mondialiste en route pour la déroute, en adoration devant les criminels culturels. Nous n’avons plus confiance en notre génie propre, encore moins en nos oracles et visionnaires. Cette attitude relève de notre histoire d’éternels colonisés toujours en train de se recoloniser.
Nos rares et vrais génies n’ont jamais reçu reconnaissance de leur vivant, même quand la réalité les animait encore. Mon pays inachevé tousse en tout temps sur leurs belles et grandes réalisations, pousse même à la folie, à la toxicomanie, au suicide, à l’exil intérieur ou extérieur, bref à une vie lacunaire au lieu de celle, stellaire et spectaculaire, qu’ils ont pourtant largement méritée. Comme mon pays a peur de ses idées, il craint toujours celui ou celle qui les propulse jusqu’au ciel. Et du côté de la fuite dans les mondes imaginaires, nous avons le cas exemplaire d’Émile Nelligan. C’est ainsi que, en 1969, je relisais sans cesse ses Poésies complètes1 dans l’édition établie et annotée par Luc Lacourcière, pendant que je naviguais entre les Illuminations de mon cher Rimbaud et celles de…
– Ben là, attends un peu. N’est-ce pas le même Luc Lacourcière, né à Saint-Victor-de-Beauce, dont le père médecin a vu à l’accouchement de ta grand-mère maternelle, celui-là même qui a aidé à la naissance de ta… mère ?
– Eh ben, oui. Pis j’y peux rien. J’y peux rien itou si Robert Cliche, avocat et beau-frère de Jacques Ferron, a vu à la ruine de mon père, ce qui m’a permis de connaître la nécessaire humilité. J’y peux rien, sacrement rien. Pis, à la fin, vas-tu arrêter de me… ?
– T’arrêtes pas de parler !
– Je parle quand les autres n’ont rien à dire. Ça fait que…
Je reviens au Nelligan de mes seize ans, sans plus ennuyer mon rieur de malheur avec mes étranges synchronicités. Aujourd’hui je me demande ce qu’il faisait en mon pays, ce génie égaré après les tempêtes de neige où plus rien ne bouge, sauf le froid, alors que de ses vers émanent une lumière onirique, un cœur parfaitement symbolique, des visions… malheureusement incompatibles avec le pragmatisme nord-américain d’un peuple soumis, par la force des choses, aux rudes nécessités quotidiennes.
Rimbaud habitait son univers onirique tandis que Nelligan l’illustrait. Ce dernier aurait dû fuir à toutes jambes afin de « trafiquer dans l’inconnu » (Rimbaud). Oui, trafiquer un véritable rêve plein de neuves racines qui auraient pu croître sur notre terre pourtant solidaire et généreuse. Au lieu de cela, son génie s’égara dans l’écriture onirique de ses petits malheurs, qui, ironiquement, furent aussi un temps les miens. Oui, ses émotions désarmées ne nous grandissent pas, car elles égarent la vraie grandeur nécessaire pour habiter un pur rêve éveillé, un pur rêve à partager au lieu de sécher dans des chapelles désertes ou sous la jupe de maman. Pour lui, le monde était un obstacle ou un… tabernacle. Dans les deux cas, il se frottait à leurs rudes aspérités, avec aucune issue pour s’évader en grâce et en majesté.
Rimbaud a fui la purulence des rêves stationnaires, tandis que Nelligan resta figé dans nos hivers, dans un pays fabriquant en série des lits de Procuste où il faut s’étendre avant de regarder benoîtement l’Autre crypto-raciste vomir dans nos bottes d’hiver pendant que nous essuyons nos larmes gelées d’hommes blancs condamnés. Oui, mon pays préfère la réalité de l’Autre, le plus souvent ricain souverainement ricaneur. Ce faisant, le Québec se reconnaît dans un visage universel, car indigents sommes-nous en idées propres en route vers un authentique territoire à reconnaître. Je radote peut-être, mais nous sommes ainsi parce que nous avons été dépossédés de tout et surtout de la liberté de repenser notre propre réalité, celle précédant les rêves les plus chers.
Voici venu le temps du sacrilège ! J’ai toujours ressenti une certaine gêne à la lecture de sa belle poésie, comme si son cœur n’appartenait pas au mien. Ses poèmes saturés de rêves débouchent souvent sur… aucune retombée poético-active qui aurait rendu notre rude réalité un peu plus poétique face à notre pénurie de rêves d’accomplissements. Quand je lis : « Entre ses doigts osseux roulant une ample bague, / L’antiquaire, vieux Juif d’Alger ou de Maroc, / Orfèvre, bijoutier, damasquineur d’estoc, / Au fond de la boutique erre, pause et divague2 », cela ne me touche pas, cela ne me permet pas d’augmenter ma réserve de rêves avant de la diffuser aux gens de courage et de solidarité qui ont connu la misère, l’humiliation et le mépris. Nelligan ne nous suggère pas une nouvelle et glorieuse identité, ne nous donne pas l’espoir en des rêves meilleurs. Il n’a rien à dire sur notre actuel malheur collectif animé par la cinquième colonne de colons en action dans tous nos champs culturels. Et…
– Veux-tu dire par là que nous sommes des épais dans le plus mince ?
– Ben non, je dis que, collectivement, encore une fois, nous sommes écrasés et laminés. Nous avons étouffé les visions et les rêves de nos vrais génies, parce que nous traînons maintenant une mentalité de porteurs de peaux de vache coupables de tous les maux de la planète. Pis là, je t’avais ben averti de te fermer le clapet. Es-tu sourd ou quoi ?
– Ben là…
– Ben là, ferme-la ! Je crois en la liberté de parole et surtout en celle de se la fermer quand on n’a rien à dire.
Mais quels frissons quand je m’arrête à certains de ses poèmes dans une autre de mes lectures nocturnes, à savoir : « Te voilà muet à jamais3 ». Et « Ma vie est un blason sur des murs de ténèbres, / Et mes pas sont fautifs où maintenant je vais4 ». Et surtout « … ma vie est un vase à pauvre ciselure5 ».
Trop souvent tes murs sont fissurés, Nelligan. Et par leurs interstices ne pénètre pas notre lumière ancestrale. La tienne se perd dans une totale irisation, car la lumière glorieuse s’élève de la matière pour mieux éclairer la servitude d’un peuple inachevé.
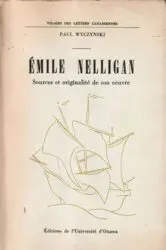 Chez Nelligan, presque tout est emprunté à d’authentiques visionnaires étrangers, à d’autres cultures achevées, à d’autres civilisations sûres d’elles et dominatrices. Il y a trop d’élévations oniriques dans sa poésie, trop de magnifiques illustrations de ce que… nous ne sommes pas. Et je ne parle pas ici de ses nombreuses bondieuseries. Alors mon pauvre petit moi a décidé très tôt de ne jamais être à partir du paraître de l’Autre, car dans son étrange poésie étrangère, il y a des tas de beaux mots qui ne sont pas les nôtres, des mots que nous oublions vite quand nous observons nos cœurs mordus par la nécessité, par la servitude du Québécois maintenant sur la voie de la mondiale médiocrité.
Chez Nelligan, presque tout est emprunté à d’authentiques visionnaires étrangers, à d’autres cultures achevées, à d’autres civilisations sûres d’elles et dominatrices. Il y a trop d’élévations oniriques dans sa poésie, trop de magnifiques illustrations de ce que… nous ne sommes pas. Et je ne parle pas ici de ses nombreuses bondieuseries. Alors mon pauvre petit moi a décidé très tôt de ne jamais être à partir du paraître de l’Autre, car dans son étrange poésie étrangère, il y a des tas de beaux mots qui ne sont pas les nôtres, des mots que nous oublions vite quand nous observons nos cœurs mordus par la nécessité, par la servitude du Québécois maintenant sur la voie de la mondiale médiocrité.
Avons-nous déjà produit un seul authentique génie à verser dans l’album des pures visions universelles ? Non, parce que nous les avons presque tous bafoués, humiliés, écrasés, offensés avant que d’être. Et Nelligan aurait pu devenir ce héraut échafaudant l’ossature de notre culture, mais les actuels crypto-colonisés québécois n’ont rien d’autre à montrer que le pauvre corps dégénéré de l’Autre.
Certes, avec Nelligan, nous sommes en présence d’un début d’aventure culturelle. Nous avons malgré tout survécu parmi « les épaves d’un tragique naufrage6 ». Mais Paul Wyczynski n’a pas compris que Nelligan s’est frappé à la rude réalité de notre culture, avant tout pragmatique et utilitariste. Ici, il n’y a pas place au farniente ou encore aux discours écartés, comme on dit dans mon pays obsédé par la pertinence du réel.
Nelligan est tout à fait nous dans ses fuites oniriques comme dans ses renoncements, face aux jaloux et aux envieux, face à sa maman qu’il adore, face enfin à son père qui le récusait et qu’il aurait dû affronter avec une détermination virile, celle qui lui aurait permis d’occuper la place de son génie. Mais le pauvre n’a pas eu le temps, occupé qu’il était à sombrer « dans l’abîme du Rêve7 » et dans lequel s’entassent, depuis le début de l’humanité, les génies illimités qui n’ont pas pu s’imposer. Quant à nos génies québécois, eh bien, ils sont encore et toujours inachevés.
Voilà Nelligan et nos tourments avec sa vision sans aucune sensibilité nationale, sans aucun vertige d’une grandeur à poursuivre, aucun vestige d’une identité propre sauf celle d’un moi tourmenté. Chez lui, quitte à me répéter, aucune allusion à notre acharnement à durer au milieu du silence imposé par le colonisateur ou l’Autre à peine dérangé par nos faibles cris. Aucun devenir dans la poésie de Nelligan. Rien que des lieux, rien que des dieux enfermés dans des chapelles que personne n’appelle pour lui dire de cesser de causer avec son cœur pressé de souffrances et de silences oppressés, quand aucun souvenir ne va vers le peuple endeuillé depuis la Défaite, quand rien ne fait revenir le cœur vaillant dans les veillées où les violons et les danses et les chansons réveillaient parfois le bourgeois, lui qui donnait dans la belle littérature du vaste monde tandis que souffraient autour de lui les pauvres gens dépouillés de leur dignité, de leur grandeur, de leur argent soigneusement volé par les cannibalistes et les mangeurs d’âmes.
Finalement, Nelligan adorait sa mère. Et rien de plus insupportable que les amoureux de leur maman. Ils sont du genre à ne jamais vouloir se frotter au père autoritaire mais réaliste, celui qui initie de tout temps le mâle adolescent aux rudes réalités d’un monde impitoyable, car « la vie ne fait pas de cadeau » (Jacques Brel). Tous ses petits cris craintifs et plaintifs se réfugient sous la jupe d’un dérisoire maternage au lieu de combattre l’être autoritaire sans pour autant revêtir les habits neufs de l’étrange inconnu.
Conclusion
– Je suis fatigué de t’entendre parler, mais j’ai hâte à ta conclusion…
– Il n’y en aura pas, parce qu’avec le Québec on ne peut jamais conclure si on ne veut pas s’exclure.
1. Émile Nelligan, Poésies complètes 1896-1899, texte établi et annoté par Luc Lacourcière, Fides, Montréal, 1952, 331 p.
2. Ibid.,extrait du poème « L’antiquaire », p. 160.
3. Ibid.,extrait du poème « Le saxe de famille », p. 163.
4.. Ibid., extrait du poème « Devant mon berceau », p. 48.
5. Ibid.,extrait du poème « Potiche », p. 168.
6. Paul Wyczynski, Émile Nelligan. Sources et originalité de son œuvre, Éditions de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1960, 349 p., p. 160.
7. Émile Nelligan, cit., extrait du poème « Le vaisseau d’or », p. 44.











