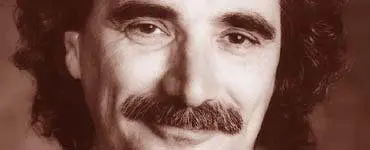Il est une œuvre qu’à dix-sept ans je voulais lire parce qu’un professeur plein de bagout, et avec lui toute une tradition de culture gréco-latine, me l’affirmait magistrale, une sorte d’épopée dont j’ai depuis mille et une fois remis la lecture et que presque quarante ans plus tard je n’ai toujours pas lue, mais à l’occasion à peine feuilletée. Cette œuvre intimidante, je la cite pourtant à deux reprises dans Mendiant de l’infini, un récit de voyage au Tibet paru en 2001. C’est dire que malgré tout je la connais au moins un peu. En fait, j’en sais ce qu’on en dit. Je parle ici de l’Odyssée d’Homère, dont T. E. Lawrence, qui ne devait pas connaître ces récits babyloniens où le merveilleux se mêle au vrai, comme l’Épopée de Gilgamesh, prétendait qu’elle était le plus ancien livre valant la peine d’être lu. Mais encore fallait-il commencer par l’Iliade…
J’ai donc traversé l’Iliade, du même obscur Homère, vers l’âge de dix-sept ans. J’ai conservé ma copie en Livre de poche, imprimée en 1963, avec une préface de Jean Giono : 580 pages bien tassées, plus une soixantaine de pages de notes et index, le tout pour 70¢ ! Le prix, aujourd’hui, de vingt lignes de Christian Bobin… Et je dois à la vérité de dire que cet âpre tragique de la condition mortelle m’est resté en travers de la gorge ; en particulier cette représentation de la guerre comme un donné de civilisation. Il faut préciser que nous étions alors juste après la phase la plus aiguë de la guerre froide et dans les avant-goûts de la guerre du Vietnam. Et je préférais Moby Dick ou Le Dr Jekill et M. Hyde, ne discernant pas, sur le coup de l’émerveillement, que, sous d’autres allures, ces récits traduisaient des délires d’assez proche constitution. J’ignorais qu’il est toujours quelque chose d’excessif dans les grandes œuvres, qui, par définition, sont tout le contraire d’apaisantes.
Et cette violence, dans l’Iliade ! De la guerre avec des étendues de cadavres, du sang qui coule à flots, du courroux, de la froide férocité, de l’agonie, des cris de batailles, des fureurs… et ces civilités d’aristocratie guerrière, comme quand Hector et Ajax, s’étant affrontés jusqu’à la nuit close, s’offrent respectueusement des présents ! De quoi considérer, disait Émile Zola, que les raffinements que nous prêtons à l’Antiquité sont de purs hors-d’œuvre poétiques. Trop d’injures, d’égorgements, de viols, et pas assez de ces nuits intérieures dont Franz Kafka, Fedor Dostoïevski et Albert Camus, au moment où j’entrais dans l’univers des grandes œuvres, commençaient de me combler. L’homme qui m’enseignait la civilisation grecque avait vécu de l’intérieur la Seconde Guerre mondiale. Le sujet sensible de la puissance des nations avait chez lui des échos qui chez les étudiants restaient muets. Il y a ceux qui gardent les yeux grands ouverts, disait ce petit Français plein de nerfs, et ceux qui tremblent devant leur destin. Il voulait nous apprendre à vivre le cœur solide ; mais à cet âge, je n’avais pas trop envie de voir le monde dans son aspect de heurt des nations. La difficulté de vivre parmi les autres et avec moi-même m’occupait pleinement. La guerre, pour nous, même dans sa beauté tragique, semblait une affaire de vieilles personnes, comme aujourd’hui sans doute la guerre froide aux yeux de nos étudiants de vingt, vingt-cinq ans, qui organisent des parties thématiques sur les décennies et qui se déguisent en Elvis et en Doris Day pour symboliser les années soixante, en Boy George ou en Mireille Mathieu pour les années quatre-vingt.
Cela dit, je me souviens d’avoir été touché, moi qui cherchais à m’affranchir de la religion, par le fait qu’au cœur du récit, à l’approche de la mort, Achille n’attend pas une sérénité toute religieuse qui effacerait ses passions ; il ne pense qu’à accomplir sa réalité profonde. Son combat n’est pas non plus le fait d’un engagement patriotique, mais celui d’émotions complexes où se combinent l’amitié, la trahison, la vengeance, la colère furieuse, la cruauté même, le remords. C’est là sa forme d’héroïsme, sa grandeur de passionné qui se projette vers le moment de sa rature.
Une chose cependant m’irritait, c’est qu’au moment où je commençais à comprendre qu’un formidable mystère me sollicitait au lieu de rencontre de l’Orient et de l’Occident, fascination qui plus tard grandirait à la lecture de Rencontres avec des hommes remarquables, le livre de ce fou de Georges Gurdjieff (aussi avec le film qu’en tira Peter Brook), et plus tard encore à la lecture des Pierre Loti, Nicolas Bouvier et autres capteurs de vents et de lumière, cette guerre de Troie contre l’Asiatique m’apparaissait déjà aussi absurde que les Croisades.
De l’Odyssée, je rêve surtout de lire, plus que la quête de Télémaque, le périple d’Ulysse, en héros seul face à ses désarrois, rentrant à Ithaque par des mers achalandées de pièges. J’ai toujours voulu lire la scène où le vieux chien Argos meurt en le reconnaissant ! À dix-sept ans, cependant, il me pressait moins de lire cette scène où Ulysse préfère Pénélope à l’immortalité. C’était l’âge où l’on aspire presque trop à vivre pleinement, librement et quasi à jamais… Sans compter que le prof soutenait qu’il ne fallait pas lire sur un mode réaliste les relations d’Ulysse avec les déesses qui, après tout, n’étaient pas de vraies femmes ! Et peut-être avais-je déjà pressenti que les rentrées de voyages me seraient toujours difficiles, moins sur le chemin du retour (la route du voyageur est toujours un navire magique), que me réinstallant dans le « terrier des habitudes », disais-je dans Mendiant de l’infini. Je n’étais pas à l’âge et dans les années où l’on est dans le besoin de cette façon de force d’âme. Et sans doute pas non plus à l’âge et dans les années où l’on souhaite se faire dire que rentrer chez soi est la grande affaire d’une vie et que le rusé héros de Troie est en fait dépendant de l’engagement à « la plus sage des femmes » ! Ulysse, ensorcelé par le fantasme de rentrée chez soi, ne pouvait être mon héros. Mon héros de qui je n’aurais accepté que de l’errance, qu’une aspiration à tout vivre. Cela dit, à dix-sept ans, m’enchantait pleinement la perspective de cette scène fantasmatique où l’aventurier, rentrant chez lui incognito, entend chantés ses exploits et ses louanges – comme l’artiste qui entendrait l’homélie de sa messe funéraire ; aussi le principe du héros se voyant vengé de ceux qui l’ont trahi durant son absence. Qui, à la sortie de l’adolescence, n’a pas reconnu en lui-même un penchant pour cette sorte de réparation, dont Edmond Dantès, alias le Comte de Monte-Cristo, constitue la figure emblématique ?
Par ailleurs, je crois que d’une certaine manière, j’étais plutôt allergique aux feintes et astuces du héros de l’Odyssée, à sa ruse sous forme de tromperies, fussent-elles légitimées par leurs aspects de prudence et de tempérance, comme l’ont cru les moralistes de la Renaissance. J’avais appris, par mes nouvelles fréquentations littéraires, à préférer la détermination obstinée du héros insensé qui court délibérément ou simplement se laisse porter vers sa perte.
J’avouerai cependant que me fascine toujours, et maintient vif en moi le projet de lire un jour l’Odyssée, cette impression de cauchemar en boucle que m’ont laissée les descriptions d’obstacles (naufrages, monstres, etc.) propres à retarder le retour d’Ulysse au lieu de ses assises. Aussi l’idée d’un récit de voyage apparenté à celui de Sindbâd le marin, ce personnage des Mille et une nuits que le cinéma nous avait mis en tête comme un héros aussi léger qu’assoiffé de frémissements craintifs. Et il y a encore que j’y devine, sous l’aspect du merveilleux épique, un récit d’épreuves chantant les misères et mérites d’un héros qui, dans l’errance, est traqué par la démesure et la déraison. Ulysse, qui tant erra parmi des peuples fabuleux, qui visita les villes et connut les mSurs de tant d’êtres, prend figure d’ancêtre mythique des grands voyageurs de l’épreuve et de l’aventure.
Alors, pourquoi n’avoir pas encore lu l’Odyssée ? Je dirais qu’il y a ces raisons déjà données et que je me suis servies au cours des ans, puis deux autres motifs… D’une part, parce qu’il y a tant à lire, toujours autre chose de plus pressant, un auteur réputé, un écrivain nouveau, un penseur, un conteur, un Albanais, un innovateur, un insoumis, un fragile… et que je cherche toujours, dans mes lectures, à étancher d’abord ma propre soif, et non à épuiser un palmarès. Et d’autre part, parce que l’Odyssée n’est jamais tout à fait parvenue à construire en moi sa nécessité. Sans doute parce que chaque fois que le goût de la lire me prenait, je croyais déjà trop bien savoir ce qu’elle contenait pour m’astreindre à sa traversée. N’est-ce pas pour cela qu’on néglige de lire certains classiques que la rumeur des temps a réduits à une interprétation accommodante : parce qu’on croit trop bien les connaître d’avance ? N’est-il pas un lieu commun de certains chefs-d’œuvre, qui ferait croire qu’on les éprouve déjà intimement avant même de les avoir lus, ce par quoi le lecteur s’autorise à remettre à plus tard ou à jamais de les aborder vraiment ? Alors peut-être me faudrait-il rompre avec cette tradition et, comme Ronsard, demander qu’on ferme bien l’huis sur moi, que je puisse lire l’Odyssée en trois jours (Ronsard dit l’Iliade). Pour l’instant je pars en voyage… avec un japonais irrévérencieux dans la poche.