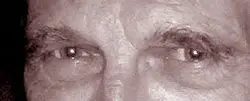Je m’étais promis de gravir ce roman à mon retour de Chine, en 2002, parce qu’il me semblait devoir correspondre à ce que j’avais perçu là-bas, un mélange insolite d’Ancien, en voie de disparition, et de Moderne, en expansion spectaculaire, dans une sorte de Révolution tranquille, ou plutôt de mégarévolution fébrile, qui me rappelait, multipliée par deux cents, la transformation dynamique de la société québécoise des années 1960.
La montagne de l’âme1, tel est le titre de ce livre que j’ai bientôt considéré comme une montagne d’écritures, lointaine et inaccessible, dont je me souvenais plus facilement du nombre de pages, près de 700, que du nom de l’auteur, Gao Xingjian, représentant pourtant le seul prix Nobel de littérature décerné à un Chinois (en l’an 2000). Je ne savais pas, alors, que l’alpinisme pouvait se pratiquer en vagabondant, en hauteur comme en profondeur.
Lors du voyage qui m’avait amené dans plusieurs régions de l’empire du Milieu, j’étais en compagnie de charmantes Chinoises de Montréal qui parlaient le mandarin ou le cantonais ; elles communiquaient et traduisaient d’abondance, mais par leur truchement, il ne m’était guère possible de pénétrer en profondeur l’âme chinoise, et je parvenais mal à saisir comment le moindre Chinois semblait posséder une confiance absolue dans l’avenir, puisant à même une culture qui enfonce ses racines dans une histoire millénaire, tumultueuse et brumeuse.
Je croyais donc avoir trouvé le roman idéal pour redécouvrir de l’intérieur la culture chinoise, via une forme romanesque postmoderne qui concourt à une conjugaison du passé et du présent. Mais voilà, je craignais de ne pas posséder les références nécessaires pour mesurer la portée des multiples micro-récits de ce roman qui nous ramène souvent à différentes époques pré-Mao. En même temps, j’étais peu attiré par l’aspect formel le plus remarquable du récit, cette narration au « tu » qui me faisait penser à La modification de Butor, lequel roman n’avait guère suscité mon adhésion parce que je n’arrivais pas à me sentir concerné par ce « tu ».
Enfin, grâce à l’invitation de Nuit blanche, j’ai pris le sentier de cette montagne d’écritures, puis je me suis égaré, si bien que tous mes préjugés sont tombés. D’abord, les nombreux récits internes, détachés de la narration principale, sont autant de joyaux qui nous font goûter à la diversité d’une culture composite, ce qui m’a rappelé tous ces récits enchâssés dans un autre roman-monde fabuleux, Cent ans de solitude. Et il faut dire qu’il n’y a pas une narration principale : il y en a deux. Elles s’entrecroisent sans vraiment se rencontrer, celle d’un « tu », qui correspond bien à mon « je » lecteur (« tu ne sais pas clairement pourquoi tu es venu ici »), et celle d’un « je », ethnologue amateur à la recherche de traits culturels menacés de disparition depuis cette révolution de Mao qu’on a curieusement qualifiée de « culturelle ».
Les deux parcours narratifs tiennent également de l’errance contemplative, ils tournent continuellement autour de cette fameuse montagne, difficile à localiser, dont jamais les deux narrateurs ne chercheront à atteindre le sommet. L’important n’est pas d’accéder à un but ultime, qui mettrait un terme à la quête ; c’est la démarche elle-même, si hésitante soit-elle, qui constitue l’intérêt de l’itinéraire, le dépassement de soi résidant dans l’acceptation de soi. On incite donc le lecteur à se départir de cette soif de conquête si chère aux Occidentaux, pour qui le cheminement n’a d’importance qu’en fonction de la fin. Mais la finalité n’est-elle pas associée à la finitude ? Ici, le lecteur doit plutôt s’imprégner du tao et concevoir que chaque moment présent soit une source d’enrichissement.
La montagne de l’âme nous invite donc à nous détacher du pragmatisme pour plonger dans les vestiges vivants de la Chine ancienne, une culture traditionnelle menacée par la mondialisation uniformisante qui se répand à la vitesse grand V en un pays atteignant maintenant la troisième position dans la course effrénée à la richesse. Ce roman nous amène à renoncer à cette poursuite illusoirequi nous fait ignorer le passé, négliger le présent et surestimer le futur.
Ainsi en va-t-il de notre périple en ce monde. Nos objectifs sont des mirages qui se dissipent dès lors que nous croyons les saisir, mais l’aventure réside dans les petits pas de chaque jour. Nous avançons à tâtons, et il n’y a nulle part où aller. Le lieu à atteindre est en fait celui où nous sommes déjà. Il n’y a pas de progression, nous sommes des vagabonds : la vie véritable réside dans l’imprévu et toute planification est un carcan qui étouffe la spontanéité.
Je retiendrai deux scènes parmi les innombrables péripéties du roman, l’une, dramatique, et l’autre, d’un humour amer, les deux évoquant des emblèmes de la Chine traditionnelle, le panda et le yeti. Dans un cas, on apprend comment une des dernières portions des forêts chinoises, protégée pour y préserver la vie menacée des pandas, devient en fait le réservoir de braconniers impitoyables. Dans l’autre, on découvre la présence vivante du légendaire homme primitif qui vit encore dans des zones reculées : un autre avatar du fameux yeti que nous croyons peut-être connaître pour l’avoir vu dans Tintin au Tibet. En fait, tout ce qu’on voit de cet humanoïde, c’est un pied qu’un chasseur irréfléchi a vendu à des quidams qui l’ont mangé. Dans un cas comme dans l’autre, on perçoit aisément l’allégorie : la Chine moderne phagocyte son passé.
Je ne peux hélas rendre compte de toute la richesse de cette matière romanesque, fort contrastée, qui englobe poésie, chansons gaillardes, anecdotes historiques, scènes érotiques, tragiques ou pittoresques, considérations philosophiques, sociologiques ou spirituelles, intégrant même folklores, rites et superstitions d’ethnies méconnues, abandonnées sur des voies de garage en marge de l’autoroute du progrès, alors que l’auteur passe par toute la gamme qui va du trivial au transcendantal, jusqu’à incorporer une réflexion sur la nature formelle du roman lui-même, lorsque le narrateur se confond avec l’auteur pour analyser la narration au « tu ». Tout un monde ! À l’image de la Chine.
Puisque je dois malheureusement simplifier, je parlerai de l’esthétique résolument postmoderne du roman, en cela hybride, excentré, fragmentant la voix narrative et faisant revivre le passé à travers un regard contemporain, jamais nostalgique. L’aspect le plus déconcertant de cette écriture tient sans doute à la présence de ces deux narrateurs, qui alternent, occupent le même espace-temps sans que survienne la fusion que nous attendons. Il faut accepter que l’autre, qui vit pourtant tout près de nous, puisse échapper complètement à notre perception. Dernier aspect déroutant, au sens propre : la fin du roman, ou plutôt son inachèvement, nous oblige à considérer que la route ne mène nulle part. Je n’aurai donc aucun souci à vous livrer les deux derniers paragraphes du livre :
« En réalité, je ne comprends rien, strictement rien.
C’est comme ça ».
Et c’est tant mieux : ce roman sans climax ne repose pas sur un dénouement étonnant qui, une fois dévoilé, met un terme à la magie. Comme ce récit, qui a pourtant deux fins, n’offre pas de finale bien tranchée, il continue de vivre en nous, donnant à penser que la fin véritable du récit pourrait correspondre à notre propre fin, à notre mort. Mais l’âme de cette œuvre ne meurt pas, elle vit chaque fois qu’un lecteur accepte de vagabonder dans le roman et de se perdre dans son foisonnement.
Certains lecteurs, comme moi au début de ma lecture, pourraient être désarçonnés par cette absence délibérée d’homogénéité, mais nous apprenons en cours de route à laisser tomber l’illusion que procure l’unité de ton, cet artifice que de nombreux romans nous ont habitués à considérer comme un critère incontournable de qualité littéraire. D’ailleurs, l’unicité apparente de notre monde n’est peut-être qu’une affreuse réduction, une volonté de contrôler la diversité de la vie, afin de mieux manipuler les foules, ainsi que le laisse penser le puissant mouvement de la mondialisation constamment dénoncé dans le roman, en sourdine ou de front.
Je m’en veux un peu de ne pas avoir analysé de près le métissage, ou le tissage, tantôt serré, tantôt aléatoire, opéré par l’entrecroisement des deux voix narratives, et d’avoir laissé tant d’espace à des observations personnelles en marge du contenu romanesque. Mais c’est l’un des effets envoûtants de ce roman : il offre une multitude de portes d’entrée en nous-mêmes. Pourquoi s’en priver ?
D’habitude, je m’intéresse peu à la vie des auteurs, sachant par expérience à quel point le vécu peut être banal lorsque l’écrivain donne le meilleur de lui-même, en écrivant. La plupart du temps, quand l’œuvre est mineure, elle apparaît comme un « faire-valoir » au service de la gloriole de l’artiste et, quand l’œuvre est majeure, elle dépasse le vécu de l’artiste au service de l’œuvre. Sans doute est-ce ici le cas. Ce qui peut expliquer la présence discrète de l’auteur sur la scène littéraire. À moins que certains veuillent s’assurer de son absence. Il y a tout lieu de croire que, à la suite des pressions politiques du gouvernement chinois, Gao Xingjian n’a pas été invité en 2004 au Salon du livre de Paris, pourtant consacré à la littérature chinoise. N’aurait-on pas rejeté l’auteur sous le prétexte qu’il était désormais naturalisé français ?
J’essaie d’imaginer la frustration de cet écrivain, exilé politique depuis 1988, qui a dû fuir la police culturelle chinoise après qu’elle eut brûlé plusieurs de ses manuscrits. Il découvre une terre d’accueil en France, dont il apprécie la langue et la littérature, et le voilà encore victime de ceux qui veulent l’écarter, et ce, dans cette prétendue « terre de liberté » qu’il a adoptée. Pourtant, je ne parviens pas à imaginer Gao Xingjian frustré, lui qui de toute façon ne se conforme pas aux diktats de la mode et se tient à l’écart des puissants projecteurs du people.
Il sait sans nul doute que la véritable illumination est en soi, dans l’instant. Là se trouve la portion d’éternité qui nous est accordée. Ainsi, même après sa mort, parce que son roman s’inscrit dans l’éternel présent, Gao Xingjian continuera-t-il de parcourir en tous sens la montagne de l’Âme, et de l’Écriture.
1. Gao Xingjian, La montagne de l’âme, trad. du chinois par Noël et Liliane Dutrait, De l’aube, 1995.