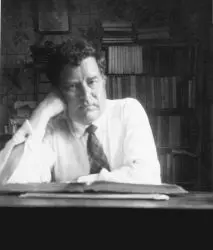Le nom de Régis Messac évoque le théoricien de la conjecture rationnelle et de la littérature utopique depuis l’article que Pierre Versins lui a consacré dans son Encyclopédie de l’utopie, de la science-fiction et des voyages extraordinaires (1972).
Avant la réhabilitation de son œuvre entreprise par les éditions Ex Nihilo, Régis Messac était surtout connu comme romancier d’œuvres d’anticipation, telles Quinzinzinzili, La cité des asphyxiés ou Valcrétin. L’auteur mena aussi des activités professionnelles parallèles : il fut chercheur précurseur du roman policier ou detective novel, professeur pendant quelques années à l’Université McGill, romancier et journaliste dans la presse écrite française des années 1920 et 1930. Cette riche et prometteuse carrière fut brisée net en 1943 : arrêté pour fait de résistance, déporté Nacht und Nebel, il fut interné un temps au camp du Struthof en Alsace avant de disparaître en 1945 dans une marche de la mort en Allemagne.
Régis Messac s’est passionné pour les « marges », en particulier littéraires. Il a été l’un des promoteurs des études de ces nouvelles formes d’inspiration littéraire, constatant qu’elles se développaient et qu’il était du devoir de la critique et de l’historien littéraire de les prendre en considération, ne serait-ce que pour des raisons sociologiques. Marc Angenot, fondateur des science fiction studies outre-Atlantique, théoricien reconnu des paralittératures, « n’a cessé de rencontrer Régis Messac1 » au cours de sa vie et de sa carrière tant l’activité plurielle de ce professeur, de cet écrivain-journaliste infatigable fut prolixe.
La singularité de Régis Messac dans le contexte littéraire des années 1930 est celle d’une triple carrière : enseignant, journaliste et écrivain. Régis Messac fut un pédagogue et ses activités journalistiques peuvent surprendre tant les travaux qu’il a publiés sont peu connus et atomisés dans des publications marginales. À la lecture de quelques-uns de ses écrits, l’image de Régis Messac devient plus nette. Elle s’affirme comme celle d’un penseur engagé, cherchant à s’exprimer par tous les moyens dont il peut disposer : l’enseignement, la presse et la littérature. La pertinente formule de Marc Angenot, « anarchiste et pamphlétaire de tempérament », confirme un engagement politique de gauche : sa collaboration à la revue Les Primaires clarifie sa ligne politique et les valeurs portées par son œuvre : laïcisme et anticléricalisme, militantisme pacifique, droits des femmes, défense et promotion d’une culture accessible à tous et de la culture populaire.
De l’enseignant au journaliste
Régis Messac est né en Saintonge le 2 août 1893. Ses parents, laïques et d’origine paysanne, étaient instituteurs. Ses grands-parents paternels cultivaient la vigne à Saint-Médard (Charente-Maritime) près de Jonzac, tandis que ses grands-parents maternels étaient eux-mêmes instituteurs. Le 2 août 1914, Régis Messac est en khâgne au lycée Condorcet, à Paris. Il prépare le concours d’entrée à l’École normale supérieure. Ce jour-là, le jour de ses 21 ans, il est mobilisé et en décembre 1914, il est blessé à la tête – une balle lui perfore le crâne – et doit être trépané. Il met à profit sa convalescence pour préparer sa licence ès lettres, qu’il obtient en juillet 1915. Il revêt à nouveau l’uniforme et poursuit la guerre dans les rangs du service auxiliaire. Il est démobilisé en 1919. Son père – qui est alors inspecteur primaire – voudrait lui faire reprendre le chemin du lycée, mais Régis est fermement décidé à s’affranchir de la tutelle paternelle et à voler de ses propres ailes. Il s’installe donc à Paris avec Germaine Desvachez, qui deviendra sa femme. Il prépare l’agrégation et subvient aux besoins du ménage en faisant fonction de secrétaire de Me Jacques Bonzon, « avocat social » et directeur de L’Activité française et étrangère, journal auquel collabore Régis Messac à partir de décembre 1919. À cette époque il donne l’impression d’hésiter sur son avenir professionnel. Il semble qu’il ait à ce moment-là envisagé d’embrasser la profession de journaliste. On en trouve l’expression dans L’homme assiégé, roman autobiographique inédit. Au cours d’une conversation avec l’un de ses collègues, Armand Mandar, alias Régis Messac, répond à son interlocuteur : « J’avais bien songé aussi à être journaliste. J’aurais pu… J’ai même essayé, frôlé le truc. Mais quand j’ai vu ce que c’était. Pire encore que le métier de prof ! Au moins, on est libre après quatre heures2 ».
Au retour de la guerre, en 1919, à l’âge de 26 ans, Régis Messac s’essaye au journalisme. C’est dans L’Activité française et étrangère qu’il exerce ses talents de pamphlétaire et livre des méditations sur le thème de la liberté3 ou de l’argent4. Simultanément, il publie ses premiers contes (« L’enfant de la frontière », « Les maximes ») dans La fusée, en 1920. À partir de la même année, Messac se consacre essentiellement à la préparation, d’abord de l’agrégation, puis de sa thèse. Dans cet état d’esprit, il publiera de 1924 à 1930 plusieurs articles à caractère littéraire dans la Revue de littérature comparée5, La science moderne, la Revue d’histoire littéraire de la France, Publications of the Modern Language Association of America, La Grande Revue, ou la Revue belge6. En 1922, Régis Messac est reçu à l’agrégation de grammaire et devient professeur : il ne renoncera jamais à l’activité journalistique mais le métier d’enseignant lui permet de gagner sa vie, de faire vivre sa famille tout en conservant du temps pour l’écriture. À partir de novembre 1925, dans des périodiques de moindre renommée comme Le Progrès civique, mais dotés d’une « conscience politique », on retrouve désormais la signature de Messac. Ce quotidien est dirigé par Henri Dumay et a pour rédacteur en chef Henri Bellamy, que l’on retrouvera plus tard aux côtés de Messac dans la mouvance pacifiste de l’entre-deux-guerres.
La grande affaire journalistique de Régis Messac reste cependant sa collaboration aux Primaires, revue mensuelle de culture populaire, de littérature et d’art, fondée au lendemain de la Grande Guerre par trois instituteurs de communes rurales de la Meuse : Georges Lionnais, Louis Royer et Pierre Guillaumé. Il rejoint la revue en janvier 1930, en devient rédacteur en chef en janvier 1932. Avec René Bonissel et Roger Denux, il portera Les Primaires jusqu’à leur dernière livraison en 1939. Venu à la revue des Primaires au début de 1930 à la demande de René Bonissel, alors codirecteur, Régis Messac écrit en avril 1933 dans un de ses « Propos d’un utopien », précisément intitulé « Primaire » :
« Un de mes… dirai-je amis ? […] me disait un jour, avec cet air de supériorité qui caractérise les gens très bien : ‘Mais pourquoi diable écrivez-vous dans une revue qui s’appelle Les Primaires ? […].’
– Je suis arrivé à la conviction qu’il n’y avait guère que là que j’étais à ma place.
– Avec Les Primaires ? Vous m’étonnez ? Mais enfin, d’ailleurs, qu’est-ce que vous entendez au juste par ‘primaire’ ?
– […] Eh bien, pour moi, un primaire, c’est un type qui croit que c’est arrivé. […] Un primaire, pour moi, c’est un type qui prend tout au sérieux ».
Où ailleurs qu’aux Primaires Régis Messac eût-il pu mieux publier, sans retenue, ses pamphlets (« À bas le latin ! »), s’exprimer avec cette verve directe dans ses chroniques sur les événements et controverses âpres de ces années de l’entre-deux-guerres sur l’enseignement, la littérature et l’édition, la guerre, le pacifisme, les fascismes ? Les Primaires lui permettront de prépublier ses études littéraires, scientifiques, philosophiques et une somme de comptes rendus de livres de tout genre, œuvres littéraires, ouvrages de vulgarisation scientifique, romans policiers, auxquels il faut ajouter ses commentaires de parutions anglaises et américaines, traduites ou non.
À l’Université McGill
Régis Messac n’est pas un homme de renoncement. Son intérêt pour les « marges » littéraires le porte à élaborer une thèse, très moderne par le choix de son sujet, consacrée au roman policier, le detective novel, pendant sept ans, de 1922 à 1929. Son fils, Ralph Messac, dans un article intitulé « Histoire d’une thèse7 », raconte la genèse de ce travail universitaire qui marque la rupture intellectuelle instaurée par Régis Messac avec son père (qui lui reprochait dans sa jeunesse de lire des fascicules de Nick Carter) et avec le monde scolaire : sa nomination au lycée d’Auch en 1922 arrête sa décision d’accéder à une chaire universitaire et de solliciter un poste à l’étranger. En 1924, il est nommé à l’Université McGill à Montréal. Il y donne des cours d’introduction à la langue et à la littérature, un enseignement sur le théâtre et la poésie française. La production écrite de Régis Messac au cours de cette période à McGill est intense : outre la rédaction de sa thèse d’État, il élabora des études sur Edgar Poe, Bulwer-Lytton, Fenimore Cooper, H. G. Wells ou encore Dostoïevski. Dans le même temps, son activité journalistique fut fébrile puisqu’il proposa au Progrès civique une vingtaine d’articles sur la vie américaine. Conçus comme de véritables reportages documentés, ces articles mettent le plus souvent au premier plan les problèmes de société liés au progrès ou à la technique, la critique de la société de consommation et de ses dérives ; ces articles sont une tribune pour dénoncer ce qui en Amérique nuit à la liberté politique ou intellectuelle : le puritanisme, le fondamentalisme ou encore les agissements du Ku Klux Klan, sur lesquels il reviendra par ailleurs dans le roman Le miroir flexible (1933). Il nous met en garde contre « la standardisation industrielle déjà en marche » menaçant « d’entraîner la standardisation des intelligences », une métaphore qui trouve encore une fois un écho chez Georges Duhamel dans Scènes de la vie future (1930). Régis Messac affirme son dédain pour tout ce qui tend, dans la civilisation européenne des années 1930, de plus en plus américanisée, à faire reculer la liberté devant la réglementation, à faire disparaître l’initiative et l’enthousiasme au profit de l’automatisme exigé par la machine, à perdre l’individu dans une collectivité déshumanisée. S’il n’avait quitté le continent américain, peut-être aurait-il été amené à travailler avec Hugo Gernsback, avec qui il entretenait une correspondance : le « père » de la science-fiction moderne lui demandait de poursuivre avec lui la reprise d’Amazing Stories. Mais sa thèse achevée, sa démission en janvier 1929 de son poste à l’Université McGilll et son retour en France empêchent Régis Messac de répondre favorablement à ce projet. La famille quitte définitivement le Canada, clôturant ainsi un des chapitres les plus denses et les plus prospères de la vie et de la carrière de Régis Messac, chapitre qu’il reprendra dans Smith Conundrum, roman d’une université américaine, publié en volumes en 1942.
Utopie, science-fiction et policier : Le critique et le romancier
Deux lignes directrices ont guidé l’activité littéraire de Régis Messac. Il fut un critique et un chercheur hors pair, non seulement des marges littéraires de l’époque (roman policier, roman populaire, littératures utopiques, science-fiction) mais également de la littérature générale. Il fut un romancier reconnu, créant et publiant la première collection de science-fiction en France (« Les Hypermondes ») et des romans d’anticipation : Le miroir flexible (1933), Quinzinzinzili (1935), La cité des asphyxiés (1937) et Valcrétin, écrit en 1943 mais publié pour la première fois en 1973. Traducteur et critique de David H. Keller8, lecteur assidu des pulps américains, Régis Messac était un connaisseur érudit de ce qui allait devenir la science-fiction moderne. Mais c’était également un penseur de l’utopie littéraire : l’auteur d’une Esquisse d’une chronobibliographie des utopies en 1933, éditée par Pierre Versins en 1962, a écrit des romans qui portent la marque de cette culture inédite des littératures de l’imaginaire. Le miroir flexible et La cité des asphyxiés explorent des thèmes classiques de la science-fiction, comme la création de la vie artificielle ou le voyage dans le temps ; Quinzinzinzili appartient à la veine des romans cataclysmiques et post-apocalyptiques, déjà présents depuis les années 1920 (Les hommes frénétiques d’Ernest Pérochon en 1925, La fin d’Illa de José Moselli aussi en 1925 ou Les condamnés à mort de Claude Farrère en 1919) et qui se développeront exponentiellement dans l’anticipation française à partir des années 1940 (de René Barjavel, Ravage en 1942 et Le diable l’emporte en 1948, ou encore le célèbre Malevil de Robert Merle en 1972). Le point commun de tous ces romans est un modelage variable des visions sociales issues de l’utopie : Quinzinzinzili ou Valcrétin sont des utopies régressives qui voient l’humanité évoluer à rebours vers une posthistoire. La cité des asphyxiés et Le miroir flexible sont des transpositions critiques, voilées ou non, de la société des années 1930.
littéraires de l’époque (roman policier, roman populaire, littératures utopiques, science-fiction) mais également de la littérature générale. Il fut un romancier reconnu, créant et publiant la première collection de science-fiction en France (« Les Hypermondes ») et des romans d’anticipation : Le miroir flexible (1933), Quinzinzinzili (1935), La cité des asphyxiés (1937) et Valcrétin, écrit en 1943 mais publié pour la première fois en 1973. Traducteur et critique de David H. Keller8, lecteur assidu des pulps américains, Régis Messac était un connaisseur érudit de ce qui allait devenir la science-fiction moderne. Mais c’était également un penseur de l’utopie littéraire : l’auteur d’une Esquisse d’une chronobibliographie des utopies en 1933, éditée par Pierre Versins en 1962, a écrit des romans qui portent la marque de cette culture inédite des littératures de l’imaginaire. Le miroir flexible et La cité des asphyxiés explorent des thèmes classiques de la science-fiction, comme la création de la vie artificielle ou le voyage dans le temps ; Quinzinzinzili appartient à la veine des romans cataclysmiques et post-apocalyptiques, déjà présents depuis les années 1920 (Les hommes frénétiques d’Ernest Pérochon en 1925, La fin d’Illa de José Moselli aussi en 1925 ou Les condamnés à mort de Claude Farrère en 1919) et qui se développeront exponentiellement dans l’anticipation française à partir des années 1940 (de René Barjavel, Ravage en 1942 et Le diable l’emporte en 1948, ou encore le célèbre Malevil de Robert Merle en 1972). Le point commun de tous ces romans est un modelage variable des visions sociales issues de l’utopie : Quinzinzinzili ou Valcrétin sont des utopies régressives qui voient l’humanité évoluer à rebours vers une posthistoire. La cité des asphyxiés et Le miroir flexible sont des transpositions critiques, voilées ou non, de la société des années 1930.
La pensée de Régis Messac n’est pas uniforme, elle est plastique, usant de la fiction ou de l’analyse, qui peuvent être l’une pour l’autre un prolongement, une source ou une projection, comme c’est le cas pour la science-fiction et l’utopie. Mais cette pensée « en réseau » a servi également sa passion pour le roman policier : une fois sa thèse soutenue, l’intérêt que Régis Messac portait au detective novel a continué à être vif. Grand lecteur du genre, il se fit aussi critique littéraire et publia un certain nombre de recensions de romans policiers, notamment dans Les Primaires. Devenu spécialiste et chercheur chevronné du roman policier, Régis Messac a su montrer, dans ses écrits académiques mais aussi dans ses recensions et traductions, que les années 1930 furent des années charnières : le roman à énigme, le detective novel, est alors un genre qui s’est véritablement constitué en tant que tel, qui a ses maîtres et, déjà, leurs épigones. Mais c’est aussi un genre désormais codifié pour lequel se pose déjà la question du renouvellement avec l’apparition du roman noir (Dashiell Hammett, qui influencera la création de Raymond Chandler ou d’Ernest Hemingway) ou du policier « critique sociale » avec Georges Simenon.
L’œuvre inédite
Malgré la disparition prématurée de Régis Messac et le travail de réédition accompli par les éditions Ex Nihilo, des pans entiers de son œuvre restent à découvrir. Ce polytechnicien de la culture9 avait prépublié dans Les Primaires ou dans Le Progrès civique des « Esquisses de morphologie littéraire » ; ces études anticipent, par une critique de la méthode de Gustave Lanson, le renouvellement de la critique littéraire des années 1960 : le rapport entre l’écrivain et ses modèles, avec son public, avec le pouvoir, voire avec son entourage familial (« La femme de l’écrivain »). Certains essais inédits prouvent encore la puissance anticipatrice de la pensée de Régis Messac, comme La révolution culturelle (1938) annonçant schématiquement Mai 68 ou encore Le crépuscule de la psychanalyse en 1923, qui remettait en cause des méthodes psychanalytiques, toujours d’actualité.
Les éditions Ex Nihilo prévoient dans les années à venir la publication en volumes d’articles consacrés à l’Amérique, un recueil d’études sur les voyages imaginaires (au centre de la terre, dans le temps et dans la Lune10) ou l’ensemble des chroniques intitulées « Propos d’un utopien », parues entre 1930 et 1939.
La créativité littéraire de Régis Messac reste encore à explorer avec des romans autobiographiques comme L’homme perdu, L’homme assiégé ou L’homme enragé, des romans policiers, Ardinghera, Cinis in cinerem ou mieux encore La taupe d’or11, publiés en feuilleton dans Le Quotidien entre 1934 et 1935. Régis Messac a même écrit des pièces de théâtre, au fort accent autobiographique, comme Ragoût de mouton et Phobie du bleu. La grande diversité de cette œuvre inédite à découvrir sera l’occasion de redonner vie à cet écrivain auquel l’histoire n’a pas laissé suffisamment de temps.
1. Smith Conundrum, Roman d’une université américaine, préface de Marc Angenot, Ex Nihilo, Paris, 2010, p. 7.
2. Régis Messac, L’homme assiégé, inédit, manuscrit, p. 164.
3. « La liberté des autres », L’Activité française et étrangère, 15 décembre 1919, p. 287-288.
4. « Le rite et l’argent », L’Activité française et étrangère, 15 décembre 1921 au 1er mars 1922.
5. Par exemple, « Caïn et le problème du mal dans Voltaire, Byron et Leconte de Lisle », Revue de littérature comparée, 1924, IV, p. 620-652.
6. Par exemple, « Les Parodies du roman policier », Revue belge, T. II, n? 2, 15 avril 1930, p. 115 à 136.
7. Le journal de Quinzinzinzili, no 3, été 2008, p. 16.
8. « David Henri Keller et le roman scientifique aux États-Unis », Les Primaires, mai-juin 1939.
9. Pour reprendre ici la formule des frères Bogdanoff, Clefs pour la science-fiction, Seghers, Paris, 1976, p. 47.
10. Cette dernière étude, « Premiers voyages dans la Lune », sera accompagnée de la version anglaise du texte, « Early Voyages to the Moon », traduite par l’auteur lui-même.
11. L’intrigue de La taupe d’or se situe au temps de la prohibition, à Tyler City, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. « La taupe d’or » réfère à la fois à un tunnel permettant la contrebande d’alcool entre les deux pays, et au chef occulte du réseau, qui n’est autre qu’une sommité politique. Nous sommes là en présence d’une sévère critique des mœurs étatsuniennes.
EXTRAITS
Une utopie […] n’est jamais entièrement imaginaire. L’auteur, qu’il le veuille ou non, y reproduit la société de son temps : […] revue et corrigée, embellie et idéalisée, ou au contraire, enlaidie et caricaturée […] une histoire des utopies serait donc une histoire des idéaux de l’humanité, des luttes et des critiques sociales, qui devrait être mise à chaque instant en corrélation avec l’histoire des sociétés réelles.
« Utopia Old and New, par Harry Ross », Les Primaires, no 109, mars-avril 1939, repris dans Les premières utopies, p. 167.
Cette question de l’air a d’ailleurs une grande importance, une importance capitale […]. Je suis sûr, maintenant, que tout l’air que l’on respire ici est artificiel, fabriqué par les hommes. Et cet air est distribué, je dis bien distribué, comme toutes les commodités publiques, l’eau, le gaz, l’électricité, moyennant paiement. Moi qui pensais avoir abordé dans une Utopie ! Quelle chute !
La cité des asphyxiés, p. 158.
J’ai dû m’arrêter d’écrire l’autre jour, si intensément s’ouvrait devant moi l’abîme où je me sentais sombrer. Un trou dans ma conscience. Je ne sais pas combien de temps la chose a duré. […] C’est une idée bien compliquée, que je dois être le seul à posséder parmi les vivants. Comme tant d’autres idées compliquées et inutiles qui périront avec moi.
Pas toutes, peut-être, si ce papier me survit. Ce futile espoir, parfois, m’encourage à écrire. J’écris – il me semble que j’écris pour l’humanité future – si jamais, dans le futur, il y a encore une humanité. Je vais faire œuvre d’historien. Une histoire qui n’aura sans doute jamais de lecteurs.
Quinzinzinzili, L’arbre vengeur, p. 26.