Décédée à l’âge de 108 ans en octobre 2020, Madeleine Vivan (pseudonyme de Madeleine Dallet) est née en 1912 à Montbert, un village de la Loire près de Nantes. Elle a peu publié, mais les deux excellents romans qu’elle écrit pendant les années du Front populaire, aujourd’hui réédités, la tirent heureusement de l’oubli.
Une maison (1936) et Village noir (1937) parurent à l’origine aux éditions Rieder, dont le catalogue, marqué par un humanisme pacifiste et internationaliste, valorisait les témoignages et récits à saveur autobiographique. C’est chez cet éditeur de gauche que Paul Nizan fit paraître ses percutants essais Aden Arabie (1931) et Les chiens de garde (1932) et que Panaït Istrati1 publia son œuvre. Les romans de Madeleine Vivan reparaissent aujourd’hui dans la riche collection « Voix d’en bas » des éditions Plein Chant, constituée de rééditions d’écrivains prolétariens.
Pour autant, Madeleine Vivan est issue d’une tout autre classe sociale. Ses ancêtres maternels sont des notables bourgeois. Il y a une tradition de lettrés dans sa famille, et elle-même fera des études de lettres. Sa mère et son père sont instituteurs. En juin 1915, celui-ci reçoit une balle à la hauteur des yeux qui le laisse aveugle. Vingt-cinq ans plus tard presque jour pour jour, son unique fils tombe au combat, ce qui porte au père un coup dont il ne se relèvera pas. Ce père, François Dallet, meurt ainsi prématurément à cinquante-sept ans. Réintégré dans l’Éducation nationale à la suite de sa blessure, il était devenu le premier instituteur non-voyant de l’enseignement public. L’école où il a enseigné à Nantes porte aujourd’hui son nom.
Village noir
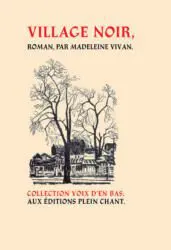 Cet homme courageux, qu’on disait d’une « droiture exemplaire » et qui était d’un remarquable dévouement envers les autres, a inspiré à sa fille le personnage de l’instituteur qui est au centre de Village noir. Toutefois, Étienne Martin, l’instituteur de ce roman, ne revient pas aveugle de la guerre, sans doute parce que la romancière ne souhaitait pas que cette infirmité détourne l’attention du portrait rempli d’humanité qu’elle souhaitait avant tout en donner. Le roman est un véritable petit chef-d’œuvre qui manifeste un sens éminent de la synthèse et de l’économie narrative, un art sûr de ses effets, composé de phrases simples mais riches d’images, caractérisé par des formules concises et très fines qui ont souvent délicatement valeur de sentences. Ces traits d’écriture étaient d’ailleurs assez caractéristiques de la manière des écrivains de la maison Rieder, où l’on trouvait en outre de nombreuses représentations de la figure de l’instituteur, comme dans les œuvres de Constant Burniaux, Jeanne Galzy ou Jean Tousseul.
Cet homme courageux, qu’on disait d’une « droiture exemplaire » et qui était d’un remarquable dévouement envers les autres, a inspiré à sa fille le personnage de l’instituteur qui est au centre de Village noir. Toutefois, Étienne Martin, l’instituteur de ce roman, ne revient pas aveugle de la guerre, sans doute parce que la romancière ne souhaitait pas que cette infirmité détourne l’attention du portrait rempli d’humanité qu’elle souhaitait avant tout en donner. Le roman est un véritable petit chef-d’œuvre qui manifeste un sens éminent de la synthèse et de l’économie narrative, un art sûr de ses effets, composé de phrases simples mais riches d’images, caractérisé par des formules concises et très fines qui ont souvent délicatement valeur de sentences. Ces traits d’écriture étaient d’ailleurs assez caractéristiques de la manière des écrivains de la maison Rieder, où l’on trouvait en outre de nombreuses représentations de la figure de l’instituteur, comme dans les œuvres de Constant Burniaux, Jeanne Galzy ou Jean Tousseul.
Village noir : ce titre désigne un faubourg ouvrier de Nantes. C’est là qu’œuvre Étienne Martin. Il est aimé de ses élèves et respecté et admiré par ses concitoyens. Comme il est instruit, on le consulte ; sensible aux malheurs et à la détresse des autres, il se fait un devoir de leur venir en aide. Sa bonté et son bon sens font qu’on l’appelle le Maître. Mais, fidèle aux procédés du roman de gauche des années 1930, la romancière multiplie les points de vue, alterne les personnages, au gré de l’enchaînement de séquences narratives qui sont autant de lignes de force. Ainsi le personnage de Jean Ménardier fait-il contrepoids à l’instituteur. Natif d’un quartier bourgeois et professeur à l’Institut, il ressent toute l’inutilité de sa vie et de son savoir ; trop cérébral, il est inapte à véritablement communiquer avec les autres et à s’intégrer socialement. Pour Jean, Étienne est un modèle, et il cherche en vain, car il est maladroit, à s’en faire un ami ; peut-être, par cette opposition très appuyée entre les deux hommes, le roman prêche-t-il un peu trop et l’écriture de Madeleine Vivan se nourrit-elle d’une doctrine sociale qui gâcherait l’ensemble si elle n’avait la sagesse de la garder dans l’ombre. Car le portrait d’Étienne est par ailleurs magnifié, l’instituteur devient ce personnage plus grand que nature de l’héritage républicain progressiste qui caractérise la gauche sociale. Et pourtant, il y a une telle justesse dans les observations de Madeleine Vivan sur ces personnages, leurs interactions, leurs désirs et leurs tourments, que son engagement devient une qualité littéraire.
Au fur et à mesure que le roman se développe, un nouveau personnage est appelé à prendre la relève d’Étienne et par conséquent la première place : sa fille Andrée, admirative mais assez sensible pour cerner ses propres désirs et chercher sa propre voie. Vers la fin du roman, Andrée entend trouver une nouvelle existence ailleurs, car la vie au Village noir lui paraît à la fois aliénante par la lutte contre le capitalisme et trop limitée dans ses perspectives d’avenir. Elle va cependant changer brusquement d’idée. En effet, la dernière page réunit Andrée avec son père, son frère et son mari dans la cour d’école, où ils préparent les commémorations du 14 Juillet. Andrée, nous dit alors la romancière, « sait bien que sa place est ici, sous le préau de l’école, au milieu de tous ceux-là qui préparent avec foi la fête de la Liberté ». Cette conclusion précipitée, un peu étonnante par rapport aux précédents désirs d’émancipation d’Andrée, fait triompher un point de vue social sur les choses et l’ouverture vers un nouvel ordre du monde promis par le communisme (que représente, dans le roman, le fils d’Étienne, fervent militant).
Une maison
À cet égard, Village noir reconduit le dénouement du premier roman de Madeleine Vivan, publié un an plus tôt, Une maison. La romancière met cette fois-ci en scène une bande d’étudiants qui refusent les hypocrisies et les injustices d’un monde sclérosé. Au sein de ce groupe, nous suivons plus particulièrement le cheminement intellectuel d’une étudiante prénommée Hélène. Tout à la fin, celle-ci franchit le seuil de la Maison du peuple, lieu de rencontre du mouvement syndical ouvrier. De la maison de son enfance, sur laquelle s’ouvre le roman, elle sera passée à celle qui va dorénavant donner un sens à sa vie.
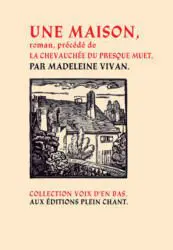 La structure des deux romans est également semblable : les premières pages saisissent à grands traits l’enfance d’Andrée et d’Hélène, les menant peu à peu au seuil de la vie adulte ; dès lors le rythme ralentit, et le développement personnel du personnage féminin domine. La principale différence entre les romans tient à la dimension collective qui anime Une maison. La bande d’amis forme un tout assez solidaire, malgré les divergences d’opinions et le tempérament même d’Hélène, dont l’individualité reste assez marquée tout au long du roman. Nous sommes ici dans un roman de formation comme peuvent en donner l’idée, à la même époque, La chasse du matin (1937) de Jean Prévost ou La conspiration (1938) de Paul Nizan. Ce sont des œuvres dans lesquelles les personnages évoluent au contact des autres, grandissent à la faveur des espérances et revendications de la jeunesse, laquelle rend solidaires les uns et les autres. Dans Village noir, la figure d’Étienne Martin est certes liée à la misère ouvrière du quartier et l’évolution des enfants de l’instituteur débouche sur une prise de conscience communautaire, mais le roman n’a pas l’effet « génération » qui caractérise Une maison.
La structure des deux romans est également semblable : les premières pages saisissent à grands traits l’enfance d’Andrée et d’Hélène, les menant peu à peu au seuil de la vie adulte ; dès lors le rythme ralentit, et le développement personnel du personnage féminin domine. La principale différence entre les romans tient à la dimension collective qui anime Une maison. La bande d’amis forme un tout assez solidaire, malgré les divergences d’opinions et le tempérament même d’Hélène, dont l’individualité reste assez marquée tout au long du roman. Nous sommes ici dans un roman de formation comme peuvent en donner l’idée, à la même époque, La chasse du matin (1937) de Jean Prévost ou La conspiration (1938) de Paul Nizan. Ce sont des œuvres dans lesquelles les personnages évoluent au contact des autres, grandissent à la faveur des espérances et revendications de la jeunesse, laquelle rend solidaires les uns et les autres. Dans Village noir, la figure d’Étienne Martin est certes liée à la misère ouvrière du quartier et l’évolution des enfants de l’instituteur débouche sur une prise de conscience communautaire, mais le roman n’a pas l’effet « génération » qui caractérise Une maison.
Cette génération est née dans le monde déstructuré de la guerre. Indignée par la précarité économique ouvrière, elle adhère au syndicalisme militant et elle est viscéralement pacifiste. L’héroïsme militaire de 1914-1918 la révulse. Car la guerre a volé aux enfants de cette génération leurs pères, leur enfance, leurs illusions, a tué leur optimisme et ce qu’ils étaient en droit d’attendre de la vie. « Nous n’avons pas fait la guerre, bien sûr, on nous l’a assez dit et redit, mais c’est bien elle qui nous a faits. Et c’est un travail solide. Nous avons ingurgité avec nos premières bouillies une telle dose d’héroïsme, de haine et de Marseillaise que nous en sommes dégoûtés pour toute notre vie », s’insurge l’un d’eux.
Des lendemains qui déchantent
Les romans de Madeleine Vivan portent bien l’empreinte de l’époque, celle qui est soulevée par l’arrivée au pouvoir du Front populaire en avril 1936. Les réformes syndicales, la croissance historique de la Confédération générale du travail (CGT), les adhésions massives au Parti communiste français forment l’arrière-plan de Village noir et d’Une maison, sans que jamais l’auteure ne le dise explicitement et ne tombe dans le roman de propagande. Madeleine Vivan est beaucoup trop fine pour cela, elle a un sens de l’expressivité et un rythme de la phrase trop maîtrisés pour ne pas faire de la littérature avant toute chose. Elle a voulu raconter ce qu’elle a vécu, témoigner de son propre parcours et de son émancipation sociale, et cela fait corps avec son temps, qui a été celui des grandes promesses et des réformes les plus ambitieuses de l’entre-deux-guerres. À cette époque, avec le physicien Maurice Schérer qu’elle épousera en 1937, elle fait aussi partie du groupe d’amis rassemblés autour de Jean Giono sur la montagne de Lure, en Haute-Provence. Sur cette expérience collective à l’époque du militantisme pacifiste de Giono, on lira Le pain d’étoiles, un très beau livre d’Alfred Campozet réédité aux éditions La Thébaïde en 2020.
On sait pourtant que cette embellie humaniste fut de courte durée : la guerre d’Espagne, qui attise les tensions entre pacifistes et bellicistes au sein du Front populaire, la radicalisation des droites à la suite des nombreuses grèves et de la crainte que suscite Moscou, l’invasion de l’Autriche par Hitler, tout cela n’augure rien de bon. À peine deux ans après la publication de Village noir, l’Europe est de nouveau en guerre. Les événements rendent déjà caduque l’œuvre de Madeleine Vivan ; si alors elle ne cesse pas tout à fait d’écrire, ses romans appartiennent à une époque si bien révolue qu’elle refusera, de son vivant, qu’ils soient réédités. Comment laisser reparaître ces textes que l’histoire a brutalement contredits ? « Malheureusement la suite de l’histoire je la connais maintenant, les lendemains ont été cruels – sont toujours cruels. Et pour cet aveuglement, je me sens coupable », écrira-t-elle en 1980 à Edmond Thomas, l’éditeur de la présente réédition, à qui il aura donc fallu attendre 40 ans avant de pouvoir remettre les romans sur le marché.
1. Voir Nuit blanche, no 152, automne 2018, p. 18-22.
Œuvres de Madeleine Vivan :
Une maison précédé de La chevauchée du presque-muet, Rieder, 1936, et Plein Chant, 2021 ; Village noir, Rieder, 1937, et Plein Chant, 2021 ; L’escalier a 120 marches, Julliard, 1957 ; Chacun tue ce qu’il aime, Librairie des Champs-Élysées, 1961.
EXTRAITS
Vous êtes là, bien vivant. Vous avez des poumons sains. Respirer est pour vous une allégresse : on vous prive d’air. Vous avez des muscles solides, impatients de mouvement : on vous enferme. Vous avez besoin de gueuler : on vous fait taire. Vous êtes là, jeune, vous avez tout ce qu’il faut pour une vie splendide : des muscles, des poumons, une flamme au cœur, mais une masse épaisse, anonyme, lâche, se colle à vous et vous pousse à la mort, comme du gibier qu’on force.
Une maison, p. 158.
Le désir du Punch se noie dans une immense tendresse. Il prend Hélène contre lui, dans un geste de la bercer :
— Je le connais bien ton mal, et le mien. Il a commencé lorsqu’on n’était encore que d’obscurs marmots. Il y avait une poignée de bonshommes à qui ça plaisait qu’on ait des héros à la place de pères et qu’on soit élevé sur un terrain de démolition. Ils ont fait de nous, en somme, une race de bâtards. Ça faisait monter leurs actions.
Une maison, p. 183.
On raconte qu’un grand-oncle Madio dans la misère fit prendre à sa vieille mère le tablier de la dernière bonne à seule fin de recevoir dignement Mgr l’Évêque qui lui faisait l’honneur de le visiter. Et sans aller chercher si loin, lorsqu’Étienne a demandé au grand-père la main de sa fille, il a répondu, le capitaine (on le sait par cœur) :
— Monsieur, dans ma famille, il faut qu’une fille soit bien malheureuse pour épouser un douanier ou un instituteur.
C’est comme ça qu’ils sont les Madio, pleins de morgue. On ne les refera pas.
Village noir, p. 53.











