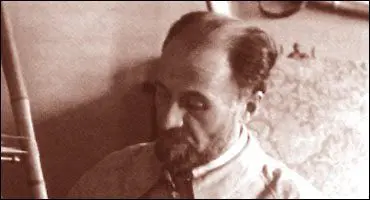« Henri Pourrat est mort le 16 juillet 1959. Et c’est comme si Virgile venait de mourir. » En une page magnifique, Alexandre Vialatte prenait ainsi congé de l’ami de toute une vie, le voisin rencontré presque chaque jour, l’écrivain qui avait fait une vertu cardinale de l’amitié, c’est-à-dire de l’alliance avec les êtres et avec tout ce qui existe.
Pendant plus d’un demi-siècle, sa haute, mince, noble silhouette, portant chapeau de feutre, guêtres, sac en bandoulière, a parcouru les champs, les collines, les villages, les fermes, les montagnes de son Auvergne. Il la connaissait comme on peut connaître un jardin, chacune de ses fleurs, mais un jardin au milieu de grands bois sombres, comme une clarté, un ordre ouverts dans la noirceur de l’ancienne forêt celtique. Il regardait, écoutait ces espaces, ces villageois, recueillait leurs propos, leurs chansons, leurs contes, leurs faits. Entre les larges souffles qui balayent les champs et les landes, dans le rythme des saisons, et sa table de travail, entre contemplation et incessant labeur, son existence s’est déroulée tout entière.
Né en 1887 à Ambert, paisible petite sous-préfecture, il doit renoncer après des études à l’Institut agronomique de Paris à la carrière à laquelle il se destine. La tuberculose le contraint tôt à une vie régulière, quasi ascétique. Que faire alors ? Il lit, d’abondance et avec passion, les classiques grecs et latins, la Bible, Rabelais (« plus de dix fois… »), Goethe et Baudelaire, Dante et Tolstoï, Balzac, Barrès (« notre maître à tous », écrit-il en 1912), Claudel, Péguy, Ramuz, Francis Jammes, « les vieux textes françois », des « cahiers de chansons, fatrasies, almanachs et causes célèbres ». Il commence à écrire, timidement, en 1909, avec son ami Jean Angéli, un recueil de choses vues, les « films auvergnats » de Sur la colline ronde, et il ne s’interrompra plus. Malgré une santé toujours fragile, malgré la guerre à laquelle il n’est pas envoyé mais à laquelle il participe dans la souffrance – un frère y meurt, et Angéli et les plus proches amis, un autre frère peu après, prélude à d’autres deuils. Cette vie sédentaire, laborieuse, dévouée à la famille, si paisible vue de l’extérieur, est traversée par la mort.
Les livres se succèdent : plus de cinquante romans, chroniques, essais, recueils de contes, en parallèle avec les préfaces, articles, comptes rendus qu’il ne savait refuser. Jean Paulhan qui l’encourage dès les débuts, le sollicite pour la NRF. Le succès vient dès 1921 (prix littéraire du Figaro pour le premier tome de Gaspard des montagnes) et vingt ans plus tard, le Goncourt (pour Vent de mars, chronique curieusement sous-titrée « roman »). Fixé en son coin de terre, il ne va à Paris que pour la sortie de ses livres, où il rencontre tous ceux qui comptent alors dans les lettres françaises. Il entretient une correspondance énorme (plus de 7000 lettres conservées) échangée avec Paulhan et Claudel (qui répond à son admiration par des paroles qui sont plus que d’estime polie), Jammes et Ramuz, Valéry Larbaud et Vialatte, combien d’inconnus ou de méconnus. Pourrat s’y dit souvent débordé, et cependant il remplit avec une fidélité sans défaut ses engagements. Les visiteurs se pressent dans la maison d’Ambert. À tous il fait bon accueil, attentif à chacun, comme à une personne unique, sachant trouver le mot qui touche et encourage, faisant face dans les heures et les années noires, cherchant à retrouver un peu de paix et d’énergie, disant ses enthousiasmes. Mais aussi il connaissait en lui, et chez ces paysans qu’il côtoie, chez tous, et chez ses personnages auxquels il la prête, une violence, un feu noir qui, s’il n’est tenu en lisière, ensauvage l’homme.
Régionalisme ?
Les historiens de la littérature contemporaine s’accordent en général à reconnaître l’art de conter d’Henri Pourrat, la saveur de sa langue, la qualité du réalisme paysan. Cependant ils sont pour la plupart étrangement silencieux sur la visée profonde de l’œuvre – pourtant si manifeste et déclarée : elle n’entend pas, ou pas seulement, charmer et divertir. Et par un réflexe qui a la vie dure, on l’a rangée dans la catégorie « régionaliste ». Ce qui, d’ailleurs, dans les années 1920 et 1930, n’a pas plu à tous les champions purs et durs de la dite littérature. On a fait à Pourrat une mauvaise querelle. L’occasion est donc belle d’interroger quelques lieux communs, c’est-à-dire une routine de la pensée critique, et tout bonnement, de la lecture.
Parler d’écrivains et de littérature régionalistes ouvre habituellement tout l’éventail du dédain. Au mieux on fait là-dessus des thèses universitaires parce qu’il faut bien prendre en compte le phénomène. Le plus souvent, comme on n’a pas lu, on étiquette, on caricature et, dirait le père Ubu, à la trappe !
Que reproche-t-on à cette littérature ? On fait d’abord grief à celui qui la pratique de ne pas avoir su ou voulu quitter son canton et de regarder le monde par le petit bout de sa lorgnette – ou plus exactement, de ne pas le regarder du tout. En dehors des quelques arpents de terre où il s’est enfermé, il veut croire qu’il n’y a d’autre existence que celle qu’ont menée les pères et des générations de terriens plantés en leur terroir. Il voudrait croire aussi qu’il n’y a pas d’autre réalité, ou s’il y en a une, la supprimer. Ici le bien et le salut, ailleurs le mal et la damnation. Passéiste, réactionnaire, attardé, myope, volontiers fanatique, lançant avec feu et rage l’anathème contre le progrès et le monde moderne. En deux mots, peu fréquentable.
Et il va produire les mornes livres pleins de touchantes amours rustiques, d’édifiants sacrifices, entre la description appliquée des labours et celle des moissons, glorifiant dans le dialogue de la charrue et du clocher les vertus ancestrales des paysans. Qu’avons-nous donc maintenant à faire de ces rêveries et de ces vieilleries, alors que la paysannerie est morte et que nous vivons sur une planète en passe de devenir une seule mégalopole ?
À l’écrivain régionaliste creusant avec entêtement son ornière ou son terrier, sédentaire jusqu’à la mort, on oppose le nomade impénitent, le baroudeur de charme, le bourlingueur romantique, l’adolescent prolongé qui ne se satisfait jamais du lieu où il fait halte, de la vie qu’il mène – accessoirement du livre qu’il écrit. Car sa soif d’absolu est à l’image et à la mesure de la route qu’il parcourt. Toujours disponible, sans attache, sans bagage, amours d’une nuit, amitiés de rencontre, libre comme l’air. Kérouac l’emporte haut la main…
Il est aisé de voir ce que, collectivement, nous projetons sur ces figures d’écrivains – d’abord un désir insatiable de nouveau et une soif de liberté, que nous attribuons à l’errant et dont nous croyons privé le sédentaire. Et nous jugeons d’un même souffle une œuvre littéraire et le mode d’existence de son auteur, celle-là à travers celui-ci. Mais ce champ de la littérature régionaliste que nous pensions si bien délimité perd vite ses repères. Songe-t-on à lui annexer les romans de García Márquez qui se déroulent dans un coin de Colombie ? Ceux de Faulkner parce qu’ils se fixent dans ce Yoknapatawpha County du Sud profond ? Alain-Fournier est-il un régionaliste parce que son Grand Meaulnes évolue dans un minuscule village ? Anne Hébert parce qu’elle a écrit Kamouraska ou Les fous de Bassan ? Mais, dira-t-on, Giono en ses débuts ? Et Ramuz ?
Rappelons simplement ici deux évidences. D’une part, dans toutes les littératures nationales, de la Suisse à la Finlande, de l’Argentine à l’Islande, de l’Allemagne au Canada, existe un fonds « terrien » qu’on peut nommer premier, élémentaire : qui dit « terroir » dit aussi « terreau », humus fécond. D’autre part, le régionalisme en littérature n’a que peu à voir avec l’enracinement d’un écrivain dans une « région » et avec son choix d’en faire l’objet de son œuvre. Mais il a à voir avec ce qui, souvent, le dépasse : la capacité de faire entrer le monde dans un petit coin de terre. Or, il lui arrive de faire vertu de ses limites et de son impuissance. Plus grave encore, il érige son infirmité en programme, en une « idéologie » exclusive, soupçonneuse, intolérante comme toute idéologie.
Pourrat a multiplié là-dessus les mises au point, où il rejoint Ramuz avec qui il en a souvent débattu. Non pas se complaire dans l’accidentel, le singulier, le pittoresque. Dans la littérature telle qu’il la conçoit et la pratique, il s’agit d’un « retour aux sources : forer en un point déterminé de façon à retrouver la nappe profonde. Connaissance et amitié de tout, un royaume agreste, celui de l’intelligence primitive ».
Pourrat n’a jamais dévié de cette ligne – cette ligne verte pour reprendre le titre d’un de ses essais. Avec la patience du marcheur, avec sa fatigue, avec la confiance et la foi de celui qui n’est pas un étranger parmi les hommes, et que toutes ses fibres relient au monde. Son regard va du sol qu’il foule, de la glaise, du rocher, de la plante, jusqu’à l’horizon, aux montagnes de brume fine, au vol des nuées. Le monde a une raison et un sens, l’homme une tâche.
Penser l’homme, bâtir la civilisation
Vialatte, encore, touche juste et résume : Pourrat ou « la poésie de la terre, les fins dernières de l’homme, l’esprit des civilisations ».
La terre, il la dit dans tous ses visages, ses couleurs et ses fureurs, ses ombres, son mouvement. La même – ce que l’œil du promeneur peut embrasser, à peine plus parfois –, et jamais la même. Imperceptibles variations, humeurs volatiles et forces, fondements inébranlables. L’écrivain reprend inlassablement la description, comme si elle était toujours à compléter ou à retoucher, et malgré le risque de revenir sur ses traces, avec un bonheur presque constant. Une fraîcheur du mot, une tournure de grammaire, la phrase attendue et qui, d’un coup se relève pour nous surprendre. Et l’image, nette, forte (qui évoque parfois Giono). Le paysage familier n’est jamais épuisé, parce qu’il vit et nous fait vivre : « D’un cap de bruyères, nous avons tout revu. La Sioule tournait à grandes voltes sous des cônes de brandes et de récifs. Cette fuite, ces flancs ondés du ravin, bruns et bis comme des tourtes, et là-bas ce lait bleu d’un canton reculé sous la nuée pluvieuse, composaient un paysage d’une étrangeté archaïque. Pour essayer d’entrer dans son secret de tristesse et de sauvagerie, nous mangions des baies de genièvre » (L’homme à la peau de loup).
Ainsi la description ne se replie pas sur elle-même, ne se complaît pas dans sa propre réussite, mais elle ouvre. Que ce soit vaste panorama ou modeste objet, un humain qui le manie, voilà la pensée lancée. À preuve ces livres-flâneries du regard et de la réflexion sans hâte. Le discours, menacé parfois de prolixité, se relève par la verve ou la malice. Dans Le chemin des chèvres, Pourrat présente son pays selon les détours d’une route, comme dans Au fort de l’Auvergne, L’aventure du Roquefort prend pour point de départ la fabrication du célèbre fromage, ou Dans l’herbe des trois vallées celle du papier de chiffon dans les moulins ancestraux pour réfléchir sur le mouvement des campagnes, la tradition des artisans, sur autrefois et maintenant, les maisons, comment on y vit – et sur la grande, l’obsédante question : pourquoi on vit.
« Sommes-nous sûrs de tenir la route ? » Cette phrase anodine ouvre l’un de ces parcours géographiques à la recherche d’une petite ville. Nous pouvons aussi comprendre : sommes-nous sur la bonne voie ? Une civilisation millénaire est en train de mourir : devons-nous tenter de la sauver, nous y accrocher, en nourrir nos nostalgies ? Pourrat a aimé de toutes ses fibres ces hommes et ces femmes, qui génération après génération, l’ont édifiée et maintenue. Il n’a, certes, jamais occulté leurs noirceurs : cupidité, autorité despotique du maître de maison, défense farouche de la terre possédée, vengeances recuites, dureté inentamable. Mais aussi, chez combien d’autres, l’humilité et l’humour, l’entraide, la compassion, le cœur grand ouvert. Leur travail qui les attache, parfois les accable, et qui leur donne des joies : par le soin attentif, la connaissance précise de ce qu’elle est et ce que l’homme peut lui faire donner, « mettre à fruit » la terre. Et un esprit de liberté qui souffle là-dessus, « la chanson, le rire, le bon courage… l’amitié, le sens de la vérité » (la phrase si souvent réécrite…). Tout ce qu’il faudrait transmettre à l’enfant pour qu’il devienne un homme.
Tout ce que Pourrat ne trouve plus dans la société moderne ! Ce qu’il a vu disparaître sous ses yeux dans les campagnes mêmes, dépeuplées, gagnées par la bureaucratie tatillonne, la politique, la loi effrénée du profit.
« L’ordre ancien, l’ordre nouveau ? Ha, macarelle ! Se disent sombrement les vieux ; il n’y avait qu’un ordre : faire au temps voulu de l’année ce que demandent le troupeau et la terre. Est-on paysan si l’on ne colle pas à cette grande affaire des champs et des saisons, sans rien savoir de la politique ? Une fois pour toutes on a craché sur ses paperasses et son jargon, ses parades et ses fanfares » (L’aventure du Roquefort).
Pourrat sait bien qu’on ne peut plus s’en tenir à cette philosophie sommaire pour organiser la vie collective. « Si la civilisation terrienne s’en va, c’est qu’il faut trouver mieux. » Mais quoi ? « La civilisation moderne vient prodigieusement de s’élargir, formidable et passionnante… Au temps où le paysan meurt, inventer la figure du terrien à naître », écrit-il en 1939. Pourrat nous a laissés là-dessus, sans doute en est-il resté là lui-même. Il ne propose pas des formes, mais un esprit, qu’il n’a cessé d’affirmer, selon lequel il a vécu.
Le paysan, il le voit dans le drame de la patience, dans « la ruse contre la nature et l’État » : il lui faut se défendre contre ce double envahissement. Pourrat semble avoir hérité du paysan – qu’il ne fut jamais – une méfiance profonde à l’égard des institutions, mais sa pensée politique ne va guère plus loin. La civilisation, c’est une autre affaire, autrement importante ! Elle ne peut se bâtir que si, à la fois, elle se nourrit par ses racines plongées dans le sol et si elle impose un ordre à la sauvagerie. Tous les hommes doivent se mettre à la tâche, toujours à reprendre, mais ils ne peuvent la réaliser par leurs seuls moyens : « Elle vient de loin, la suite des cruautés, des imbécillités, des erreurs. Le beau est de voir l’homme se délivrer – si lentement – de sa peur, pressentir la lumière. Mais pour qu’il la voie, il faudra qu’elle lui soit révélée… Et il sera hésitant à l’adopter. Quel faix païen de vieilles magies sanglantes il traînera durant des siècles » (L’homme à la peau de loup).
L’homme des origines, le paysan encore hier, est attaché à des croyances irraisonnées, des superstitions, des rites et des sorcelleries. Proche de l’inconscient, des puissances nocturnes, de l’animal, il possédait un savoir qui lui venait de ses sens déliés et de l’expérience accumulée. « La vraie carrière de l’homme, ne serait-ce pas d’aller de la vie visionnaire à la connaissance ? », mais, comme la révolution industrielle risque de le faire, sans que soit rompu ce lien élémentaire. « Lui l’intelligent, il semble né pour trouver le sens du monde, pour mener la vie à sa destination suprême, comme la plante est née pour inventer la poussée et, face au rayon solaire, étendre sa verdeur. » Et cette vérité, sens et destination suprêmes, lui est donnée par la Révélation chrétienne. Pourrat se place ainsi résolument dans le sillage de Péguy, pour qui l’ordre chrétien vient couronner l’ordre humain, mais cette vision de la lente, irrésistible poussée de la Création, de la montée de l’humanité vers son but ultime, a des résonances teilhardiennes. Curieuse coïncidence qui fait naître Pourrat et l’auteur du Phénomène humain dans la même région, presque en voisins… La ligne maîtresse de l’œuvre est là, sa pensée nourricière. Tôt découverte, elle sera retournée, développée, enrichie pendant plus d’un demi-siècle.
Recueillir, cueillir les contes
« Je ne suis pas doué comme l’était par exemple Jean Angéli [co-auteur de Sur la colline ronde], et je n’ai guère pour moi que de la ténacité et de la patience. » Elles l’ont bien servi !… Pourrat a pratiqué, à l’exception du théâtre, tous les genres littéraires. Les premières saynètes, anecdotes, vignettes sur la vie des campagnes auxquelles il accordait peu de valeur, constitueront en fait le germe de l’œuvre à venir. La suite de poèmes des Montagnards dont le sous-titre donne l’intention et l’essence – « Chronique paysanne de la grande guerre (mars 1916) » – participe de l’immense souffrance collective, du désespoir et de l’espoir. Pourrat ne poursuivra pas dans la tentative versificatrice, et sa veine lyrique s’exprimera avec une décision et un bonheur croissants dans la prose. Toujours il a eu en chantier quelque longue entreprise narrative et réflexive, souvent interrompue, fidèlement reprise.
Quelques jours avant sa mort, Pourrat met la dernière main aux derniers volumes du Trésor des contes. Il conçoit de bonne heure le projet de recueillir le plus grand nombre possible de ces contes qui courent dans les campagnes auprès de ceux – de plus en plus rares après 1918 – qui, laboureurs, artisans, bergers, veilles femmes à la veillée, les savent encore. Il écoutait avec patience, discrétion et notait dans son Cahier des promenades. Commençait ensuite le travail d’écriture, souvent interrompu par la rédaction d’autres textes ou par la maladie. Les 944 contes du Trésor ne composent qu’une partie du matériau recueilli, auquel s’ajoutent combien de fragments, chansons, proverbes, etc. Entreprise unique en France par son ampleur, l’équivalent de celle des frères Grimm en Allemagne, à laquelle Pourrat a donné toutes ses forces : il s’est fait un devoir de constituer « une somme de l’imagination paysanne ».
Cette imagination est d’une vigueur, d’une verdeur et d’une liberté dont aujourd’hui nous n’avons plus idée. Pourrat n’entendait pas procéder selon les méthodes scientifiques du folkloriste – on lui en a fait grief – mais rendre proches « un génie paysan, une fraîcheur, une roideur secrètement accordées aux herbes, aux arbres, aux températures, à toute la vie de la création ». Pour cela il faut écrire ces contes sans rien ajouter ni corriger, mais « prêter du style. Le problème est de ne les défigurer en rien mais de les écrire tels que les donnaient les mieux doués de ces conteurs ». Ligne difficile à tenir entre fidélité et tentation d’arranger, pour que le conte devienne œuvre littéraire, animer la platitude de la retranscription mais sans artifice. Un travail qui requiert art et abnégation. Et le miracle s’accomplit comme s’il allait de soi ! Il nous semble parfois assister à la naissance non de tel conte particulier mais à celle du récit lui-même ! Narration nette, économe, libre et cependant minutieusement réglée, relief de l’événement et des protagonistes, le mot surgi qui sonne clair et neuf, sans détour, comparaison hardie et juste, accord délectable entre l’attente comblée et la surprise, le dénouement prévu et la pirouette finale…
Ces contes nous parlent de ce que nous savons déjà, ou que nous croyons connaître, parce que nous l’avons lu. Des enfants abandonnés dans la forêt par leurs parents trop pauvres pour les nourrir, la méchante marâtre, l’ogre, le simplet qui réussit là où les habiles ont échoué, le Bon Dieu et ses saints, combien de variantes sur Cendrillon et Barbe-Bleue, sur les animaux secourables, les bonnes fées, les princes changés en crapauds, le roi qui veut marier ses filles… Ces contes venus de partout et de nulle part, déposés dans le folklore de tous les pays, dans une mémoire qui se moque du temps et de l’Histoire. Et puis les démêlés du paysan avec le Malin, dit Pied-Fourchu, dit Rapatou, toujours à l’affût et qui en est pour ses frais car pour duper un paysan, auvergnat de surcroît, il faut se lever de bon matin ! Combien d’anecdotes, de faits pittoresques ou drolatiques dont les campagnes étaient riches ! Elles mettent en scène les petites gens qui luttent contre la misère, mais qui savent rire aux dépens des maîtres trop avides, des mauvais riches, des curés un peu trop sûrs d’eux, des curieux, geignards, entêtés, grincheux, des habiles un peu trop habiles. Et il y a les mystères, les bêtes étranges qui dévastent les troupeaux et terrifient les hommes. Et encore les brigands, les fous et les sages.
La charité et la compassion ne sont pas toujours honorées, la justice l’est en général mieux, avec la patience et la confiance, et, à coup sûr, la ruse, l’invention, la débrouillardise : ce qu’il faut pour survivre. Ce qu’il faut aussi pour qu’un enfant sorte de l’enfance, qu’il devienne homme ou femme solides, respectés, et heureux. Âges et passages de la vie, épreuves et obstacles et comment on en vient à bout : toute une sagesse immémoriale dont nous pourrions faire notre profit.
Gaspard des montagnes : une somme
Ce gros roman peut être vu comme l’œuvre d’une vie. Trente ans s’écoulèrent entre le début du manuscrit (1918) et l’édition définitive (1948). Un cycle, Pourrat en parle lui-même comme d’une saga. Œuvre complexe et foisonnante, en laquelle il faut pénétrer à travers les couches successives.
Au premier degré, une histoire de brigands dont le vaillant Gaspard veut mettre en échec les menées. Rapts, guet-apens, disparitions, caches souterraines, incendies et poison, bastonnades, coups de fusil et de couteau dans des auberges sinistres, méchants et héros, comparses, complices et meneurs : nous sommes en pays connu, celui du romanesque truculent qui n’épuise jamais ses charmes. Mais pas seulement dans la fiction !
Dès les premières pages, le mécanisme s’enclenche. Au début du XIXe siècle, une ferme isolée des montagnes d’Auvergne. Anne-Marie Grange, toute jeunette et seule cette nuit, blesse à la main un inconnu qui s’est introduit dans la maison, mais elle ne peut voir son visage. L’homme disparaît et Anne-Marie vivra avec son angoisse. Un « Monsieur » se présente, gagne les faveurs du père Grange, bonhomme vaniteux et un peu obtus, qui lui donne sa fille. Ce M. Robert est en réalité l’homme aux doigts coupés. Il a juré de « faire crier grâce » à celle qui l’a blessé : il la viole, l’engrosse, la laisse presque morte et disparaît à nouveau. On le sait, il reviendra quelque jour parachever sa vengeance, quand ? Et Gaspard protège Anne-Marie sa cousine, avec l’espoir d’en faire sa femme.
La vraisemblance paraît ici un peu malmenée, mais c’est sans importance. On apprend au fil des péripéties que M. Robert voulait s’approprier un papier valant beaucoup d’écus dans une histoire compliquée de dette et de succession, qu’il a des complices de tout rang et des appuis bien placés. Et Gaspard apprend pour son malheur qu’Anne-Marie demeurera contre toute raison fidèle à l’époux criminel, même après que celui-ci eut ravi son enfant, leur enfant et qu’il eut commis d’autres meurtres.
Fantaisie imaginative, une variation de plus sur le thème de la vengeance et de la lutte contre les méchants, dans la tradition éprouvée du roman d’aventures – et roman qu’on peut juger dès l’abord bien chargé ? Non pas, ou pas seulement. Ces campagnes du Centre étaient dans leurs recoins peu sûres à l’époque du « grand Napoléon » (Gaspard ira dans ses armées), les cosaques y poussèrent jusque-là, mais surtout à la Restauration, de douteux aristocrates ou bourgeois y devinrent des chefs de bandes faisant coïncider savamment les intérêts de la monarchie avec les leurs. La dimension politique est ici très accessoire, mais nous sommes à peu près dans les mêmes entreprises et le même temps, sinon dans la même région de France, que les Récits de la demi-brigade de Giono. Pourrat a reconstitué cette tranche d’histoire, il a interrogé les vieux almanachs, les images d’Épinal, recueilli la tradition orale, et il a observé. Le travail de la terre, le mode de vie et les mentalités, dans cette campagne comme dans bien d’autres en France, n’ont que peu changé jusqu’à la dernière guerre : on dit bien que le paysan est attaché à la terre, dans la continuité et la stabilité, ou sous un autre angle, routine et stagnation.
Rien de moins idyllique que ces campagnes vues à travers Gaspard. Le tableau en est ici combien plus proche de Breughel que des bergeries de la reine Marie-Antoinette ! Des roulants de tout poil y rôdent, volent, parfois tuent. Et les pires de ces créatures ne sont pas toujours les pouilleux mais quelques respectables bourgeois. À l’abri derrière leurs belles manières, leurs belles demeures et la complicité des notables, ils manœuvrent, entassent l’or, guettant leur proie comme l’araignée dans sa toile. Et quelle galerie de sinistres portraits, toutes ces créatures du Mal, qui se donnent à lui et le proclament !
L’ombre est parfois opaque dans ce roman, celle des êtres qui ont partie liée avec les puissances noires, celle des bois, du brouillard, des marécages, des landes, des loups qui y paraissent dans les hivers les plus durs, des hommes qui le deviennent la nuit pour courir la galipote. Sorciers et jeteurs de sort, créatures surnaturelles comme ce Chasseur de la nuit (titre d’un autre roman) qui apporte le malheur. Des présences innommables attendent leur moment pour bondir sur l’infortuné. Pays où les menaces viennent de très loin, de ces anciennes forêts qui couvraient la Gaule, des premiers âges quand l’homme était exposé à l’inconnu du monde. Pays de la peur, avec laquelle le paysan doit vivre et qu’il doit conjurer. À la sauvagerie il doit opposer son ordre.
C’est dans cette perspective que Gaspard prend sa pleine stature de héros. Il laboure, abat les arbres, ouvre des chemins, fait du négoce jusque dans les provinces éloignées. Existe-t-il une besogne ou une affaire ou un mystère à son épreuve ? Sa science paraît innée, ses ressources comme ses inventions sans limites. En toute circonstance il sait que faire, ou bientôt il le saura. Il est de ces hommes rares par qui le pays peut franchir un pas vers le mieux-être, vers plus de justice. Il en est l’inspirateur, la référence morale, l’âme. Le goût de la farce le saisit parfois et avec quelques compagnons, joyeux lurons, il fait taire une commère trop fureteuse et ouvrir les greniers de gras bourgeois en temps de disette. Tour à tour conseiller, juge et redresseur, il est le chevalier Lancelot et le roi Salomon, et aussi un peu Robin des Bois. Mais parfois des fureurs le poignent, une rage qui fait peur, contre les malfaisants, contre le mal, contre les tourmenteurs d’Anne-Marie, contre ce M. Robert devenu son rival. Le récit évoque alors à demi-mot des rixes et des tueries dans des auberges coupe-gorge, ou des années de soldat quelque part en Russie. Ou bien on devine que Gaspard court les routes et les filles quand le désespoir le saisit. Car cette Anne-Marie unique ne sera jamais sa femme. À mesure que l’action, d’abord lâche, se resserre et se tend, Gaspard en est venu à un point où il ne comprend plus, où il refuse. Il s’enfonce alors dans une noirceur mauvaise, et le roman s’assombrit, mais c’est pour que le livre et le personnage changent de niveau.
Dans ce pays qui se satisfait si bien de ses routines, en ces cœurs qui, si l’on n’y prête garde, se durcissent, Gaspard a longtemps porté la lumière de la raison, de la justice et de la « vaillance ». Face à lui, avec lui, dans « l’amitié », Anne-Marie vit dans l’angoisse, le poids de la responsabilité – son père, sa sœur Pauline, le domaine, puis l’enfant perdu et retrouvé –, la solitude quotidienne. Sa volonté de demeurer fidèle à l’homme indigne qui l’a épousée paraît absurde entêtement, sens du devoir injustifiable, mais avec ce personnage nous ne sommes plus dans le domaine de la psychologie, ni même dans celui de la morale. Anne-Marie porte une autre lumière, comme, symboliquement, les vierges sages de l’Évangile, qui lui permet de lire les âmes, de les aimer. Tout faire, au risque de sa vie et, à coup sûr, de son bonheur, pour que l’époux criminel se repente, pouvoir le sauver. Dans l’épisode final, incendie du domaine, règlement de compte entre Robert avec ses complices et Gaspard avec ses compagnons, Robert tire sur l’enfant et la mère, et les tue, avant de mourir. Gaspard demeure seul, il a gagné, il a perdu. Il comprend alors à quoi Anne-Marie a voulu le conduire, lui aussi.
Ainsi parvient à son dénouement ce livre en quoi s’unifient tableau de mœurs, récit d’aventures, drôleries et drames, crimes et hauts faits, conte, épopée et poème. Se résout-il finalement en une tragédie implacable où la mort a le dernier mot ? « Après la nuit affreuse, les cris, les coups, dans le rougeoiement de l’enfer, la course à travers le noir et la folie – c’est le jour. Est-ce donc vrai qu’il faut croire à l’amitié des anges ? Il n’ose pas bouger, n’ose pas espérer. » Et cependant… « Voici Pauline au haut des trois marches, encore en larmes, qui sourit. » Ce n’est pas l’ultime détour du récit pour que le happy end soit préservé, mais une profession de foi. Dans ce soleil matinal qui teinte d’or et de rose les vastes courbes des prairies, vers les montagnes, dans ce vent qui sent le thym, Gaspard et le lecteur vivent l’immense, l’inépuisable jeunesse du monde.
La ligne d’horizon
L’œuvre de Pourrat nous rappelle quelques vérités premières. Si – avec quel art ! – elle charme, enchante, si elle divertit, ce n’est pas dans le sens édulcoré où nous prenons ces termes : elle nous ramène à nous-même. Restaurer notre perfection du monde, par le regard et par tous nos sens. Restaurer l’usage que nous faisons de la langue, devenue outil indifférent, frappée d’anémie, d’inertie. Pourrat dit bien que, comme le conte, il faut qu’elle vive.
Tout dans son œuvre se tient autour de cette exigence, et rien ne lui échappe. Pourrat n’est pas un manieur de concepts. Rien de plus sensible, de plus charnel que sa parole. Quand il pense civilisation ou économie, il voit non pas des masses régies par des graphiques, des normes chiffrées, des statistiques mais des personnes rassemblées dans le travail quotidien ou le loisir, sur un petit coin de terre, dans un pays, sur la planète. Des êtres d’hier et d’aujourd’hui qui se débrouillent comme ils peuvent : « Si nous savions songer à eux comme il le faudrait, à tant d’années, à tant d’humains sur ce pays ! À tant de bon vouloir, à tant de peine humaine. Au lent drame sans tragédie de tout cela. »
L’œuvre en son entier raconte l’histoire d’un effort toujours à reprendre contre le mal partout répandu, celui qui est dans le cœur de l’homme, qui l’enchaîne et qui l’abaisse alors qu’il est appelé à tellement mieux ! Appelé à vivre dans l’amitié, et qui parfois y parvient un peu, un peu plus. « Hausser la vie », dit Pourrat, participer à « la montée vers le Règne ». Gaspard, les contes, ces livres où la mémoire plonge loin, tous se rassemblent en une méditation sur ce qu’est la vie, sur ce qu’elle pourrait, devrait être si nous laissions la lumière du Jardin la mener. La littérature elle-même est peut-être ainsi une tentative pour « trouver l’incantation qui rend toute chose transparente ».
Henri Pourrat a publié entre autres :
Gaspard des montagnes, Livre de poche, 2 vol., Paris 1984 (ou édition en un volume, Albin Michel, Paris, 1960) ; Trésor des contes, Gallimard, Paris, 13 vol., 1948 à 1962 (nouvelle édition en 7 vol. thématiques, Gallimard, Paris, 1977 à 1986) ; Le chasseur de la nuit, Albin Michel, Paris, 1951.
Ouvrage sur Henri Pourrat : Pierre Pupier, Henri Pourrat et la grande question, Le sang de la terre, Paris, 1999 (une excellente biographie-étude).