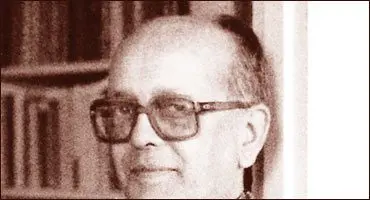Le recueil de nouvelles La mort exquise, de Claude Mathieu, ne suscite aucune surprise chez les lecteurs d’aujourd’hui : cette œuvre s’inscrit parfaitement dans la production des nouvellistes des années 1980 et 1990. C’est pourtant au milieu des années 1960 que ce recueil fut publié pour la première fois…
Écrivain peu connu et d’une production restreinte, Claude Mathieu aurait pu définitivement sombrer dans l’oubli, ne suscitant que des mentions brèves dans les histoires littéraires, quand il n’en est pas complètement écarté1. Sa « survie institutionnelle », en fait, tient à l’étrange parcours de sa dernière œuvre, La mort exquise, qui est peu à peu exhumée dans les années 1980 par des relectures et des rééditions. Et à juste titre.
De formation classique, Mathieu s’intéressera toute sa vie à la littérature, autant par son enseignement au collégial que par ses publications, qui ne s’étalent cependant que sur une décennie au début de sa carrière. Fréquentant Gilles Archambault et Jacques Brault lors de ses études, il signe avec ce dernier et Richard Pérusse son premier ouvrage, un recueil collectif de poèmes, genre qu’il délaisse ensuite au profit de la prose. Son style s’affirme dans un recueil tout à fait étonnant pour la période, Vingt petits écrits ou le mirliton rococo, où alternent fictions et essais. Baroques et fantaisistes à souhait, ces textes présentent un détachement et une ironie qui leur ont permis de ne pas trop vieillir – d’une nouvelle fantastique à propos de l’oncle Gustave à la description stylisée d’un hot dog, en passant par la démonstration de l’érotisme du dentier et de la poésie – et laissent voir l’humour de Mathieu qui caractérisera son seul roman, Simone en déroute, publié quelques années plus tard. Au cœur du contexte moral en mutation des années 1960, ce roman présente l’histoire cocasse d’une veuve que la déception amoureuse avec son jeune domestique rapprochera de son fils. Recourant au genre « consacré », Mathieu manque de peu le Prix du Cercle du livre de France en 1963 qui l’aurait peut être inscrit au panthéon de la littérature québécoise2. Il publiera deux ans plus tard sa dernière œuvre, le recueil de nouvelles La mort exquise, héritier de l’ironie qui a marqué sa production antérieure mais qui refuse la classification habituelle dans le contexte socio-historique québécois.
En marge
La « distance » semble bien illustrer la position assumée par Claude Mathieu avec cette dernière œuvre. Que cette position soit volontaire ou non, le résultat demeure : la pratique littéraire de Mathieu paraît marginale. Proposant des textes qui ne mentionnent aucun lieu particulier, sinon exotique ou imaginaire – la Bithynie ou ce royaume consacré à l’archivage de tous les écrits du monde –, il se tient loin de la représentation de la collectivité pourtant courante et reconnue dans les années 1960. Ses personnages ne luttent pas contre des institutions, ne contestent pas des valeurs ; ils sont plus souvent des ascètes, des scientifiques plongés dans leurs recherches, détachés des plaisirs du monde. Ce détachement semble contraire à l’engagement de la littérature de cette époque, lourde d’une transformation à accomplir, passage d’une culture et d’une société canadiennes-françaises archaïques à la modernité québécoise. Il se manifeste tout autant dans le refus de la couleur locale : le français n’est pas joual mais standard, international ; le fantastique qui caractérise ses textes ne recourt pas à des figures folkloriques (comme le font Yves Thériault et Jacques Ferron dans une certaine mesure) mais tient plutôt du réalisme magique des Sud-Américains, d’un fantastique qui fait intervenir dans le réel des éléments merveilleux non problématiques, compatibles avec les événements en cours (la renaissance cyclique souhaitée par un personnage, par exemple).
Délaissant la pratique littéraire canonique – le roman – qui lui avait presque apporté une marque de reconnaissance par ses pairs, Claude Mathieu préfère la nouvelle, un genre mineur peu pratiqué à l’époque, même si quelques têtes d’affiche réussissent tout de même dans cette voie : Anne Hébert, Jacques Ferron, Andrée Maillet, Félix Leclerc, Madeleine Ferron Si une partie de ces auteurs sont attirés par la forme du conte, riche de ses racines canadiennes-françaises, et par son fantastique, ancré dans le décor québécois, la plupart optent pour le roman et la représentation du social. Proposant des textes parfois ironiques, parfois sombres, offrant des portraits du travail d’érudit, Mathieu s’écarte manifestement de la thématique habituelle des nouvellistes des années 1960, qui s’inspirent davantage des réalités antérieure et contemporaine du Québec. Singularité qui s’exprime encore dans le choix d’un genre littéraire marginalisé, la nouvelle étant alors considérée comme un exercice d’écrivains pas encore romanciers.
Nul n’est étonné qu’ainsi éloignée des standards littéraires des années 1960, La mort exquise soit assez mal reçue par ses contemporains. Jugée généralement froide – écriture très précise, distance avec la réalité concrète –, l’œuvre intrigue et dérange. Cependant, en conformité avec la conception de la nouvelle comme exercice de style, on dit de ces textes qu’ils sont intéressants à lire, tout au plus, comme si l’on attendait une œuvre majeure (un roman !) où les qualités d’écriture seraient réellement mises à profit.
En avance
Les lecteurs de nouvelles, eux, ont su retourner à ce recueil important. À partir du milieu des années 1980, des relectures de La mort exquise révèlent – à la façon d’une fouille archéologique comme dans « Le pèlerin de Bithynie » – l’existence d’une œuvre forte restée méconnue3. Faut-il croire que la mort de Claude Mathieu en 1985 ait contribué à cet intérêt ? Probablement, tout comme l’hommage que Gilles Archambault lui rend alors dans les journaux et les revues. Le revirement intervient cependant avec la réédition du recueil par L’instant même en 1989. Dixième titre publié en trois ans par l’éditeur spécialisé en nouvelles, La mort exquise côtoie les œuvres de Gilles Pellerin et de Bertrand Bergeron comme s’il s’agissait d’un inédit. Vingt-cinq années séparent pourtant Mathieu de ses successeurs, longue période pendant laquelle les pratiques d’écriture au Québec ont considérablement évolué.
La redécouverte repose de toute évidence sur cette parenté – devrions-nous parler d’ascendance ? Pratiquant une prose inspirée de Borges et de Mandiargues, délaissant le folklore pour revenir aux mythes fondateurs (Cybèle, la mère des dieux, et le retour cyclique des âmes), Mathieu proposait déjà en 1965, bien avant l’heure, une manière de travailler la nouvelle et le fantastique que les écrivains de L’instant même font leur, à tout le moins reconnaissent comme proche parente de leur conception du genre bref. L’insertion du fantastique, tout comme chez Bertrand Bergeron, demande un travail important sur le langage pour instaurer de façon habile la tension entre le réel et l’irréel. Aussi l’étude des plantes carnivores par Hermann Klock, dans La mort exquise, est-elle rehaussée par la narration d’un style lyrique, ponctuée d’interrogations qui déplacent l’intérêt des détails de l’événement surnaturel vers les perceptions et les réflexions extatiques du personnage. Ce soin apporté à la langue, typique de cette génération d’écrivains qui publient à L’instant même, s’observe dans tout le recueil, dans ces variations stylistiques et narratives justifiées par la recherche d’effets très précis : dépersonnalisation du protagoniste dans cette « Autobiographie » rapportée au « il » ; attestation publique, par une lettre ouverte signée par un ami, de l’authenticité du travail d’un écrivain accusé de plagiat (« L’auteur du Temps d’aimer ») ; écriture technique et historicisante de la « Présentation de la Bibliothèque », etc. Loin d’une conception anecdotique de la nouvelle, à mille lieues de l’histoire banale, la prose de La mort exquise présente une belle variété formelle tout en s’inspirant du mélange de réalisme et d’incertitude qui caractérise à la fois le réalisme magique des Sud-Américains et une certaine part de la production des nouvellistes des années 1980 et 1990. Claude Mathieu compte également sur un fonds de motifs connus ou classiques pour entrer en filiation avec la tradition littéraire. Ses « emprunts », provenant de fictions borgésiennes dans plusieurs cas, ne sont pas de simples transpositions, mais bien des re-créations, tant les formules sont renouvelées. Le passage inédit d’un livre ancien, comme celui du Rufus Itinerans dans « Le pèlerin de Bithynie », s’apparente à l’entrée de dictionnaire sur Uqbar chez Borges ; plutôt que de « créer » un monde nouveau comme Tlön, les informations révélées conduisent le personnage de Mathieu à réintégrer sa séquence de réincarnations. De la même façon, la lente mort sociale de Rachel peut évoquer la transformation de Grégoire Samsa dans La métamorphose de Kafka (« Les dîners chez Rachel ») ; à la manière du Portrait de Dorian Gray de Wilde, une antiquaire recherche son image dans diverses œuvres d’art dans lesquelles elle vit littéralement (« Fidélité d’un visage ») ; le plagiat de « L’auteur du Temps d’aimer » n’est pas sans rappeler, dans une version fantastique, le fabuleux « Pierre Ménard, auteur du ‘Quichotte’ » de Borges…
Cette inventivité formelle et thématique, plutôt rare avant les années 1980, se joint à un intérêt commun pour le fantastique-réaliste qui expliquerait l’intégration spontanée de Claude Mathieu, même avec deux décennies d’écart, dans l’écurie de L’instant même4. Gilles Pellerin, dans sa postface de la réédition de 1989, est bien conscient de la nécessité de faire renaître l’œuvre de Mathieu : « Qui se sera avisé que le livre a d’abord paru en 1965 se dira que le temps est bien fantasque qui autorise les anachronismes les plus suaves. Car il s’agit bien d’anachronisme, de nouvelles attaquées [dans l’acception musicale du terme] sur le temps faible, d’un recueil jeté dans une époque où chez nous on en écrivait peu et qui d’ailleurs, est-on rétrospectivement tenté d’ajouter, n’en a pas voulu. » Pellerin rétablit l’anachronisme en republiant les nouvelles dans une période plus favorable – la fin des années 1980 est le moment culminant de la reconnaissance du genre –, et contribue à assurer, rétrospectivement, une place dans l’institution littéraire au précurseur qu’a été Mathieu. Seule réédition d’un recueil québécois à L’instant même, La mort exquise y jouit d’un statut très particulier, celui d’une œuvre dont la renaissance était nécessaire et, oserait-on dire, programmée.
Mort et littérature
Le destin du recueil semble être calqué sur le motif récurrent qu’il met en place : la mort nécessaire, qui met un terme aux contraintes physiques, mais où la continuité, la conservation des idées, des esprits est assurée. L’inscription dans la pierre en Bithynie permet au protagoniste de poursuivre son cycle de vie ; la préservation des écrits dans la bibliothèque – tâche sacrée – certifie la perpétuation de la collectivité ; les manuscrits possédés par le docteur Larocque, heureusement, sont recueillis pour éviter leur dispersion (« L’auteur du Temps d’aimer »)… L’écriture joue un rôle majeur dans la survie : assurance d’une permanence, elle transcende les impondérables, autant pour l’auteur que pour son œuvre. « Qui a écrit ne meurt pas tout à fait. Et ce qui de lui ne meurt pas n’est pas le moins essentiel. En plus, si l’œil d’un lecteur le lui permet, il fera plus qu’échapper à la mort, il vivra ». (« Les livres, les pierres, le temps ».)
1. À titre indicatif, Mathieu ne figure pas dans la liste de plus de 670 auteurs québécois recensés et documentés dans le site L’Île, Centre de documentation virtuel sur la littérature québécoise (http ://www. litterature. org).
2. Encore qu’un prix important à l’époque, le Prix du CLF ne peut cependant pas donner à une œuvre l’universalité nécessaire pour traverser les âges. À preuve, le roman qui remporta le prix cette année-là, Amadou de Louise Maheux-Forcier, reste aujourd’hui aussi peu connu que Simone en déroute.
3. Signalons la notice rédigée sur cette œuvre par Michel Lord dans le quatrième tome du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (Fides, 1984) ainsi que l’inclusion de deux nouvelles du recueil dans une Anthologie de la nouvelle et du conte fantastiques québécois au XXe siècle, constituée par Maurice Émond (Fides, 1987).
4. La réédition en 1989 et sa publication en format de poche en 1997 en témoignent bien. De la même façon, l’intégration d’un texte de La mort exquise dans l’anthologie de nouvelles fantastiques publiée à L’instant même, Le fantastique même (1997), illustre également l’appartenance forte qui s’est développée au moment de cette réédition.