En 1903, dans le Daily Express, James Joyce rend compte du roman The House of Sin, version anglaise de La maison du péché, paru un an plus tôt aux éditions Calmann-Lévy1. Il en loue la nouveauté et rend hommage au talent de son auteure, Marcelle Tinayre.
Journaliste, chroniqueuse, conférencière et surtout romancière, Marcelle Tinayre fut très populaire en son temps. En 1934, Pierre Trintignac parlait d’ailleurs, dans Le Courrier du Centre, de l’injustice qu’il voyait à ce que « ces livres humains et forts qui s’appellent La maison du péché, La vie amoureuse de François Barbazanges, La rebelle et L’ennemie intime » tombent dans l’oubli. Il n’empêche que le nom de Marcelle Tinayre, auteure de plus de vingt titres, n’apparaît dans aucune anthologie d’importance2 et reste méconnu du grand public.
De bons auspices féminins
Fille de la petite bourgeoisie provinciale, Marcelle Tinayre, qui naît à Tulle (Limousin) le 8 octobre 1870, fut entourée de femmes intelligentes. Sa mère, institutrice puis directrice d’école, encouragea les succès scolaires de son enfant qui, en 1888, remporta l’oral de son baccalauréat avec la mention « bien » ; ce jour-là, elle était la seule fille. Vint ensuite la rencontre déterminante avec sa belle-mère, Victoire Tinayre, elle aussi investie dans le milieu éducatif, mais surtout anarchiste, syndicaliste et communarde3.
Marguerite Durand, rédactrice en chef de La Fronde, lui ouvrit les colonnes de son journal, auquel elle collabora régulièrement de 1898 à 1901. Comme nombre de ses consœurs – Lucie Delarue-Mardrus, Gabrielle Réval, Séverine, retrouvées pour certaines à la création du prix Vie heureuse (devenu le prix Femina) –, Marcelle Tinayre associa, sa vie durant, journalisme et fiction, ne serait-ce que pour subsister en périodes de vaches maigres.
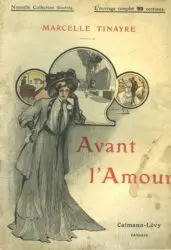 C’est enfin Juliette Adam, directrice de La Nouvelle Revue, qui, en 1897, appuya la publication de son premier livre, Avant l’amour. Marcelle Tinayre n’oublia pas ce qu’elle devait à ces aînées, même si elle se méfia toujours des regroupements hâtifs : « Certes les femmes ont du talent, mais pourquoi toujours les comparer entre elles ? On nous laisse dans notre cage aux singes ensemble et c’est une manière de nous prouver qu’on ne met pas notre talent à hauteur de celui des hommes4 ».
C’est enfin Juliette Adam, directrice de La Nouvelle Revue, qui, en 1897, appuya la publication de son premier livre, Avant l’amour. Marcelle Tinayre n’oublia pas ce qu’elle devait à ces aînées, même si elle se méfia toujours des regroupements hâtifs : « Certes les femmes ont du talent, mais pourquoi toujours les comparer entre elles ? On nous laisse dans notre cage aux singes ensemble et c’est une manière de nous prouver qu’on ne met pas notre talent à hauteur de celui des hommes4 ».
Dans ses premiers romans, elle déploya sa connaissance d’un milieu (la petite bourgeoisie parisienne des années 1890-1930), s’intéressa aux questions sociétales (égalité hommes-femmes, émancipation par le truchement du travail) et dénonça l’hypocrisie bien-pensante et le poids des préceptes religieux. Elle écrivit sur le désir, créa des héroïnes à qui la maternité ne suffisait pas, qui revendiquaient leur liberté et leur indépendance sexuelle et économique. C’est à ces mêmes femmes qu’elle pensa dans ses articles, prônant l’éducation et l’amélioration des conditions de vie plus que l’obtention des droits civiques. Les femmes toujours fournirent matière à ses conférences : Madame de Pompadour (en 1922, 1923 et 1927), Madame Roland (en 1922), les Merveilleuses5 (en 1929), Joséphine de Beauharnais (en 1930).
L’âge d’or de l’écrivaine va de ses débuts, dans la deuxième moitié des années 1890, à la Première Guerre mondiale. On compte ainsi 40 éditions de La maison du péché (1902), tandis que Hellé (1899) atteint 110 000 exemplaires en 1916 et que, l’année suivante, on voit la 73e réédition de La rebelle (1905). Elle explora les genres, allant du roman historique (Perséphone en 1920, Le bouclier d’Alexandre en 1922, les Gérard et Delphine en 1936 et 1938) au roman régional (Château en Limousin en 1934), en passant par la nouvelle (L’amour qui pleure en 1908), le récit de voyage (Notes d’une voyageuse en Turquie en 1909 et Terres étrangères en 1928) et la biographie romancée (La vie amoureuse de Madame de Pompadour en 1924). Signalons aussi La veillée des armes (1915), qui restitue très finement l’atmosphère des mois qui suivirent la mobilisation générale de 1914.
Outre l’élégance de l’écriture, son ironie malicieuse, on perçoit bien toute l’acuité du regard que porte l’auteure sur l’ordre social propre à son temps. En 1915, dans la Revue des Deux Mondes, René Doumic juge d’ailleurs que « ses romans sont modernes, d’un modernisme aigu ». À ce titre, le roman tinayrien a valeur de témoignage parce que, si l’auteure s’est toujours méfiée des dogmes : « Je ne suis pas d’accord avec toutes les femmes qui ont entrepris de défendre la cause des femmes, mais si les procédés me paraissent discutables, la cause elle-même me semble juste6 » et si elle n’a pas toujours su ou pu éviter les ornières du conservatisme (durant l’Occupation, elle contribua par une chronique à Voix françaises, un hebdomadaire catholique ouvertement pétainiste), elle n’a cessé de mettre son talent au service des femmes.
Marcelle Tinayre s’est éteinte à Grosrouvre (Yvelines) le 23 août 1948. Outre une œuvre conséquente, elle laisse une trace dans le ciel, un astronome anglais ayant baptisé en son honneur la planète qu’il avait découverte en 1912 !
Illustration en trois exemples
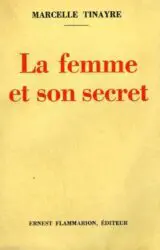 Les trois textes retenus ci-après nous donnent un aperçu de l’écriture tinayrienne : Avant l’amour (1897), qui sacre Tinayre romancière et introduit les thématiques qu’elle va creuser tout au long de sa carrière ; La rebelle (1905), l’un de ses plus grands succès, considéré en outre comme le plus explicitement féministe de tous ses romans ; La femme et son secret (1933), qui nous renseigne sur l’évolution de ses opinions dans un contexte national généralement moins favorable aux femmes et au féminisme.
Les trois textes retenus ci-après nous donnent un aperçu de l’écriture tinayrienne : Avant l’amour (1897), qui sacre Tinayre romancière et introduit les thématiques qu’elle va creuser tout au long de sa carrière ; La rebelle (1905), l’un de ses plus grands succès, considéré en outre comme le plus explicitement féministe de tous ses romans ; La femme et son secret (1933), qui nous renseigne sur l’évolution de ses opinions dans un contexte national généralement moins favorable aux femmes et au féminisme.
Le premier roman de Marcelle Tinayre s’intitule Avant l’amour. Âgée de huit ans, Marianne Taverly est recueillie par la famille Gannerault. Confrontée à la petitesse d’esprit de Marie Gannerault (chez Tinayre, les figures maternelles sont rarement peintes sous des couleurs positives), elle refuse tout endoctrinement religieux. (Tinayre approfondira ce thème avec le personnage de Fanny Manolé, l’héroïne de La maison du péché.) À l’adolescence, Marianne s’éprend d’un jeune compositeur à qui elle adresse une longue lettre sensuelle et passionnée. La manœuvre est découverte, tandis que le compositeur, premier d’une longue liste de personnages masculins de Tinayre plutôt veules, se révèle un pleutre. Marianne se rapproche alors de Maxime, le fils de la maison Gannerault. Dans de grandes envolées, les deux jeunes gens dénoncent les travers d’une société hypocrite et falote, mais leurs rapports sont compliqués. À la suite d’une dispute mais aussi par vanité, Marianne flirte avec un aristocrate, M. de Montauzat, dont elle comprend qu’il ne voit en elle qu’une proie destinée à satisfaire ses pulsions libidinales. Le lien de Marianne avec Maxime se renforce. Amoureux, Maxime la pousse à se donner à lui, et, exaspérée, Marianne finit par céder. Bientôt conscient de la gravité de l’acte, mesurant ses conséquences sur l’avenir de la jeune fille, et saisissant que Marianne ne partage pas encore pleinement ses sentiments, Maxime part pour l’Amérique afin d’en revenir digne d’elle. À l’issue du roman, Marianne, sereine, attend le retour de son « compagnon ».
Ce roman annonce le triple totem de la thématique tinayrienne : la femme, l’amour et la liberté. Les joutes entre Maxime et Marianne ainsi que la complexité de leurs rapports – où se mêlent jalousie, possessivité, amour et haine – permettent à la romancière de dépeindre les difficultés existentielles et sentimentales de deux jeunes gens cherchant à se définir, et à s’unir, dans une société qui leur est foncièrement hostile. L’auteure y dénonce en outre les prérogatives dévolues aux hommes libres d’exprimer leur désir parce que légitimé médicalement, socialement et économiquement (Marianne est une jeune fille pauvre et illégitime ; Montauzat est un aristocrate). Elle y enfourche, enfin, un de ses chevaux de bataille : la dénonciation du culte de la virginité féminine magnifiée pour mieux réduire, enfermer et chosifier la femme. Une telle représentation ne plaira pas à tout le monde, le critique Jean Nesmy reprochant à Marcelle Tinayre de compter parmi les artistes ayant « fait le serment de ne jamais écrire une œuvre morale ».

Publié quelques années plus tard, La rebelle est le septième roman de l’auteure. Il raconte les aventures professionnelles et sentimentales de Josanne Valentin. Mariée à dix-huit ans à un mari malade et acariâtre, Josanne cumule les petits emplois pour subvenir aux besoins du ménage. Puis elle fait la connaissance d’un jeune ingénieur féru de poésie, Maurice Nattier. Une liaison s’ensuit et avec elle, la naissance du petit Claude. Mais Maurice abandonne Josanne et l’enfant pour un mariage d’argent. Veuve, et devenue rédactrice au Monde féminin, Josanne rencontre l’écrivain et essayiste Noël Delysle. Une relation d’amitié puis d’amour se noue. C’est le moment où Maurice, dont l’épouse ne peut avoir d’enfant, reprend contact avec Josanne, poussant celle-ci à avouer son passé à Noël. La révélation est mal reçue. Pris dans les affres de la jalousie, Noël en vient même à rejeter le petit Claude qui, dans la foulée, tombe gravement malade. Mais le désespoir de Josanne face à la maladie de son fils rapproche les amants. Claude guérit et Noël est en mesure d’accepter Josanne pour ce qu’elle est, et non pour ce qu’il voudrait qu’elle soit. Le roman se clôt sur une promesse de mariage.
Généralement considéré comme le plus ouvertement féministe des romans tinayriens, La rebelle aborde de nombreux thèmes et sous-thèmes : féminisme, adultère, situation des filles-mères, viol conjugal, avortement, jalousie et, enfin, intégrité et courage féminins par opposition à incohérence et hypocrisie masculines. Noël Delysle, qui s’estime féministe et progressiste, a le plus grand mal à réconcilier les idées qu’il professe dans son livre La travailleuse et l’indépendance revendiquée par Josanne. La rebellerencontra un grand succès critique et populaire. Émile Faguet y décela, dans La Revue latine, « une psychologie très fine et très ferme, beaucoup d’observation et du style, le tout dans la plus grande aisance », jugeant en outre les personnages secondaires « excellents ».
Au début des années 1930 paraît chez Flammarion La femme et son secret. Âgée de 63 ans, Marcelle Tinayre tire parti de sa notoriété de femme de lettres établie et reconnue ; elle succède d’ailleurs cette année-là à Juliette Adam à la tête de La Nouvelle Revue. « Ni un plaidoyer pour la femme, ni un réquisitoire contre la société, ni un cahier de revendications, ni une thèse féministe, ni une leçon de morale », écrit-elle dans l’avant-propos, l’ouvrage épouse une structure « biochronologique » (le corps féminin, de la petite enfance à l’âge mûr). Il mêle exemples vécus et références littéraires, analyses abstraites et conseils aux ménagères, poncifs et objections, illustrant le positionnement idéologique de l’auteure : « Je suis féministe à ma façon, qui est toute française ». Auguste Bailly en fit une critique plutôt positive dans l’hebdomadaire Candide : « Je n’ai fait qu’effleurer, cursivement, quelques-uns des chapitres de ce livre délicieux ; c’est un foisonnement d’idées personnelles, souvent très hardies, et qui sont exprimées dans une langue toute classique, par sa sobriété et sa pureté7 ».
En fait d’idées hardies, on retient surtout de l’ensemble un discours plus conventionnel quant au rôle et à la place des femmes dans la société française. Un an après la parution de cet essai, Marcelle Tinayre écrira même, dans le journal La Voix des familles, que « le travail de la femme mariée, à l’exception de celles qui ont un talent particulier, une vocation [à qui pense-t-elle ici sinon à ces « femmes d’exception » au nombre desquelles elle entend bien compter ?], est peut-être nécessaire dans certains cas, mais c’est une nécessité désolante, contre nature. Une société construite sur cette base est en déséquilibre8 ». Balayées, les Josanne Valentin ! Place aux Juliette Drouet mues par « le puissant instinct de la servitude amoureuse, ressort de tout grand amour féminin », écrit-elle dans La femme et son secret. Autre aspect frappant de l’essai, les très nombreuses références à l’Ancien Régime, période qui a indubitablement fasciné Marcelle Tinayre – les thèmes de ses conférences l’illustrent d’ailleurs bien – et dont, en matière de rapports genrés, elle semble avoir gardé la nostalgie. Reflet enfin du contexte sociopolitique entourant la parution de l’ouvrage, des saillies chauvines contre les Anglais, les Russes et les Allemands. La Grande Guerre, bien sûr, est passée par là, et l’aube du fascisme s’est levée. Peut-être Marcelle Tinayre avait-elle jugé que l’audace et la spiritualité frondeuse de ses débuts n’étaient plus de mise en ces temps d’inquiétude ?
De l’anarchiste Victoire Tinayre aux filles-mères de La rebelle, en passant par les typotes du Monde féminin et les occupantes des harems de Turquie, Marcelle Tinayre a écrit les femmes. Elle a rendu hommage à George Sand, Renée Vivien, Madame de La Fayette et Madame de Pompadour. Bourgeoise, elle s’est affirmée anarchiste tout en « nostalgisant » l’Ancien Régime et en s’adonnant sur le tard aux sermons pétainistes. Farouchement attachée à sa liberté, curieuse du monde, lucide, mais parfois aussi velléitaire, élitiste et paradoxale, Marcelle Tinayre nous laisse une œuvre foisonnante témoignant des contradictions d’une femme qui, moins encline à transformer le monde qu’à le commenter, a donné un corps, un visage et une voix aux femmes de son temps.
Marcelle Tinayre a publié :
Avant l’amour, Mercure de France, Paris, 1897.
La rançon, Calmann-Lévy, Paris, 1898.
Hellé, Calmann-Lévy, Paris, 1899.
La maison du péché, Calmann-Lévy, Paris, 1902.
La vie amoureuse de François Barbazanges, Calmann-Lévy, Paris, 1903.
La rebelle, Calmann-Lévy, Paris, 1905.
L’amour qui pleure, Calmann-Lévy, Paris, 1908.
Notes d’une voyageuse en Turquie, Calmann-Lévy, Paris, 1909.
L’ombre de l’amour, Calmann-Lévy, Paris, 1909.
La veillée des armes, Calmann-Lévy, Paris, 1915.
Perséphone, Calmann-Lévy, Paris, 1920.
Les lampes voilées, Calmann-Lévy, Paris, 1921.
Priscille Séverac, Calmann-Lévy, Paris, 1922.
Le bouclier d’Alexandre, Calmann-Lévy, Paris, 1922.
La vie amoureuse de Madame de Pompadour, Flammarion, Paris, 1924.
Un drame de famille, Calmann-Lévy, Paris, 1925.
Figures dans la nuit, Calmann-Lévy, Paris, 1926.
Terres étrangères, Calmann-Lévy, Paris, 1928.
L’ennemie intime, Flammarion, Paris, 1931 ;
La femme et son secret, Flammarion, Paris, 1933.
Château en Limousin, Flammarion, Paris, 1934.
Histoire de l’amour, Flammarion, Paris, 1935.
Gérard et Delphine : La porte rouge, Flammarion, Paris, 1936.
Gérard et Delphine : Le rendez-vous du soir, Flammarion, Paris, 1938.
Est-ce un miracle ?, Flammarion, Paris, 1939.
1. James Joyce, « A French religious novel », Daily Express, 1er October 1903.
2. À l’exception du travail mené par quelques universitaires. Voir en particulier Alain Quella-Villéger, Belles et rebelles. Le roman vrai des Chasteau-Tinayre, Aubéron, Bordeaux, 2000 ; France Grenaudier-Klijn, Une littérature de circonstances, Peter Lang, Berne, 2004 ; Mélanie Collado, Colette, Lucie Delarue-Mardrus, Marcelle Tinayre. Émancipation et résignation, L’Harmattan, Paris, 2003.
3. Sous le pseudonyme de Jean Guêtré, Victoire Tinayre coécrivit La misère (1881) avec Louise Michel.
4. Mireille Havet, « Visite à Marcelle Tinayre », Les Nouvelles littéraires, 23 décembre 1922, p. 4.
5. Le terme désigne les jeunes Françaises royalistes qui, sous le Directoire, adoptent un style vestimentaire outrancier. Leur pendant masculin était les « Incroyables ».
6. Marcelle Tinayre, « L’amour et les suffragettes », Le Journal, 28 juillet 1913.
7. Auguste Bailly, « La critique des livres. Marcelle Tinayre : La femme et son secret », Candide, 21 septembre 1933, p. 4.
8. Marcelle Tinayre, « Maternité », La Voix des familles, 1er mars 1934.
EXTRAITS
— Celui qui vous aura… celui-là…
Il s’embrouillait dans ses phrases, et son bras pressait mon bras contre son torse trapu. Sa voix coulait comme une eau tiède… Et les narines battantes, l’œil noyé, il promenait sur mon corps un regard lent, appuyé, répulsif comme le contact gluant d’une limace. Ce regard glissait par l’échancrure du corsage, s’attardait, hésitait, fouillait les plis des vêtements, et tout mon sang me monta soudain au visage sous cette curiosité qui me déshabillait.
Avant l’amour, p. 177.
J’avais cédé aux suggestions du désir parce que j’étais jeune, forte, née pour l’amour et exaspérée par l’attente. Est-ce un crime ? Je ne sais. Les mœurs et la morale tolèrent ce qu’on appelle le libertinage des jeunes gens et imposent à notre sexe, comme facile et presque sans mérite, une hypocrite chasteté. Je ne suis pas plus coupable que l’adolescent qui tombe, un jour d’orage, dans les bras d’une fille.
Avant l’amour, p. 234-235.
— Il y a beaucoup de domestiques parmi vos pensionnaires ? demanda Josanne.
— Oui, beaucoup : de petites bonnes, victimes du sixième étage… Mais nous avons aussi des ouvrières, des demoiselles de magasin, jusqu’à des institutrices !… Certaines sont restées pures de cœur – celles qui furent vraiment surprises par l’agression de l’homme, ou qui cédèrent par amour.
— Il y a des infortunes si poignantes !… Ah ! mesdames, dites-le, écrivez-le, criez-le ; on n’aura jamais trop pitié de la femme… Si bas qu’elle tombe, l’homme est, presque toujours, l’artisan responsable de sa déchéance…
La rebelle, p. 98.
– Elles l’admirent, dit Josanne à madame Platel, moins pour son talent que pour son beau physique. […] Elle parlait avec un accent d’ironie et d’âpreté qui choqua madame Platel :
– Comme vous êtes sévère !… Oui, monsieur Bonnafous représente un idéal médiocre, mais on a l’idéal qu’on peut avoir, et c’est déjà très joli d’en avoir un.
La rebelle, p. 101.
[L]’amour sensuel ne marque une femme que s’il n’est pas remplacé. On a construit des théories sur « l’empreinte » du premier possesseur, soi-disant inoubliable. Ce sont des hommes qui ont inventé cela.
La femme et son secret, p. 192.
Les Français aiment l’amour. Ils aiment la femme de leur pays, reine au foyer, reine au salon, mineure devant la loi, et, par les mœurs, l’égale de l’homme. Ils lui ont reconnu moins de droits que de privilèges jusqu’au jour où elle a dû renoncer aux privilèges et revendiquer les droits.
La femme et son secret, p. 75.
Ce qui aide Juliette [Drouet] à supporter cette existence de recluse, c’est le puissant instinct de la servitude amoureuse, ressort de tout grand amour féminin.
La femme et son secret, p. 203.
Et misérable entre les misérables, la vieille libertine, la sorcière à gigolos, traînant comme un pékinois de luxe le beau garçon qui pourrait être son petit-fils. Devenir cela ! Mieux vaut une pierre au cou et le fond de la Seine.
La femme et son secret, p. 243.
Et quand je me rappelle aujourd’hui ce souci inévitable et constant des choses de l’amour qui naît avec l’adolescence dans l’âme de la vierge contemporaine, quand j’évoque la terreur, le dégoût, la tristesse que je reçus de certaines confidences, je me demande si la délicate et prudente révélation de la vérité ne vaudrait pas mieux que l’hypocrisie obligatoire. Mais combien de mères sauraient entreprendre et achever cette éducation spéciale de la jeune fille qu’elles élèvent pour le mariage et qu’elles négligent d’élever pour l’amour ? […] – Hélas ! diront les mères, une fille instruite, avouant qu’elle sait, ne rencontrera pas un homme assez courageux pour l’épouser. L’innocence de la fiancée est le gage de la fidélité de l’épouse.
Avant l’amour, p. 21-23.











