Le 18 mai 1946, Anna Langfus, née Anna Régina Szternfinkiel le 2 janvier 1920 à Lublin, arrive seule à Paris. Elle laisse derrière elle sa Pologne natale, où son père, sa mère et son mari sont morts, assassinés par les nazis. La rencontre avec l’écriture se fera d’abord par le truchement du théâtre. Elle meurt vingt ans plus tard, laissant derrière elle trois romans publiés par Gallimard, dont Les bagages de sable, prix Goncourt 1962.
Fille unique choyée par ses parents et sa « nounou », Anna Langfus grandit dans une famille relativement aisée de la bourgeoisie juive de Lublin. Après des études brillantes dans le meilleur lycée de la ville, un établissement secondaire public et laïc où elle fait l’apprentissage du français, Anna se dirige vers des études d’ingénieure. Comme le veut alors la coutume, elle se marie jeune, épousant à dix-huit ans Jakub Rajs, à peine plus âgé qu’elle. Quelques mois plus tard, en octobre 1938, Jakub et Anna partent pour la Belgique afin de suivre la formation offerte par l’École supérieure des textiles de Verviers, près de Liège. À l’issue des quatre années de cours, le jeune couple pourrait ainsi prendre les rênes d’une usine textile à Lublin, selon les vœux de leurs parents. Après une première année réussie, Jakub et Anna reviennent en Pologne pour les vacances d’été. Nous sommes en juillet 1939. Le 1er septembre, l’armée hitlérienne envahit la Pologne. C’est le début de la Seconde Guerre mondiale et, pour Anna Langfus, la fin d’un monde.
Premiers pas littéraires : Les lépreux
Cette fin d’un monde, Anna Langfus l’évoquera d’abord par le truchement du théâtre. Sa première pièce, Les lépreux, écrite en 1953, montée par Sacha Pitoëff et présentée par le Théâtre d’Aujourd’hui au Théâtre de l’Alliance française de Paris en décembre 1956, plonge le public dans l’histoire de la destruction des Juifs de Pologne durant la guerre. Langfus y dénonce l’antisémitisme des voisins polonais, thème que l’on retrouvera dans son premier roman, tandis que la « constante retenue dans le pathétique » (France Observateur) annonce l’une des caractéristiques majeures de son écriture. Pourtant, lors des premières représentations, certains spectateurs, choqués par la violence des situations évoquées, quittent la salle. Langfus comprend alors qu’il lui faudra adopter une autre forme d’expression qui lui permettrait de concilier authenticité et distance.
Le sel et le soufre
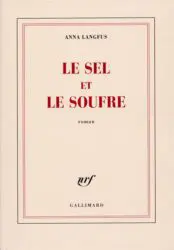 Puisant très largement au vécu de la romancière, Le sel et le soufre (Gallimard, 1960) nous amène au plus près des tourments de la guerre. Annonciateur de la destruction à venir, le récit commence avec l’effondrement d’un lustre de cristal. Anna Langfus s’y dépeint sous les traits de Maria, jeune héroïne rageuse, capricieuse et égoïste, cajolée par son mari, Jacques, ses parents et sa nounou. Comme un enfant se couvre les yeux, convaincu que son aveuglement le soustrait au regard des autres, Maria tape du pied et se refuse obstinément à accepter la guerre, cette empêcheuse de tourner en rond, cette adversaire déloyale. Elle cultive le déni. Mais la réalité s’obstine, sur fond de ghettos (ceux de Lublin puis de Varsovie où disparaissent son père puis sa mère), de clandestinité (comme Anna, Maria transporte des documents pour le compte de l’Armia Krajowa, ou AK, la résistance polonaise), de fuites et d’errances, avant l’arrestation, la torture, la mort de Jacques, l’emprisonnement, puis la libération par les soldats de l’Armée rouge et le retour solitaire à Lublin.
Puisant très largement au vécu de la romancière, Le sel et le soufre (Gallimard, 1960) nous amène au plus près des tourments de la guerre. Annonciateur de la destruction à venir, le récit commence avec l’effondrement d’un lustre de cristal. Anna Langfus s’y dépeint sous les traits de Maria, jeune héroïne rageuse, capricieuse et égoïste, cajolée par son mari, Jacques, ses parents et sa nounou. Comme un enfant se couvre les yeux, convaincu que son aveuglement le soustrait au regard des autres, Maria tape du pied et se refuse obstinément à accepter la guerre, cette empêcheuse de tourner en rond, cette adversaire déloyale. Elle cultive le déni. Mais la réalité s’obstine, sur fond de ghettos (ceux de Lublin puis de Varsovie où disparaissent son père puis sa mère), de clandestinité (comme Anna, Maria transporte des documents pour le compte de l’Armia Krajowa, ou AK, la résistance polonaise), de fuites et d’errances, avant l’arrestation, la torture, la mort de Jacques, l’emprisonnement, puis la libération par les soldats de l’Armée rouge et le retour solitaire à Lublin.
Récit puissant, étonnant, audacieux, dépourvu du moindre pathos, dont l’originalité relève autant de la caractérisation – le choix d’une narratrice-protagoniste « désagréable » – que du refus du manichéisme : l’une des rares figures positives du roman est l’Allemand Vic, docteur en pharmacie enrôlé dans la SS. Notant que nombre de récits de rescapés « sonnaient faux tout en disant vrai », Arnold Mandel, critique littéraire de L’Arche, s’exclame d’ailleurs : « Enfin, Langfus vint ». Témoignant d’une maîtrise remarquable du français, Langfus mêle le réalisme à l’onirisme. Elle fait en outre un usage magistral du silence, en particulier dans les scènes mettant en jeu des Polonais antisémites, le mutisme de la narratrice s’opposant aux paroles fielleuses de ces derniers, dans une stratégie de mise en exergue particulièrement efficace. Même s’il ne peut éviter la comparaison, généralement défavorable, avec Le dernier des justes d’André Schwarz-Bart (énorme succès de librairie de l’année précédente), le roman obtient le prix Charles-Veillon 1961, Le Monde le qualifiant de « grand livre qui donne une forme littéraire à un témoignage authentique et souvent bouleversant ».
Les bagages de sable
 Deux ans plus tard, paraît Les bagages de sable, prolongement romanesque du Sel. On y retrouve Maria, errant dans les rues de Paris où elle vient d’arriver seule, retrouvant le soir ses fantômes – son père, sa mère et Jacques – avant de faire la connaissance d’un homme plus âgé, Michel Caron, qui l’emmène dans le Midi de la France. Là, elle se lie avec un groupe d’adolescents. Après le suicide de la jeune Anny, elle cède au vieil homme et s’enfonce dans la somnolence, le silence et l’indifférence. Le retour de la femme de Caron la renvoie à sa solitude. Maria repart, une lourde valise pesant à son bras. Dans le quotidien Libération, Claude Roy a bien compris la justesse de ce roman de la survivance : « Maria n’en peut plus. Elle erre interminablement dans un crépuscule envahissant. Elle ne voit plus parce qu’elle n’a plus la force ni la curiosité de voir. Elle est la lassitude déguisée en passante, l’horreur de continuer, feignant d’être une personne, quelqu’un à qui on parle, qu’on peut désirer, aimer, qui ne désire et n’aime plus – rien ».
Deux ans plus tard, paraît Les bagages de sable, prolongement romanesque du Sel. On y retrouve Maria, errant dans les rues de Paris où elle vient d’arriver seule, retrouvant le soir ses fantômes – son père, sa mère et Jacques – avant de faire la connaissance d’un homme plus âgé, Michel Caron, qui l’emmène dans le Midi de la France. Là, elle se lie avec un groupe d’adolescents. Après le suicide de la jeune Anny, elle cède au vieil homme et s’enfonce dans la somnolence, le silence et l’indifférence. Le retour de la femme de Caron la renvoie à sa solitude. Maria repart, une lourde valise pesant à son bras. Dans le quotidien Libération, Claude Roy a bien compris la justesse de ce roman de la survivance : « Maria n’en peut plus. Elle erre interminablement dans un crépuscule envahissant. Elle ne voit plus parce qu’elle n’a plus la force ni la curiosité de voir. Elle est la lassitude déguisée en passante, l’horreur de continuer, feignant d’être une personne, quelqu’un à qui on parle, qu’on peut désirer, aimer, qui ne désire et n’aime plus – rien ».
Centré là encore sur une protagoniste, narratrice et focalisatrice peu « aimable », ce roman de l’après cherche à capter l’état d’esprit du rescapé, moins dans une perspective psychologique que d’un point de vue phénoménologique1. Le monologue intérieur autorise de fréquents apartés ironiques et mordants qui révèlent toute la douleur du rescapé plongé dans un exil sans fin : il est aussi incompréhensible aux autres que ce monde qui a repris, presque comme si de rien n’était, ne l’est pour lui. Ce roman du traumatisme engendré par la perte radicale, où Langfus parvient à transmettre ce qui relève pourtant de l’incommunicable, rencontrera un grand succès public et se verra couronné du prix Goncourt. Ce roman du traumatisme engendré par la perte radicale, où Langfus parvient à transmettre ce qui relève pourtant de l’incommunicable, rencontrera un grand succès public et se verra couronné du prix Goncourt. Certains critiques s’enthousiasment là encore pour l’authenticité des propos, Pascal Pia de Carrefour estimant qu’« [à] ce personnage non pas hors-la-loi, mais bien hors-la-vie, Mme Langfus a su prêter le langage le plus juste qui soit. On ne trouverait pas dans Les bagages de sable un seul mot qui sonne faux ». D’autres commentateurs seront moins charitables, considérant qu’il s’agit davantage d’un document ou témoignage que d’une œuvre véritablement créatrice, ou jugeant le style du roman vieillot. Les lecteurs, eux, semblent avoir compris le double objectif que s’est fixé Anna Langfus : exprimer et communiquer.
Saute, Barbara
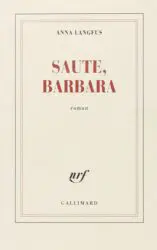 Troisième et dernier roman d’Anna Langfus, Saute, Barbara (1965) illustre de manière particulièrement probante l’une des thématiques centrales de l’œuvre, à savoir l’impossibilité de « l’après » dans le contexte de la Shoah. La guerre à peine finie, un ancien architecte polonais, fait soldat et résistant, erre seul dans Berlin dévasté. Sa femme Léa et sa fille Barbara sont mortes sous les balles allemandes tandis qu’il s’enfuyait par une fenêtre. Michael, c’est son nom, aperçoit alors une fillette en train de sauter à la corde. Le souvenir de Barbara s’essayant à la même activité l’amène à enlever la petite Allemande, Minna. L’ayant rebaptisée Barbara, il se fait passer pour son père, part avec elle pour Paris où lui est offerte la possibilité de retrouver une existence familiale, conjugale et professionnelle. Mais Minna ne saurait remplacer Barbara, et cette « seconde chance » reste un leurre, une mystification, pire une imposture. Michael se résout donc à ramener Minna à Berlin. Le roman se clôt sur un ambigu coup de revolver.
Troisième et dernier roman d’Anna Langfus, Saute, Barbara (1965) illustre de manière particulièrement probante l’une des thématiques centrales de l’œuvre, à savoir l’impossibilité de « l’après » dans le contexte de la Shoah. La guerre à peine finie, un ancien architecte polonais, fait soldat et résistant, erre seul dans Berlin dévasté. Sa femme Léa et sa fille Barbara sont mortes sous les balles allemandes tandis qu’il s’enfuyait par une fenêtre. Michael, c’est son nom, aperçoit alors une fillette en train de sauter à la corde. Le souvenir de Barbara s’essayant à la même activité l’amène à enlever la petite Allemande, Minna. L’ayant rebaptisée Barbara, il se fait passer pour son père, part avec elle pour Paris où lui est offerte la possibilité de retrouver une existence familiale, conjugale et professionnelle. Mais Minna ne saurait remplacer Barbara, et cette « seconde chance » reste un leurre, une mystification, pire une imposture. Michael se résout donc à ramener Minna à Berlin. Le roman se clôt sur un ambigu coup de revolver.
Avec ce troisième roman, Langfus persiste dans sa double aspiration d’exprimer et de communiquer la douleur, la solitude et la culpabilité du rescapé, sans tomber dans la facilité du pathos et du manichéisme. Pas plus que les deux Maria, Michael ne s’avère un héros « aimable » ; il pose sur tout ce qui l’entoure, et aussi et surtout sur lui-même, un regard brutalement lucide. Le portrait qui est fait des déportés, jamais héroïsés, tout comme des employés d’agences d’accueil, est volontiers dépréciatif. Afin d’illustrer la dépersonnalisation radicale du rescapé, la complexité de ses rapports aux autres et l’impossibilité qui est sienne de trouver place dans la société d’après-guerre, Langfus exploite les modalités permises par le monologue intérieur tout en ayant recours à plusieurs motifs récurrents (la laideur, l’œil ou encore le soleil). Portrait implacable du Paris de l’immédiat après-guerre, Saute, Barbara constitue un apport profondément original à ce qu’on a coutume d’appeler la littérature concentrationnaire. Si « le comportement criminel du narrateur excite de l’indignation […] le récit rétrospectif révèle si finement l’intérieur de cette âme dévastée que notre dépit momentané a vite fait de céder à une compassion muette pour ce prisonnier d’un passé que ne comprendra jamais celui qui ne l’a pas vécu », écrit un critique dans The French Review.
***
 Jeune épousée partie étudier l’ingénierie textile, Anna Langfus ne se projetait pas romancière ; c’est la guerre qui l’a mise, à son corps défendant, sur le chemin de l’écriture. Au moment d’entamer la rédaction de son deuxième roman, elle ne souhaitait pas s’étendre davantage sur une thématique dont elle pensait avoir déjà tout dit. Elle avait d’ailleurs en tête quelque chose de léger, « à la Sagan ». Mais on ne se débarrasse pas facilement des tourments de la guerre. Langfus prit donc sa place parmi ces écrivain(e)s de la « Génération Auschwitz ». Dépositaire d’une histoire qui, de son propre aveu, ne lui appartenait pas toute2, elle s’astreignit à respecter un postulat moral et esthétique – pas de pathos, pas de manichéisme. Ces protagonistes si peu aimables, l’usage original et percutant du silence comme du monologue intérieur, sont autant d’outils ayant permis à Anna Langfus de bâtir son œuvre sur une balise éthique, en ayant à cœur de transmettre quelque chose d’authentique à son lecteur : « […] à aucun degré, je ne disposais de la liberté de l’écrivain vis-à-vis de sa création. Des événements auxquels j’avais été mêlée ne m’appartenaient pas, et même ce que je considérais comme étant mon expérience personnelle finissait par m’apparaître comme un fragment d’une expérience plus vaste et, à partir du moment où j’avais décidé de l’exprimer, j’endossais une responsabilité non seulement vis-à-vis de ceux qui l’avaient vécue avec moi, mais aussi de tous ceux qui, plus tard, en prendraient connaissance » (Les Nouveaux cahiers). Affaiblie par les années de privation, Anna Langfus souffre de problèmes cardiaques. Elle succombe à un infarctus à l’hôpital de Gonesse le 12 mai 1966. Ses trois romans sont autant de victoires sur la guerre qui lui prit tant.
Jeune épousée partie étudier l’ingénierie textile, Anna Langfus ne se projetait pas romancière ; c’est la guerre qui l’a mise, à son corps défendant, sur le chemin de l’écriture. Au moment d’entamer la rédaction de son deuxième roman, elle ne souhaitait pas s’étendre davantage sur une thématique dont elle pensait avoir déjà tout dit. Elle avait d’ailleurs en tête quelque chose de léger, « à la Sagan ». Mais on ne se débarrasse pas facilement des tourments de la guerre. Langfus prit donc sa place parmi ces écrivain(e)s de la « Génération Auschwitz ». Dépositaire d’une histoire qui, de son propre aveu, ne lui appartenait pas toute2, elle s’astreignit à respecter un postulat moral et esthétique – pas de pathos, pas de manichéisme. Ces protagonistes si peu aimables, l’usage original et percutant du silence comme du monologue intérieur, sont autant d’outils ayant permis à Anna Langfus de bâtir son œuvre sur une balise éthique, en ayant à cœur de transmettre quelque chose d’authentique à son lecteur : « […] à aucun degré, je ne disposais de la liberté de l’écrivain vis-à-vis de sa création. Des événements auxquels j’avais été mêlée ne m’appartenaient pas, et même ce que je considérais comme étant mon expérience personnelle finissait par m’apparaître comme un fragment d’une expérience plus vaste et, à partir du moment où j’avais décidé de l’exprimer, j’endossais une responsabilité non seulement vis-à-vis de ceux qui l’avaient vécue avec moi, mais aussi de tous ceux qui, plus tard, en prendraient connaissance » (Les Nouveaux cahiers). Affaiblie par les années de privation, Anna Langfus souffre de problèmes cardiaques. Elle succombe à un infarctus à l’hôpital de Gonesse le 12 mai 1966. Ses trois romans sont autant de victoires sur la guerre qui lui prit tant.
EXTRAITS
J’ai choisi ma petite mort personnelle, je n’en veux pas d’autre. Je ne veux rien avoir de commun avec ceux que j’ai laissés là-bas. Leur sort m’est indifférent. La pitié, la terrible pitié ne m’étrangle plus. On a toujours pitié lorsqu’on se sent coupable. Moi, maintenant, je m’en fous.
Le sel et le soufre, p. 67.
« Je suis votre ami. Votre seul ami. Sans moi, vous êtes des hommes morts. Vous le savez, n’est-ce pas, que je suis votre seul ami ? »
Et eux d’acquiescer avec ferveur.
« Eh bien, continue Kuzma, votre ami est pauvre. Très pauvre. Chaque jour il lutte, il se débat pour nourrir sa grande famille. Il faut l’aider, mes enfants, il faut l’aider. »
Ses larmes recommencent à couler, de grosses larmes qui dégringolent le long de ses joues rebondies.
« Combien vous faut-il, cette fois, monsieur Kuzma ? » demande Jacques.
Le sel et le soufre, p. 150.
Pourquoi ces divagations quotidiennes dans les rues ? Que peuvent pour moi tous ces êtres que je croise ? Chacun remplit l’univers de sa personne. Je me traîne humblement derrière eux et du premier venu j’attends l’impossible miracle. Puis, pour me prouver que je ne suis pas seulement cette loque misérable, cette chose inconsistante, je me force à les haïr, sachant bien que ma haine est artificielle, qu’elle aussi n’a pas d’existence, que je l’allume comme une lampe dans une ruine abandonnée depuis des siècles, comme s’il suffisait de cette lueur pour croire qu’elle est habitée. Et même la haine, je ne sais pas la retenir. Elle m’échappe, comme le reste, comme tout ce qui m’entoure. Je ne puis que traîner dans les rues, simple d’esprit en quête de miracle.
Les bagages de sable, p. 17.
Depuis, Michel Caron sort souvent le soir. Il dit : « Je sors pour un moment. » Il le dit la main sur la poignée de la porte comme si, une fois ces paroles prononcées, il lui était impossible de rester un instant de plus. Il n’oublie jamais de me laisser des cigarettes sur la table. Toute la journée, j’attends le soir et la minute où il me dira : « Je sors pour un moment. » Jacques et mes parents sont revenus. Ils reviennent, de temps à autre. Assis autour de la table, ils m’observent, en silence. Parfois ce silence m’effraie. Je me tourne vers eux et je demande : « Qu’avez-vous à me reprocher ? » Il m’arrive même de rire. Est-ce mon bonheur ?
Les bagages de sable, p. 209.
Les quatre hommes qui partageaient avec nous le compartiment étaient des prisonniers de guerre, en provenance d’un camp disciplinaire où ils avaient été envoyés pour tentative d’évasion, pas trop abîmés et possédant encore un solide appétit de vivre. Ils remuaient avec complaisance leurs souvenirs de captivité, s’attendrissaient et s’émerveillaient déjà devant les insignifiants épisodes de ces années perdues.
Saute, Barbara, p. 64.
Je veux le rire de Barbara.
Saute, Barbara, p. 156.
1. Jean-Yves Potel, Les disparitions d’Anna Langfus, Noir sur Blanc, Paris, 2014, p. 207.
2. Anna Langfus, « Un cri ne s’imprime pas ». Discours prononcé par Anna Langfus devant la Women’s International Zionist Organization (WIZO) en mars 1963. Reproduit dans Les Nouveaux cahiers, no 115 (1993), p. 42-48.











