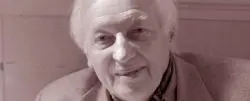Absent de la scène médiatique, indifférent aux modes littéraires, Jean-Loup Trassard poursuit une œuvre d’un intense rayonnement poétique avec la patience du laboureur creusant son sillon. Car cet écrivain qui possède une science exceptionnelle du langage est un homme de la terre.
Né en 1933 dans un coin de campagne aux confins bocagers de la Bretagne, de la Vendée et de la Loire, où il habite encore, il a élevé des vaches et a pris le relais de son père « fermier de droits communaux », tout en travaillant à préserver la mémoire rurale. Il se rend à Paris (à peine nommé dans l’œuvre) où il rencontre ses confrères des Cahiers du chemin à la NRF où Jean Paulhan l’a introduit au début des années soixante. On l’imagine aussi peu homme de lettres que possible, loin des bavardages mondains et des postures, occupé à parcourir à pied sa campagne, à vaquer aux soins de ses veaux, vaches et bSufs, et à peaufiner dans le silence ses textes qu’il porte longuement et met au jour sans hâte. Depuis les nouvelles de L’amitié des abeilles en 1961 et six recueils parus chez Gallimard, l’œuvre narrative s’ouvre depuis peu sur le roman avec Dormance (2000) et La déménagerie (2004). À quoi s’ajoutent (tel le récent Conversation avec le taupier) de courts ouvrages avec des photos (Trassard pratique aussi cet art), consacrés aux choses et aux gens de la terre en voie de disparition pour en perpétuer le souvenir.
Approches
Au premier abord, les titres de ces livres donnent peu de prises au lecteur déconcerté par le rapport problématique qui les relie avec le sujet des récits. Pourquoi « L’œil des foulques », « D’un fût gélif » ou « Nous sommes le sang de cette génisse » ? Un goût manifeste pour le terme rare, confirmé et amplifié tout au long des textes serrés, presque compacts, pour sa sonorité, son étrangeté, les ondes qu’il met en branle. Parfois le jeu de mots laisse entendre une signification seconde (« Hors des lies », « Aux régions ouraniennes »), à moins que ces titres ne doivent s’entendre comme de véritables koans, proposant une énigme à résoudre ? Pourtant ces récits, dès les premiers recueils, se développent à partir d’un fait simple, le plus souvent accompli par un personnage unique. Ainsi dans Paroles de laine ou L’érosion intérieure, un enfant se cache dans la ferme de ses parents, un homme sort la nuit dans la campagne, le narrateur entre dans un château abandonné, un vieux sourcier fait creuser un puits. Un point de départ dans le cercle étroit de la vie quotidienne et des souvenirs d’enfance à peine voilés. Et le lecteur peu à peu s’enfonce à la suite du récit dans un monde d’une extrême complexité où se dérobent les repères.
L’œuvre en ses débuts s’engage volontiers dans la veine du fantastique. Un promeneur dans la campagne caniculaire constate qu’il se transforme en saurien qui gagne un trou d’eau : c’est Lovecraft ou Pieyre de Mandiargues… Si l’horreur est côtoyée à travers des fantasmes (« Le pourrissoir »), le récit explore le plus souvent des virtualités positives de l’humain qui peuvent être mises au jour par l’initiation, et ces possibilités doivent être actualisées : il faut cesser de vivre en surface ! Ce que, littéralement, accomplit le narrateur de « L’érosion intérieure » : à mesure qu’il pénètre dans une caverne préhistorique, il se dépouille, mais déjà cet acte germait en lui à son insu. Il remonte ainsi vers des racines anciennes, archaïques même, et en réintégrant la terre, il connaît une nouvelle naissance.
L’unité essentielle
Les personnages, à l’occasion nommés, le plus souvent réduits à un « je », un « il », un « elle » ou un « nous », passent d’un lieu ou d’un état connu et présent à un autre, mais on ne sait quel est cet autre, rien ne l’identifie parce qu’il n’existe pas de mots pour le désigner. Le passage est permis par un décalage ou une distorsion de la perception ou par une véritable métamorphose. La transgression est parfois délibérée, parfois imprévue, des forces invisibles prenant alors le relais de la volonté. Une femme lit la nuit et il lui semble entrer dans une forêt, des oiseaux viennent à elle : « Ces esprits cotonneux de la terre portent-ils un message qu’une absence de bouche les empêche de dire ? » Un homme qu’on a conduit dans une maison s’engage dans un couloir qui mène à une église – à moins que ce ne soit une cave, ou une plaine ou un fond sous-marin – où s’accomplissent des rites funéraires. Des chasseurs poursuivent dans une forêt un cerf qui longtemps réussit à les déjouer avant d’être rattrapé et tué. À l’acte contemporain s’en surimposent d’autres semblables et anciens dans une unité indissociable, comme si le geste que nous accomplissons répétait tous ceux qui le furent dans la suite des temps – d’où l’ambiguïté partout présente dans ces récits quant aux identités, aux événements, aux époques. Le geste, le plus humble soit-il, ou une figure, acquiert une portée mythique et cette amplification, qui n’est pas qu’une transposition poétique, en fait jaillir le sens profond. Un jeune berger conduit son troupeau et voici que surgit Io, la rivale transformée en vache par la jalouse Héra. Des paysans aperçoivent une jeune fille nue dans un pré et c’est une vision de nymphes ! La rencontre de la femme est ici une brûlure intime pour ces hommes et une rupture dans la trame des tâches routinières, un insolite ouvert, une folie possible. Et c’est une vérité essentielle qui est alors révélée.
Un savoir très ancien
Cette vérité est touchée souvent à l’occasion d’un retour vers un lieu de l’enfance, un minuscule coin de terre, un étang, une maison, ou en retrouvant des voisins. Ces paysans, Trassard les évoque avec une justesse et un respect extrêmes (en particulier dans le récent roman La déménagerie qui fait pénétrer dans l’intimité d’une ferme lors de son déménagement dans les années de guerre), sans jamais glisser dans le portrait naturaliste ou une célébration passéiste. Il décrit leurs travaux, leur langage d’une invention étonnante, avec ce qu’il dérobe et ce qu’il livre d’eux, cette façon de « dire sans dire », leur savoir transmis depuis des générations.
Si l’on voulait marquer des affinités, toutes distinctions gardées, Jean Giono en ses premiers livres ou Henri Pourrat pourraient être évoqués pour leur connaissance des hommes de la terre et la richesse stylistique mise en œuvre pour en parler, mais Trassard, à leur différence, est un « praticien » qui se réclame de la paysannerie. Il a rapporté un curieux journal de voyage des campagnes de Russie, quelques régions parcourues en vélo avec son interprète dans les débuts de la Glasnost. Il est reçu, à sa surprise et à son grand plaisir, comme un agriculteur français venu visiter les réalisations kolkhoziennes et non comme un écrivain curieux de ses confrères. Les monuments de Moscou, les monastères de Souzdal tiennent moins de place dans ses carnets qu’un partie de pêche, des échanges sur l’alimentation du bétail ou une noce cosaque. « Je sentais bien qu’aller en Russie c’était m’enfoncer vers notre passé, chercher une très lointaine parenté. » Là encore se manifeste une exceptionnelle connaissance des plantes et de leurs vertus, des animaux, des soins à leur donner et de leurs habitudes, une compréhension qui résulte d’un contact direct, de la fréquentation de toute une vie.
C’est cette matière élémentaire en laquelle les humains s’insèrent, ou plutôt qu’ils constituent eux aussi, que, d’un livre à l’autre, Trassard reprend, explore, interroge avec tous ses sens, travaille inlassablement. La même et toujours nouvelle. Le lecteur se surprend à peine que Paroles de laine consacre quatorze pages à décrire l’aspect et l’action du lierre – mais il admire ! Pas ou peu de panoramas mais tant de minutie, une langue si sensorielle, si charnelle… Si musicale aussi. Des audaces syntaxiques surprennent (suppression des articles, de la ponctuation, ruptures de construction), certains récits prennent une allure expérimentale à la Claude Simon, ce ne sont pas les plus convaincants et çà et là menace la préciosité. Tentation peut-être d’un travail d’orfèvre sur le langage qui puise à toutes les sources, à la botanique comme à l’onomastique, au patois et aux expressions régionales comme au vieux français. Les longues et lentes descriptions développées parfois au point qu’elles constituent l’essentiel de certains récits ressortissent en fait à cette intuition – ou à ce constat – que la réalité physique est inépuisable et que les mots ne parviennent jamais à en rendre compte.
Une histoire au-delà de la mémoire
Si les personnages opèrent des retours vers ce qu’ils ont vécu, ce n’est pas seulement un acte individuel mais celui de l’espèce humaine qui revient ainsi sur son histoire. Partie d’un état fusionnel avec la nature, elle découvre des techniques, acquiert un langage, invente des modes de vie de plus en plus stables et sécuritaires tout en préservant une indispensable vigilance, apprend à prévoir, ouvre sa conscience, renforce le sens de la communauté. Trassard rassemble tous ses thèmes privilégiés dans le roman Dormance. À travers un homme de l’époque néolithique, il retrace ni plus ni moins que les débuts de la civilisation rurale. Ce n’est pas La guerre du feu réécrite avec son intrigue dramatique mais à la fois une reconstitution et une rêverie, celle-là s’opérant grâce à celle-ci. De toute évidence la mémoire ne suffit plus, il faut l’étayer, la compléter en recourant à des ouvrages ou à des spécialistes, ce qui permet d’avancer des hypothèses sur ce que put être la vie de ce jeune Gaur. Il a quitté le petit clan familial avec une compagne et un jeune couple pour aller s’établir dans un autre lieu, celui où l’auteur lui-même est né et dont il connaît chaque bois, chaque sentier et chaque ruisseau, presque chaque touffe d’herbe. Ce départ, qui affirme pour le jeune homme la nécessité de l’autonomie et le passage à l’âge adulte, prélude à la création d’une cellule nouvelle qui doit pour survivre trouver de la nourriture, plantes et produits de la chasse, s’abriter de la pluie et du froid, se défendre contre les rôdeurs. Qui furent ces êtres, que se passait-il en eux, quelles pensées naissaient dans les longues heures du soir et les journées vides de l’hiver ? C’est à partir du présent connu que peut être reconstitué l’archaïque, mais, dit Trassard, au-delà des désirs, du besoin d’aimer, de la peur de perdre des êtres chers, « l’archéologie des sentiments reste rêveuse ». Et que fut le langage ? L’auteur écoute en lui des mots qui désignent, et ces figures humaines qui les ont peut-être prononcés, il les a longtemps portées. Comme il le fait pour la plupart de ses récits, il a laissé des ombres se lever. Et l’écriture est alors venue, qui clarifie la rêverie, la fixe, donne corps à l’intuition. « Je ne comprends pas bien ce qui se passe entre ce jeune homme et moi, entre sa vie et la mienne. Écrire devient le geste d’écarter des branchages pour voir. » Beau récit, d’une extrême densité, tonique et émouvant car ces ancêtres si lointains cessent d’être improbables et se rapprochent de nous. Une fiction certes, mais plus encore l’histoire possible de ce qui existait il y a des millénaires et dont nous avons hérité. Et un hymne à l’être humain en ses capacités d’inventer, de progresser, de vivre selon une morale et un idéal, habile et honnête, rude et tendre.
Art poétique
Une documentation minutieuse précède donc souvent et amorce l’écriture, que ce soit l’étude topographique d’une région avec ses moindres accidents et les « cours d’eau peu considérables » qui l’irriguent, la pêche, les méthodes de culture, l’outillage ou, curieusement, les anges… L’écriture interroge les rêves, s’abandonne aux fantasmes, aux souvenirs, à moins encore, aux infinies nuances du temps, à des atmosphères, à des rythmes, des accords et dissonances, à des impressions fugaces et confuses qui vont peut-être se condenser, à tout ce qui accroît « une soif qui peut parvenir à l’écriture ». Il s’agit pour l’écrivain de se placer dans le courant de l’écriture qui, comme l’eau des ruisseaux, est antérieure à sa naissance. D’autres métaphores rendent compte de cette activité : « […] il faudrait faire un récit comme un sabot, écrit l’auteur dans L’ancolie, avec un vide où habite l’ombre […]. Ainsi du récit qui se doit guider, amincir et durcir, chantourner au besoin mais pour finalement révéler qu’il n’avait point son but en lui-même, point de but autre que ménager sous son abri un espace où le lecteur se prenne à être autrement ». Dans un texte-clé, « Reconnaissance », qui provient du même recueil, le processus est détaillé en ses diverses phases : « Il écrivait une histoire de forêts » (récit en italique) ; « […] je suis la forêt » (récit sans césure en romain) pour mieux exprimer comment le narrateur fait corps avec le milieu ; puis prise de distance réflexive pour cerner leurs rapports : « Une forêt touffue dont il ne voulait pas sortir, récit labyrinthique. Il devait en apprendre le centre, le sens et creusait des sentiers peu à peu. Il découvrait son texte comme la forêt dans laquelle il marchait l’écrivant ». D’où l’aspect à la fois sensoriel, très palpable, et insaisissable de ces récits : à partir d’un sujet extérieur ils deviennent peu à peu substance intime dans laquelle le narrateur s’enfonce, en quoi se fondent des espaces, des époques, des figures. Et ce voyage n’a ni commencement ni fin, il constitue seulement une coupe dans une continuité. Dans « Canada » le départ d’un trappeur devient la marche du narrateur dans la neige. Un récit – « Haillons de mémoire » – concerne un personnage et le parcours qu’il accomplit, un second la marche du narrateur dans la neige puis les deux récits se rejoignent. En fin de compte tous les récits s’identifient non seulement avec l’expérience du narrateur-auteur mais avec la feuille de papier sur laquelle elle s’écrit…
« Les patiences du bord de l’eau » dans L’ancolie raconte qu’une jeune châtelaine se baignait dans un étang. Elle disparaît. « Peut-être est-elle passée de l’autre côté ? » On ne retrouve que le livre qu’elle lisait, et ce livre qui a préparé le passage « voulait réveiller la conscience profonde d’appartenir aux éléments ». Tel semble bien en sa finalité le projet de Trassard, que nouvelles et romans réalisent magnifiquement.
Jean-Loup Trassard a publié, entre autres :
Chez Galllimard : L’amitié des abeilles, nouvelles, 1961 ; L’érosion intérieure, récits, 1965 ; Paroles de laine, nouvelles, 1969 ; L’ancolie, nouvelles, 1975 ; Des cours d’eau peu considérables, récits, 1981 ; Campagnes de Russie, voyage, 1989 ; Nous sommes le sang de cette génisse, récits, 1995 ; Dormance, roman, 2000 ; La déménagerie, roman, 2004 ; Conversation avec le taupier, textes et photographies, Le temps qu’il fait, 2007.
EXTRAITS
Aujourd’hui, je me suis levé pour écrire sur les ruisseaux. Les idées tremblent heureusement, incertaines de leur voie, toutes en surface légère bien qu’elles viennent du fond. L’intérêt sera dans le rapprochement entre l’ignorance et le désir, dans ce qui par cette soif peut arriver à l’écriture. J’admets, et m’en satisfais, que je n’irai point là où je croirai aller et que l’eau pour finir passera entre les mots. Dans un livre ne s’arrêtent pas les ruisseaux.
Des cours d’eau peu considérables, p. 71.
Les outils cognent la bille de bois, entaillent, pénètrent, choisissent les fibres : le sabot émerge de l’arbre. Mais à la pointe des outils qui l’achèvent soudain le sabot s’absente.Une épaisseur de bois veiné, savamment galbée quoique avec simplicité, semblait être l’objet de tout l’intérêt. Il n’en est rien, c’est le vide qui requiert tous les soins. Et l’on peut rectifier qu’en fait les lignées de sabotiers n’ont jamais sculpté que le vent, s’efforçant à l’entourer de bois.
L’ancolie, p. 151.
Au lierre qui ne meurt pas, chaque feuille sur chaque tige est un jour. Penché sur un travail précis, occupé sous la pluie à des tailles infimes, je laissais filer les années. Et maintenant il n’y a plus que le lierre formant un houppier noir où fut la belle frondaison de ma vie. L’arbre, épuisé de lendemain, meurt entre les bras d’hier. La maison sombre où les effraies peuvent dormir, le jour n’ose plus s’y glisser. Le lierre achève de disloquer les meubles, de soulever les gonds, de fissurer le marbre des commodes et d’en faire tomber les tiroirs, lentement ouverts. La dorure qui ornait les miroirs et le bois des bergères s’écaille sous des griffes minutieuses.
Paroles de laine, p. 155.