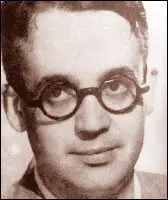Journaliste et écrivain de droite durant les années 1930 et 1940 en France, Robert Brasillach a laissé une œuvre entièrement obscurcie par ses prises de position politiques, qui en ont fait un nom tabou de l’histoire littéraire.
Frappé d’ostracisme au lendemain de la Libération, Robert Brasillach figure, aux côtés notamment de Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle, Jean Giono, Marcel Jouhandeau, Henry de Montherlant, sur la « liste noire » de 1944, liste dressée par le Comité national des écrivains de la Résistance. Tandis que Céline s’exile au Danemark et que Drieu se suicide, Brasillach choisit sciemment de se livrer, ce qui à ses yeux signifie assumer ses positions idéologiques jusqu’au bout, quitte à le payer de sa vie. Une pétition militant pour sa libération, signée par une cinquantaine d’écrivains (au nombre desquels Paul Valéry, Albert Camus, Marcel Aymé, Paul Claudel, Jean Anouilh, Jean Cocteau), l’intervention désespérée de François Mauriac, qui ira jusqu’à obtenir un entretien privé avec de Gaulle, ne changeront rien. Brasillach a 35 ans lorsqu’il est fusillé en février 1945.
Un parcours romanesque
« Robert Brasillach est l’un des esprits les plus brillants de sa génération » ; ainsi commençait le plaidoyer de Mauriac en faveur de Brasillach, lu à l’audience du procès. L’intervention de Mauriac est d’autant plus remarquable que Brasillach ne l’avait jamais ménagé dans ses articles. Il n’avait du reste jamais ménagé personne ; particulièrement agressif à l’endroit des communistes, il alla jusqu’à se mettre à dos, durant l’Occupation, ses anciens collègues de Je suis partout, revue de droite dont Brasillach assumera la direction de juillet 1937 à août 1943. Quelle valeur pouvait bien avoir l’œuvre d’un écrivain à peu près entièrement sombré dans l’oubli depuis une trentaine d’années ? D’abord, l’œuvre est imposante : près d’une vingtaine de publications entre 1932 et 1944. Éditées entre 1963 et 1966 par le Club de l’Honnête Homme à Paris, les œuvres complètes de Brasillach (incluant publications posthumes et inédits, mais excluant curieusement certains textes déjà publiés) composent douze volumes d’environ 600 pages chacun. Au premier rang, quelques solides romans, des mémoires et une Histoire du cinéma (écrite en collaboration avec Maurice Bardèche, son beau-frère), longtemps considérée comme une référence.
S’il faut identifier les thèmes à partir desquels la fiction prend forme chez Brasillach, ce serait certainement le temps et le rêve. Toute l’œuvre exprime la hantise du temps qui s’écoule et la difficulté de passer de l’enfance au monde adulte, de l’univers du rêve et du jeu à celui de la maturité et de la responsabilité des actes posés. Dans un certain sens, nous pourrions ajouter : la difficulté de passer de la littérature à la politique.
L’enfant de la nuit (1934) est sans doute la première réussite de l’auteur. Roman tout en demi-ton sur fond de drame à la fois sentimental et policier qui fait songer au cinéma populaire d’un Marcel Carné ou d’un René Clair, il énonce assez bien le principal obstacle qu’auront à surmonter les personnages futurs de Brasillach : la représentation d’une figure paternelle autoritaire, que le personnage tente de fuir dans l’univers immatériel du rêve. Cela se donne à voir dans la double attitude du héros narrateur et de Paulin Garrouste, lequel abandonne ses prétentions amoureuses sur la petite Anne à la suite de l’intervention du tuteur de celle-ci. Le narrateur conclut, s’identifiant à Paulin : « Tout à l’heure, la nuit viendrait, la nuit brillante, où Paris s’ensevelirait, nous regagnerions chacun notre lit, rêvant peut-être le même rêve. Il allait falloir nous quitter. Quand nous nous serrâmes la main, je savais que Paulin ne troublerait plus la petite Anne, mais que, désormais, elle allait peut-être le troubler longtemps. » À la fin du roman, le narrateur quitte Paris le deuil dans l’âme, dans une allusion désabusée au Rastignac de Balzac prêt à conquérir Paris et les femmes : « Maintenant, c’est fait. Je suis seul. Non point à la manière des héros balzaciens, du haut d’un cimetière, mais devant la porte d’une gare, je fais mes adieux à Paris1. »
Comme le temps passe (1937), roman plus ambitieux et complexe, oppose, de façon particulièrement problématique, l’innocent paradis passif de l’enfance à l’univers actif et responsable de la maturité. Le roman raconte l’histoire de René et de Florence, des cousins orphelins élevés par une tante sur l’île de Majorque. Cette île représente pour eux « une sorte de Paradis où les lois n’existent pas encore2 ». Mais ils grandissent, et René le premier gagne Paris, puis s’engage dans une troupe d’acteurs ambulants ; hommage de Brasillach au cinéma naissant, mais épisode symptomatique du désir de René de poursuivre les rêves et illusions de l’enfance. René et Florence se retrouvent enfin, se marient, croyant comprendre que l’amour était le Paradis d’autrefois et qu’ils n’allaient jamais en être chassés. Cependant, il suffit d’un vague flirt entre Florence et un lieutenant qui, pour être plus âgé que René, n’en garde pas moins la grâce et la fraîcheur d’un enfant, pour que René quitte brusquement Florence sans lui donner la moindre explication. Mobilisé pendant la Première Guerre, René y fait l’épreuve de la maturité. Quatorze ans passent avant que René ne revienne vers Florence, qui durant tout ce temps l’avait attendu.
Les sept couleurs (1939) doit son titre à sept techniques d’écriture auxquelles Brasillach recourt pour composer son roman (récit, lettres, journal, réflexions, dialogue, documents, discours). Le roman marque un tournant dans l’œuvre, car il introduit l’univers fasciste ; désormais, la politique, que Brasillach avait su garder à l’écart de sa passion littéraire, envahira de plus en plus ses textes et sa vie. Des romans ultérieurs auront pour cadre le fascisme (Les captifs, roman inachevé que Brasillach commence à écrire vers 1940) et l’Occupation (Six heures à perdre, rédigé entre mars et juin 1944 mais publié seulement en 1953). Dans Les sept couleurs, Patrice et Catherine vivent, pendant un mois à Paris, un bonheur et une complicité qui rappellent René et Florence sur leur île. Mais Catherine choisit d’épouser un homme qui lui apporte une sécurité, reprochant à Patrice son « incertitude », son absence au monde : « [vous êtes] si peu fixé à la terre, si appliqué à jouir des trésors que le sort vous apporte comme des jouets et non comme des nécessités », lui écrit-elle. « Exilé » en Allemagne parce qu’il estime que le mariage de Catherine l’a chassé de France, il découvre un fascisme qui s’accorde au pouvoir du rêve et qui suscite la même fascination que Brasillach lui-même pouvait avoir vis-à-vis du cinéma et du théâtre, qu’il fréquenta toute sa vie assidûment : devant la cérémonie fasciste, parée d’une symbolique religieuse et unanimiste, « on se dit que ce pays est d’abord, au plein sens du mot, et prodigieusement, et profondément, et éternellement, un pays étrange3 ». Revoyant Catherine de longues années plus tard, Patrice, on le devine, sera impuissant à la reconquérir.
Un héroïsme idéologique
Parallèlement à ses romans, Brasillach rédige des chroniques littéraires dans diverses revues, dont L’Action française de Charles Maurras. Ses articles font autorité, sa plume est précieuse pour la droite. Il faut attendre le milieu des années 1930 pour lire les premiers articles politiques de Brasillach, et encore ils sont très peu nombreux. Contre le gouvernement socialiste de Léon Blum, qu’il exècre, il écrit : « Enfin, il est de plus en plus urgent d’organiser le fascisme français. » Ses articles deviennent provocants, ils ajoutent l’injure à la haine de la République. Il écrit par exemple dans le numéro de la Révolution nationale du 19 février 1944 : « J’ai contracté, me semble-t-il, une liaison avec le génie allemand, je ne l’oublierai jamais. Qu’on le veuille ou non, nous avons cohabité ensemble. Les Français de quelque réflexion, durant ces années, auront plus ou moins couché avec l’Allemagne, non sans querelles, et le souvenir leur en restera doux4. »
En septembre 1939, non seulement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale inscrit la fin d’une époque et en appelle une autre, mais Brasillach y trouve un événement à sa mesure, vis-à-vis duquel il paraît décidé à jouer son destin. Il entreprend alors la rédaction de ses mémoires, intitulés Notre avant-guerre. La hâte avec laquelle il consigne ses souvenirs d’un passé immédiat ne fait que mettre en évidence une attitude ambiguë que confirmeront ses actes ultérieurs. Comme s’il savait qu’il n’y aurait pas pour lui d’« après-guerre », comme s’il pressentait qu’il devait en être ainsi et qu’il lui fallait maintenant faire ses adieux au passé. Dans quelle mesure dès lors compose-t-il sa propre mort ? Brasillach, qui a 30 ans en 1939, et dont la plus grande hantise a toujours été de vieillir, écrit par exemple dans Les sept couleurs : « Ceux qui meurent peu après la trentaine ne sont pas des consolidateurs, mais sont des fondateurs. Ils apportent au monde l’exemple étincelant de leur vitalité, leurs mystères, leurs conquêtes. Hâtivement, ils montrent quelques routes, à la lueur de leur jeunesse toujours présente. Ils éblouissent, ils interprètent, ils émerveillent5. » Nous savons aussi que des occasions ont été offertes à Brasillach de fuir la France de la Résistance. Il refuse de les saisir. Comme le note par ailleurs Pierre Pellissier dans l’excellente biographie qu’il lui consacre, nul plus que Brasillach lui-même « ne tend plus de pièges sur son chemin, à cette époque [durant l’Occupation] : il semble les creuser de ses mains, comme à plaisir…6. » Nous touchons ici à un aspect tout aussi fascinant que fondamental de Brasillach, qui ne cessera au fil des années d’alimenter sa propre solitude, de développer un discours politique de plus en plus marginal parce qu’intransigeant. En prison, Brasillach compose un « Chant pour André Chénier », victime guillotinée de la Terreur dont il fait un double de lui-même. Et au début de la vingtaine, il avait publié un ouvrage sur Jeanne d’Arc, dont il disait : « Une jeune insolence, une magnifique insolence de jeune sainte. Il n’est pas de vertu dont nous ayons plus grand besoin aujourd’hui7 . »
Ainsi, au début des années 1940, ce n’est plus seulement avec sa propre histoire que Brasillach a rendez-vous, mais avec l’Histoire, dans laquelle il va finir par engloutir sa propre vie, son passé et ses rêves, c’est-à-dire construire son propre héroïsme, faire de sa vie un drame exemplaire et lui donner une grandeur mythique. Et si, à cette figure fascinante, l’on restituait aujourd’hui, au-delà des conflits idéologiques, la place dans l’histoire qui lui convient plus qu’aucune autre, celle de la littérature ?
1. L’enfant de la nuit, par Robert Brasillach, La Palatine, Genève, 1949, p. 242 et 245.
2. Comme le temps passe, dans œuvres complètes, t. 2, par Robert Brasillach, Le Club de l’Honnête Homme, Paris, 1963, p. 17.
3. Les sept couleurs, dans œuvres complètes, t. 2, par Robert Brasillach, Le Club de l’Honnête Homme, Paris, 1963, p. 397 et 437.
4. Cité dans Brasillach le maudit, par Pierre Pellissier, Denoël, Paris, 1989, p. 328.
5. Les sept couleurs, dans œuvres complètes, t. 2, par Robert Brasillach, Le Club de l’Honnête Homme, Paris, 1963, p. 464.
6. Brasillach le maudit, par Pierre Pellissier, Denoël, Paris, 1989, p. 298.
7. Cité dans Brasillach le maudit, par Pierre Pellissier, Denoël, Paris, 1989, p. 92.
Ouvrages de Robert Brasillach :
Romans : Le voleur d’étincelles, 1932, (Godefroy de Bouillon, 1995) ; L’enfant de la nuit, 1934 ; Le marchand d’oiseaux, 1936, (Godefroy de Bouillon, 1995) ; Comme le temps passe, 1937, (Godefroy de Bouillon, 1998) ; Les sept couleurs, 1939, (Godefroy de Bouillon, 1995) ; La conquérante, 1943, (Godefroy de Bouillon, 1997).
Études et essais : Présence de Virgile, 1931 ; Le procès de Jeanne d’Arc, 1932, (Éditions de Paris, 1998) ; Portraits, 1935 ; Histoire du cinéma, en collaboration avec Maurice Bardèche, 1935 ; Animateurs de théâtre, 1936 ; Les cadets de l’Alcazar, en collaboration avec Henri Massis, 1936 ; Léon Degrelle et l’avenir de Rex, 1936 ; Corneille, 1938, (Fayard, 1969) ; Histoire de la guerre d’Espagne, en collaboration avec Maurice Bardèche, 1939, (Godefroy de Bouillon, 1995) ; Les quatre jeudis, 1944.
Mémoires : Notre avant-guerre, 1941, (Godefroy de Bouillon, 1998).
Poésie : Poèmes, 1944.
Publications posthumes : Romans : Six heures à perdre, 1953 ; Les captifs, 1963.
Études et essais : Chénier, 1947 ; Lettre à un soldat de la classe 60, suivi de Les frères ennemis, 1946 ; Anthologie de la poésie grecque, 1950, (Stock, 1991) ; Lettres écrites en prison, 1952 ; Poètes oubliés, 1961 ; Journal : Journal d’un homme occupé, 1955 ; Poésie : Poèmes de Fresnes, 1946, (La table ronde, 1991) ; Psaumes, 1947.
Théâtre : Bérénice, 1954, (Godefroy de Bouillon, 1995) ; Domremy, 1961.
Figurent entre parenthèses les éditions actuellement disponibles.
Ouvrages sur Robert Brasillach : Brasillach ou la trahison du clerc, par Michel Laval, Hachette, Paris, 1992 ; Littérature et fascisme, Les romans de Robert Brasillach, par Luc Rasson, Minard, Paris, 1991 ; Brasillach, par Pascal Louvrier, Perrin, Paris, 1989 ; Brasillach le maudit, par Pierre Pellissier, Denoël, Paris, 1989 ; Robert Brasillach ou Encore un instant de bonheur, par Anne Brassié, Robert Laffont, Paris, 1987 ; La mystique du fascisme dans l’œuvre de Robert Brasillach, par Peter Tame, Nouvelles éditions latines, Paris, 1986.