Animateur hors pair de la scène littéraire acadienne, Melvin Gallant est à l’origine de la création des éditions d’Acadie, la première maison acadienne, de l’Association des écrivains acadiens et des éditions Perce-Neige.
Pionnier, il ouvre la voie, abordant différents genres alors peu ou pas fréquentés. Il y a du missionnaire en lui. Mais surtout, il a une vision de ce que pourraient être la littérature acadienne et l’édition en Acadie. Il juge essentiel de doter l’Acadie d’institutions qui lui sont propres et qui ainsi offriront à la population un regard sur elle-même. Quand il fonde avec d’autres les éditions d’Acadie en 1972, les rares auteurs publient au Québec. Ainsi en est-il pour le poète Ronald Després et pour la romancière Antonine Maillet.
Son œuvre s’ouvre avec la publication de Ti-Jean (1973), un recueil de contes qui relate les aventures de ce personnage légendaire. Ti-Jean-le-Fort suit en 1991. L’importance de l’ouvrage dépasse ses qualités littéraires. Gallant transpose à l’écrit un personnage qui appartient à la culture orale des Acadiens, une première, mais ce faisant, il gomme en partie l’oralité en choisissant une langue plus conforme au standard linguistique : après tout, on doit aussi à ce professeur Initiation à la dissertation (1965). Le succès est immédiat et les contes seront réédités par Bouton d’or Acadie. Constatant que rares sont les œuvres acadiennes qui s’adressent aux filles, Gallant aura alors l’idée de créer Tite-Jeanne, dont il contera les aventures dans une série de trois volumes. De même, la rareté des albums pour les petits enfants l’incite à en publier deux.
Fierté acadienne
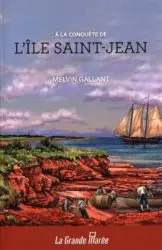 Une autre série d’ouvrages cherche à susciter la fierté acadienne encore fragile durant les années 1970. Dans Portraits d’écrivains (1982), Gallant présente tous ceux qui écrivent, quel que soit le genre, et définit son rêve : « Permettre à tout Acadien ou Acadienne possédé par le besoin de dire, de s’exprimer sur la place publique. Car une collectivité doit avoir une littérature pour devenir un peuple. Ainsi, tout ce que j’ai publié jusqu’à date a pour but de montrer aux Acadiens qu’ils ont un héritage et une culture enviables ». Dans le même esprit, Le pays d’Acadie (1980) trace le portrait des provinces maritimes. Conçu « comme une sorte de document sur l’Acadie contemporaine », l’ouvrage est illustré de photos de l’auteur prises quand il a « parcouru le pays dans tous ses coins et recoins ». Quelques années plus tard, il dirigera la publication du livre Les Maritimes : trois provinces à découvrir (1987), donnant enfin aux écoles acadiennes un manuel en français sur leur région, et celle des actes du colloque international « La mer dans les littératures d’expression française du XXe siècle » (Mer et littérature,1992). Mais son plus grand succès a été – et demeure – La cuisine traditionnelle en Acadie (1975), ouvrage toujours populaire qui a dépassé les 30 000 exemplaires et qui déborde largement du livre de recettes, l’auteur y intégrant l’histoire et les traditions culinaires de l’Acadie, et pimentant l’ensemble de mots propres à l’Acadie.
Une autre série d’ouvrages cherche à susciter la fierté acadienne encore fragile durant les années 1970. Dans Portraits d’écrivains (1982), Gallant présente tous ceux qui écrivent, quel que soit le genre, et définit son rêve : « Permettre à tout Acadien ou Acadienne possédé par le besoin de dire, de s’exprimer sur la place publique. Car une collectivité doit avoir une littérature pour devenir un peuple. Ainsi, tout ce que j’ai publié jusqu’à date a pour but de montrer aux Acadiens qu’ils ont un héritage et une culture enviables ». Dans le même esprit, Le pays d’Acadie (1980) trace le portrait des provinces maritimes. Conçu « comme une sorte de document sur l’Acadie contemporaine », l’ouvrage est illustré de photos de l’auteur prises quand il a « parcouru le pays dans tous ses coins et recoins ». Quelques années plus tard, il dirigera la publication du livre Les Maritimes : trois provinces à découvrir (1987), donnant enfin aux écoles acadiennes un manuel en français sur leur région, et celle des actes du colloque international « La mer dans les littératures d’expression française du XXe siècle » (Mer et littérature,1992). Mais son plus grand succès a été – et demeure – La cuisine traditionnelle en Acadie (1975), ouvrage toujours populaire qui a dépassé les 30 000 exemplaires et qui déborde largement du livre de recettes, l’auteur y intégrant l’histoire et les traditions culinaires de l’Acadie, et pimentant l’ensemble de mots propres à l’Acadie.
L’animateur qu’il est se fera poète avec son unique recueil, L’été insulaire (1982), qui s’inspire de son séjour à Mykonos, en Grèce, ouvrant ainsi l’Acadie à d’autres dimensions que l’identitaire. Par contre, ses quatre romans témoignent de sa volonté de prendre position socialement.
Le chant des grenouilles (1982) raconte le combat de Michel (22 ans) contre la leucémie et contre la société anglophone : les grenouilles sont les french frogs… Si la fin est tragique, mort de Michel et échec du Front commun, un regroupement de jeunes adultes qui revendiquent des droits pour les Acadiens, le roman laisse poindre un espoir. Les dernières paroles de Michel sont un appel à la solidarité et un hymne à la vie. Le cancer de Michel pourrait être une métaphore de l’assimilation qui ronge les Acadiens, tandis que l’échec du Front pourrait signifier que la démarche sera longue et ardue. Roman sombre à la forme un peu décousue, dont le pessimisme sans désespérance pourrait être une réponse à l’essai L’Acadie perdue de Michel Roy (1978) pour qui l’Acadie est vouée à disparaître. Pour Gallant, l’Acadie demeure un « pays » fragile et elle ne devra sa survie qu’à la volonté des Acadiens.
Le complexe d’Évangéline
 Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, il est sensible au danger de l’assimilation. Le complexe d’Évangéline s’attaque au mythe né de la plume de Longfellow : Évangéline représente le passé, la perte de la première Acadie et l’incapacité de recréer le pays ; Évangéline errera à la recherche de son Gabriel, le retrouvera sur son lit de mort à Philadelphie et mourra dans ses bras. Nathalie, le personnage de Gallant, court, elle aussi, à la recherche de son amoureux, de New York à la Louisiane. Mais il ne l’aime plus et elle deviendra amoureuse de Rosenthal, avec qui elle s’installera dans l’Acadie d’aujourd’hui : pour se développer, l’Acadie doit tendre vers demain et s’ouvrir aux autres, ce que symbolise Rosenthal, qui n’est pas un Acadien de souche. Comme le démontre Gallant, le passé doit servir de fondement à l’avenir : le complexe de Nathalie est né de sa fixation sur une relation déjà morte, ce qu’elle se refusait à accepter ; les Acadiens ne doivent pas regretter la première Acadie, mais construire la nouvelle. Fluide, animé d’une plume alerte, écrit au présent à travers le point de vue de Nathalie, qui en est la narratrice, ce roman souffre de certaines longueurs. Mais les personnages sont sympathiques. Gallant excelle dans les anecdotes qui accompagnent l’intrigue principale même si, fondamentalement, la plupart de ces dérives ne font pas avancer l’action.
Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, il est sensible au danger de l’assimilation. Le complexe d’Évangéline s’attaque au mythe né de la plume de Longfellow : Évangéline représente le passé, la perte de la première Acadie et l’incapacité de recréer le pays ; Évangéline errera à la recherche de son Gabriel, le retrouvera sur son lit de mort à Philadelphie et mourra dans ses bras. Nathalie, le personnage de Gallant, court, elle aussi, à la recherche de son amoureux, de New York à la Louisiane. Mais il ne l’aime plus et elle deviendra amoureuse de Rosenthal, avec qui elle s’installera dans l’Acadie d’aujourd’hui : pour se développer, l’Acadie doit tendre vers demain et s’ouvrir aux autres, ce que symbolise Rosenthal, qui n’est pas un Acadien de souche. Comme le démontre Gallant, le passé doit servir de fondement à l’avenir : le complexe de Nathalie est né de sa fixation sur une relation déjà morte, ce qu’elle se refusait à accepter ; les Acadiens ne doivent pas regretter la première Acadie, mais construire la nouvelle. Fluide, animé d’une plume alerte, écrit au présent à travers le point de vue de Nathalie, qui en est la narratrice, ce roman souffre de certaines longueurs. Mais les personnages sont sympathiques. Gallant excelle dans les anecdotes qui accompagnent l’intrigue principale même si, fondamentalement, la plupart de ces dérives ne font pas avancer l’action.
Une histoire d’espoir
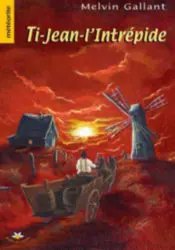 L’histoire a toujours passionné Gallant, qui avait déjà publié un ouvrage sur le voyage de Dièreville en Acadie (1699-1700). Dans Le métis de Beaubassin, il raconte le développement de la seigneurie de Beaubassin de sa création en 1677 à 1720, à travers le regard de Michel Larché, dont le nom se transformera en Haché dit Gallant. Ce « Gallant » est l’ancêtre de l’auteur. Fondé sur une recherche digne de l’universitaire qu’est Gallant, ce roman s’avère passionnant dans sa volonté de recréer la vie quotidienne et les aléas politiques fort nombreux qui animent et bouleversent la colonie naissante. Par un jeu de circonstances, Michel apprend, alors qu’il est jeune adulte, que sa mère était une Autochtone et qu’il est un enfant illégitime. Cette dimension est bien exploitée par Gallant, qui donne à son héros un intérêt presque instinctif pour les premiers habitants, occasion de souligner les relations privilégiées entre ceux-ci, nomades, et les colons, sédentaires. L’opposition des deux modes de vie, les conséquences de chacun de ces deux modes sur l’habitat, les façons de vivre, les structures familiales et les valeurs s’inscrivent dans le récit au fur et à mesure des actes de Michel. Gallant voulait que l’on comprenne et que l’on ressente la manière de vivre de ces paysans et, en cela, ce livre est une excellente évocation de leur mode de vie. On pourrait presque le sous-titrer « La vie quotidienne en Acadie à la fin du XVIIe siècle ». Le roman se termine alors que les Gallant se réfugient à l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), toujours possession française.
L’histoire a toujours passionné Gallant, qui avait déjà publié un ouvrage sur le voyage de Dièreville en Acadie (1699-1700). Dans Le métis de Beaubassin, il raconte le développement de la seigneurie de Beaubassin de sa création en 1677 à 1720, à travers le regard de Michel Larché, dont le nom se transformera en Haché dit Gallant. Ce « Gallant » est l’ancêtre de l’auteur. Fondé sur une recherche digne de l’universitaire qu’est Gallant, ce roman s’avère passionnant dans sa volonté de recréer la vie quotidienne et les aléas politiques fort nombreux qui animent et bouleversent la colonie naissante. Par un jeu de circonstances, Michel apprend, alors qu’il est jeune adulte, que sa mère était une Autochtone et qu’il est un enfant illégitime. Cette dimension est bien exploitée par Gallant, qui donne à son héros un intérêt presque instinctif pour les premiers habitants, occasion de souligner les relations privilégiées entre ceux-ci, nomades, et les colons, sédentaires. L’opposition des deux modes de vie, les conséquences de chacun de ces deux modes sur l’habitat, les façons de vivre, les structures familiales et les valeurs s’inscrivent dans le récit au fur et à mesure des actes de Michel. Gallant voulait que l’on comprenne et que l’on ressente la manière de vivre de ces paysans et, en cela, ce livre est une excellente évocation de leur mode de vie. On pourrait presque le sous-titrer « La vie quotidienne en Acadie à la fin du XVIIe siècle ». Le roman se termine alors que les Gallant se réfugient à l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), toujours possession française.
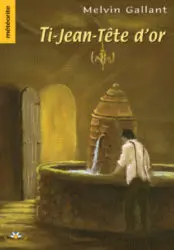 À la conquête de l’île Saint-Jean (2016) relate les aléas de la vie quotidienne de Michel et de sa famille de 1720 à la mort du personnage, en 1737. Comme il le faisait à Beaubassin, il tisse des liens d’amitié avec les Autochtones qui habitent leur secteur de l’île. Cette situation permet à Gallant de brosser un portrait de la politique coloniale française dans cette colonie sous la dépendance de Louisbourg, de la façon de vivre des Micmacs, sans oublier les us et coutumes des Acadiens et en particulier en détaillant les principaux menus d’Anne, la femme de Michel, évocation du livre de recettes de Gallant. Cette précision dans la description des habitudes culinaires de la famille Gallant s’étend à toutes les autres facettes de leur vie. Gallant reprend « Le moulin du diable », un des contes de Ti-Jean, qu’il met dans la bouche d’un des fils de Michel, autre clin d’œil qui donne une touche plus affective à un ouvrage qui demeure important par la grande qualité du portrait qu’il trace d’une époque trop souvent réduite à une image d’Épinal.
À la conquête de l’île Saint-Jean (2016) relate les aléas de la vie quotidienne de Michel et de sa famille de 1720 à la mort du personnage, en 1737. Comme il le faisait à Beaubassin, il tisse des liens d’amitié avec les Autochtones qui habitent leur secteur de l’île. Cette situation permet à Gallant de brosser un portrait de la politique coloniale française dans cette colonie sous la dépendance de Louisbourg, de la façon de vivre des Micmacs, sans oublier les us et coutumes des Acadiens et en particulier en détaillant les principaux menus d’Anne, la femme de Michel, évocation du livre de recettes de Gallant. Cette précision dans la description des habitudes culinaires de la famille Gallant s’étend à toutes les autres facettes de leur vie. Gallant reprend « Le moulin du diable », un des contes de Ti-Jean, qu’il met dans la bouche d’un des fils de Michel, autre clin d’œil qui donne une touche plus affective à un ouvrage qui demeure important par la grande qualité du portrait qu’il trace d’une époque trop souvent réduite à une image d’Épinal.
Dans les deux romans, on a parfois l’impression que Gallant a adopté le point de vue du documentariste. Si ce choix permet de bien saisir les complexités de la vie de l’époque, le récit devient alors plus distancié, comme si l’historien l’emportait sur le romancier. On se surprend à souhaiter que l’auteur se laisse mener par son récit plutôt que de tant le contrôler. On sent également la volonté de Gallant d’écrire une histoire qui ne se terminera pas avec la Déportation. Les enfants de Michel demeureront sur l’île et leurs descendants y habitent toujours : l’Acadie des Maritimes ne mourra jamais.
Toute l’œuvre – et toute la vie – de Gallant est un chant d’espoir en l’Acadie même si celui-ci sait que l’Acadie sera toujours fragile. En cela, et malgré ses failles, elle est essentielle à qui s’intéresse à l’Acadie.
Biographie
Melvin Gallant est né le 24 mai 1932 à Urbainville (Île-du-Prince-Édouard). Il obtient un baccalauréat en sciences commerciales de l’Université Saint-Joseph de Memramcook, puis un diplôme en sciences politiques de l’Université de Paris, une maîtrise ès arts de l’Institut catholique de Paris et un doctorat ès lettres de l’Université de Neuchâtel en Suisse. Il est professeur de littérature à l’Université de Moncton de 1964 à 1993, année où il prend sa retraite. Depuis, il se consacre à l’écriture, tout en continuant à s’impliquer dans certains organismes culturels.
Melvin Gallant a publié :
Initiation à la dissertation, Librairie acadienne, 1965 ; Le thème de la mort chez Roger Martin du Gard, Klincksieck, 1971 ; Ti-Jean, illustrations de Bernard LeBlanc, D’Acadie, 1973 ; La cuisine traditionnelle en Acadie (avec Marielle Cormier Boudreau), D’Acadie, 1975, Stanké, 1980 et De la Francophonie, 2015 ; Le pays d’Acadie, D’Acadie, 1980 ; Portraits d’écrivains. Dictionnaire des écrivains acadiens, Perce-Neige/D’Acadie, 1982 ; Caprice à la campagne, D’Acadie, 1982 ; L’été insulaire, D’Acadie, 1982 ; Le chant des grenouilles, prix France-Acadie, D’Acadie, 1982 ; Caprice en hiver, D’Acadie, 1984 ; Dièreville : voyage à l’Acadie, 1699-1700, D’Acadie/Société historique acadienne, 1985 ; Les Maritimes : trois provinces à découvrir (dir.), D’Acadie, 1987 ; Ti-Jean-le-Fort, D’Acadie, 1991 ; Mer et littérature (dir.), D’Acadie, 1992 ; Tite-Jeanne et le prince triste, Bouton d’or Acadie, 1999 ; Le complexe d’Évangéline, De la Francophonie, 2001 ; Patrick l’internaute, Chenelière/McGraw-Hill, 2003 ; Tite-Jeanne et la pomme d’or, Bouton d’or Acadie, 2000 ; Tite-Jeanne et le prince Igor, Bouton d’or Acadie, 2004 ; Ti-Jean-le-Brave, nouvelle édition révisée, Bouton d’or Acadie, 2005 ; Ti-Jean-le-Rusé, nouvelle édition révisée, Bouton d’or Acadie, 2006 ; Ti-Jean-l’Intrépide, nouvelle édition révisée, Bouton d’or Acadie, 2007 ; Le métis de Beaubassin, De la Francophonie, 2009 ; Ti-Jean-Tête-d’Or, nouvelle édition révisée, Bouton d’or Acadie, 2010 ; À la conquête de l’île Saint-Jean, La Grande Marée, 2016.
EXTRAITS
Puis avec le temps, j’ai acquis la conviction que l’avenir de l’Acadie allait se jouer sur le plan politique. Il fallait donc donner une tribune aux idées politiques afin qu’elles circulent, qu’elles s’infiltrent progressivement, pour convaincre un trop grand nombre d’Acadiens et d’Acadiennes satisfaits du statu quo à travers lequel ils s’assimilent, non pas linguistiquement mais moralement, sans même s’en rendre compte.
Témoignage de Melvin Gallant dans Portraits d’écrivains, 1982, n. p.
Les Acadiens en sont ainsi arrivés à constituer une force – une force qui inquiète beaucoup d’anglophones qui se sont toujours crus rois et maîtres du pays. C’est la raison pour laquelle ils n’ont jamais voulu reconnaître les Acadiens comme membres-fondateurs de ce pays. Et même en 1980, ils ne sont toujours pas prêts à leur concéder le titre de « peuple » qui les mettrait sur un pied d’égalité avec les anglophones. Pour eux, les Acadiens font tous partie d’un seul et même peuple : le peuple canadien. Mais l’Acadien n’est pas prêt à lâcher son identité, sa langue et sa culture pour s’assimiler à une race qui voudrait tout niveler à la manière américaine. Depuis le temps qu’il habite ce pays, il estime avoir droit à sa différence et compte le revendiquer.
Le pays d’Acadie, p. 22.
Thomas s’était procuré à Port-Royal du rhum de la Martinique qu’il proposait aux hommes et jeunes adultes dès qu’ils arrivaient. Lorsqu’ils furent tous là, il alla chercher son fusil et en tira trois coups dans les airs pour souhaiter bonne chance aux nouveaux mariés. Comme à l’accoutumée dans les fêtes de ce genre, chacun se devait d’apporter son gobelet. Quant aux assiettes, il était toujours possible d’en fabriquer, comme Thomas l’avait fait. Avec l’aide de ses fils, il avait transporté un gros billot au moulin et l’avait fait trancher en galettes d’un pouce, ce qui donnait de jolies assiettes qui pouvaient par la suite être utilisées comme roues de brouettes ou de petits chariots de transport, ou tout simplement être brûlées dans la cheminée.
Le Métis de Beaubassin, p. 175-176.
Depuis la signature du traité d’Utrecht, en 1713, l’Acadie avait été cédée aux Britanniques et ces derniers régnaient en rois et maîtres. Ils avaient rebaptisé l’Acadie « Nova Scotia » et exigeaient de plus en plus de compromis de la part des Acadiens. Par exemple, Michel devait leur fournir une quantité de bois de chauffage chaque année, de même qu’un cochon et parfois un agneau ou même un bœuf. Mais le pire, c’était leur insistance à lui faire signer un serment d’allégeance à la couronne d’Angleterre.
Signer ce document aurait voulu dire devenir citoyen britannique, renoncer à la religion catholique et, en cas de conflit entre les deux pays, accepter de prendre les armes contre les Indiens et les Français du Canada. Ça non. Il ne pouvait tout simplement pas. Tous ces tracas étaient maintenant une chose du passé. Du moins, il l’espérait. Il voulut néanmoins se faire rassurant auprès de ses enfants.
— Vous savez les enfants, la vie va sans doute être un peu plus difficile ici qu’à Beaubassin, du moins au début, car tout est à faire. Nous sommes des pionniers. Nous venons ici pour fonder une colonie, il ne faut pas l’oublier. Il s’agit d’une responsabilité que nous devons assumer avec détermination, optimisme et ouverture d’esprit. Nous sommes les premières personnes de l’Acadie à venir nous installer à l’île Saint-Jean. Il faut montrer aux autres qu’il s’agit d’un choix viable.
À la conquête de l’île Saint-Jean, p. 11.











