La Gaspésie. Une péninsule au bout de la terre. Baignée par la mer, secouée par le vent. Françoise Bujold est née à Bonaventure le 6 mars 1933 et sa région natale ne la quittera jamais tout comme elle ne la quittera pas. Car la Gaspésie est le sujet de son œuvre poétique et théâtrale, ainsi que l’inspiration fondamentale de ses œuvres picturales1.
Cinquième et avant-dernière enfant d’Élise Grenier et Oscar Bujold, un prospère homme d’affaires, elle affirme tôt son talent pour la peinture et son penchant pour l’écriture. Dotée d’une santé fragile sans que l’on puisse en déterminer exactement la cause, elle passe une enfance sans histoire avant de se retrouver au pensionnat des Sœurs de la congrégation de Notre-Dame à Montréal en septembre 1949.
Si ses premières toiles expriment son amour de la mer tout en demeurant timidement réalistes, l’écriture s’impose comme un exutoire : « J’ai commencé à écrire à 16 ans parce que la vie m’était insupportable2 ». Elle quitte le couvent en 1952 et à partir de septembre (et jusqu’à la fin de sa vie), elle vit tantôt à Montréal, tantôt en Gaspésie, sans véritable travail. En 1953, elle publie ses premiers poèmes-affiches, « La prophétie du tournoi » et « Les bohémiens ».
Elle découvre la gravure grâce à son ami d’enfance Réal Arsenault (né en 1931), qui étudie à l’École des arts graphiques (qui devient Institut en 1956), et elle décide de s’y inscrire en 1952. Elle est refusée à deux reprises. Comme aucune jeune fille ne fréquente cette école, on peut penser que la direction préfère le statu quo… Finalement, en 1954, elle et sœur Marie-Anastasie sont acceptées. Elle terminera son cours en mai 1960.
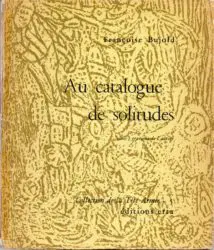 Son premier recueil, Au catalogue de solitudes (1956), est édité par Roland Giguère, qui a fait l’École, aux éditions Erta qu’il avait fondées en 1949. Illustré de trois gravures, ce livre présente les thèmes qui nourriront l’œuvre de Françoise Bujold : la solitude, la difficulté d’aimer, la mer, la maladie, thèmes qui expriment sa douleur d’être dans une « langue robuste et souple et une imagerie primitive fortement personnelle3 ».
Son premier recueil, Au catalogue de solitudes (1956), est édité par Roland Giguère, qui a fait l’École, aux éditions Erta qu’il avait fondées en 1949. Illustré de trois gravures, ce livre présente les thèmes qui nourriront l’œuvre de Françoise Bujold : la solitude, la difficulté d’aimer, la mer, la maladie, thèmes qui expriment sa douleur d’être dans une « langue robuste et souple et une imagerie primitive fortement personnelle3 ».
Elle prépare un deuxième recueil, mais Roland Giguère est retourné en France et par conséquent les éditions Erta sont inactives. Elle décide de fonder les éditions Goglin (un personnage de la mythologie gaspésienne) et d’imprimer les livres chez Pierre Guillaume, qui a acheté le matériel de Giguère. Le livre sort en octobre 1958, illustré de quatre gravures. Roger Duhamel note dans La Patrie du 11 janvier 1959 qu’« il court dans ce petit recueil un air de santé qui est bien réconfortant en un temps où des jeunes très doués se vautrent dans la désespérance ». Françoise Bujold y reprend les thèmes d’Au catalogue de solitudes, tout en plaçant la mer au centre de son univers, et y ajoute une touche d’humour noir dans « Poème méchant ». Ce livre annonce ce qu’elle écrira dans ses textes radiophoniques, où s’affirmera son originalité.
Elle passe l’été 1959 à Percé (elle y passera de nombreux étés), enseignant la gravure aux enfants à l’École du Centre d’art qu’ont fondé en 1954 la sculpteure Suzanne Guité et son mari Alberto Tommi. Elle oriente son atelier vers un projet de livre d’artiste, demandant aux enfants de graver chacun un élément d’un conte-prétexte, L’île endormie, qu’elle a écrit pour la circonstance.
L’aventure des éditions Goglin, à laquelle se joint son amant Guy Robert, sera de courte durée et se terminera avec la séparation du couple en janvier 1960. Néanmoins, la maison aura publié quatre ouvrages : deux recueils de poésie, L’eau, la montagne et le loup de Guy Arsenault, un jeune poète de Bonaventure, et Broussailles givrées de Guy Robert, ainsi que deux livres d’artiste, Sept eaux-fortes et L’île endormie. Il s’agit des premières grandes éditions originales faites entièrement au Québec. Sept eaux-fortes consacre la vitalité et la richesse artistiques des jeunes graveurs formés directement ou indirectement par Albert Dumouchel.
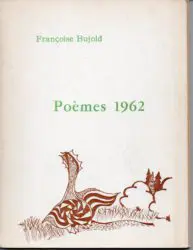
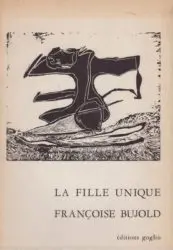 Françoise Bujold publiera trois autres livres d’artiste aux éditions Sentinelle, qu’elle crée pour l’occasion : La Lune au village (1960) avec les enfants du Centre d’art, Une fleur debout dans un canot et Nagoseteoalesit, la naissance du soleil (1966) avec les enfants micmacs de Gesgapegiag.
Françoise Bujold publiera trois autres livres d’artiste aux éditions Sentinelle, qu’elle crée pour l’occasion : La Lune au village (1960) avec les enfants du Centre d’art, Une fleur debout dans un canot et Nagoseteoalesit, la naissance du soleil (1966) avec les enfants micmacs de Gesgapegiag.
On ne connaît pas l’élément déclencheur qui a conduit Françoise Bujold à l’écriture radiophonique. On ne connaît même pas tous les textes qu’elle a écrits pour la radio : la plupart de ses manuscrits ont disparu tandis que Radio-Canada a détruit une bonne partie de ses archives sonores4.
On sait toutefois qu’elle participe à trois émissions pour lesquelles elle écrit des « fantaisies », courts textes qui laissent la part belle à son imaginaire. À peu près rien n’a été préservé de sa collaboration à Par un beau dimanche (1958-1959), il ne reste qu’un texte, Du côté de l’ombre (été 1960). Par contre, les textes qu’elle a écrits pour La Puce à l’oreille (de mars à septembre 1959) sous le titre de Lettres à toi qui n’es pas né au bord de l’eau, qu’elle signe sous le pseudonyme de La Marmarelle, ont été publiés par les éditions d’Orphée (1987). De plus, des huit radiothéâtres diffusés entre avril 1959 et avril 1961, deux ont été publiés dans La Piouke, fille unique (1982) ; l’ensemble de ses textes dramatiques est ensuite paru dans À toi qui n’es pas né au bord de l’eau (2010).
Françoise Bujold cherche à transcrire la qualité sonore de la langue des siens en lui donnant une dimension lyrique. Elle valorise la langue de sa région natale sans la calquer mais en préservant l’essence de son chant mélodique. Elle est attentive aux mots qui traduisent les métiers, les coutumes, les gestes, les éléments, les expressions, les particularismes morphologiques et syntaxiques. Elle explore une langue qui lie les facettes de son être : l’intériorité de la démarche spirituelle, philosophique, affective et l’extériorité de la démarche de communication, de partage, de résonance, de ressemblance. Chaque projet d’émission pose des questions particulières au regard de la langue et du contenu, et la préoccupation linguistique semble beaucoup rattachée à la série dans laquelle la dramatique s’inscrit et à son réalisateur. Ces textes relèvent plus de la poésie que de tout autre genre : l’expression est essentiellement sensitive, et tant les personnages que l’intrigue et les dialogues s’incarnent dans un récitatif qui doit à plusieurs traditions, mais qui est d’abord et avant tout poème.
Les Lettres à toi qui n’es pas né au bord de l’eau sont des « lettres » qu’une femme adresse à un ami de la ville qui pourrait être son amant. Ces textes sont en bonne partie autobiographiques et fortement marqués par la région de Bonaventure. La convention narrative est ténue et le scénario quasi inexistant. Comme dans une véritable correspondance, la narratrice raconte son séjour dans son village d’origine, qui dure tout l’été. Tout y passe : ses hauts et ses bas, ses rencontres, ses inquiétudes, ses expériences, ses relations avec les autres. Chaque lettre met en relief un événement, une émotion, une réflexion, point de départ et d’arrivée entre lesquels l’auteure peut dériver sur un mode surréaliste. De plus, elle met l’accent sur la richesse lexicale gaspésienne.
Six des huit radiothéâtres présentent, eux aussi, différents aspects de la vie en Gaspésie.
Le cœur de l’homme est une péninsule et Mon pas qui rôde évoquent la Gaspésie sur un mode dramatico-poétique. La qualité de ces deux textes tient dans l’atmosphère qui se dégage de cette écriture poétique très particulière. Les personnages sont réalistes, mais leurs discours tendent plus à décrire, ou mieux à faire ressentir, la relation entre la mer, la Péninsule et les humains qu’à nourrir une intrigue.
Mouille, mouille Paradis et Saison, je te nommerai la Barbelée sont des évocations de la Péninsule. Par touches romantiques, symbolistes et surréalistes, elle peint des aspects de son pays et de ses habitants. Elle y fouille plus particulièrement les liens entre comptines enfantines et langue régionale.
Ils sont venus chercher notre fleur met en scène des personnages qui vivent une situation un peu étrange mais vraisemblable. Chaque scène aura permis de présenter quelques coutumes populaires gaspésiennes. Les actions vécues et les actions relatées sur un mode narratif alternent, ce qui donne au texte un caractère poétique et une irréalité dramatique, même si la langue utilisée est familière et proche des personnages.
25 d’avri, avons parti est l’unique texte totalement réaliste et porteur d’une véritable intrigue. L’histoire se déroule de la préparation de la saison de pêche à la fin d’avril à la fête des pêcheurs, fin juin. L’auteure tente de rendre le lexique, la syntaxe et la phonologie du français de la Gaspésie.
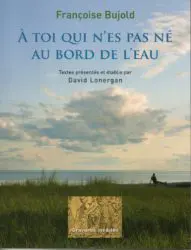 Deux des radiothéâtres diffèrent dans leur forme des autres textes plus explicitement gaspésiens. Ville ô ! mon cœur ! raconte la mésadaptation à la ville d’une jeune fille à laquelle compatissent un marin et une bohémienne, et que commentent, un peu à la façon d’un chœur grec, la foule et le prophète. Le triptyque La belle qui fait la morte est plus un récitatif qu’un texte théâtral. Un narrateur raconte la quête de Vallée à la recherche d’un pays qui serait le sien. La quête est symbolique, le pays intérieur. Durant cette errance, Vallée rencontre des personnages porteurs de leurs mondes et des valeurs de ces mondes. Une chouette lui raconte l’histoire de Belle, un coq celle de Glèbe, mises en abyme de son monde. Le fait que le narrateur dise la moitié du texte accentue l’impression d’entendre un récit plutôt qu’un radiothéâtre. Demeure ce long murmure de mots qui flottent sur les ondes, flot continu, récité plutôt qu’interprété, à la limite du chant grégorien.
Deux des radiothéâtres diffèrent dans leur forme des autres textes plus explicitement gaspésiens. Ville ô ! mon cœur ! raconte la mésadaptation à la ville d’une jeune fille à laquelle compatissent un marin et une bohémienne, et que commentent, un peu à la façon d’un chœur grec, la foule et le prophète. Le triptyque La belle qui fait la morte est plus un récitatif qu’un texte théâtral. Un narrateur raconte la quête de Vallée à la recherche d’un pays qui serait le sien. La quête est symbolique, le pays intérieur. Durant cette errance, Vallée rencontre des personnages porteurs de leurs mondes et des valeurs de ces mondes. Une chouette lui raconte l’histoire de Belle, un coq celle de Glèbe, mises en abyme de son monde. Le fait que le narrateur dise la moitié du texte accentue l’impression d’entendre un récit plutôt qu’un radiothéâtre. Demeure ce long murmure de mots qui flottent sur les ondes, flot continu, récité plutôt qu’interprété, à la limite du chant grégorien.
Françoise Bujold n’écrit pas comme on parle. Elle écrit comme on rêverait de parler. Pour donner un effet de langue parlée, elle utilise différentes formes linguistiques : omission du « ne » dans la négation, tournures interrogatives multiples, parataxe, futur périphrastique, reprise du nom par un clitique sujet, particularismes morphologiques ou syntaxiques… Elle intègre également dans ses textes des expressions typiques et des mots régionaux. Elle insuffle le mouvement de la parole dans la rythmique de sa phrase, employant différents niveaux de langue, langue familière et langue un peu plus « populaire traditionnelle », langue parlée et langue poétique.
La démesure du pays s’exprime par de grands chants. Comme la mer qui déferle et qui se retire, qui anime cette immensité plate, comme ce pays aux profondeurs insondables, comme cette nature riche en sons, en odeurs, en goûts, en textures et en couleurs, les textes bougent et débordent de tout ce qu’ils contiennent.

L’écriture libère des flots de mots qui se jettent sur les pages, et les phrases se bousculent, chacune poussant l’autre plus avant. La ponctuation est ouverte et la virgule permet une courte respiration qui relance aussitôt la phrase tout comme les mots s’appellent d’une sonorité à l’autre. L’écriture devient picturale. On voit le pays et ses gens, on goûte la mer et ses fruits, on ressent aussi l’oppression qui écrase, car ce pays n’est pas que le paradis, il est aussi l’enfer. Comme dans ses œuvres picturales, Françoise Bujold travaille par touches, par taches de couleurs, par traits.
Le cycle des textes radiophoniques se termine en 1961. Un autre cycle débute. Dominé par les arts visuels, il est tout aussi intense et dure quatre ans.
En 1964, Françoise Bujold subit ce qui s’avère sa première crise de psychose maniaco-dépressive. À partir de ce moment, sa vie déprendra de son état de santé, qui entraînera plusieurs hospitalisations, certaines de longue durée. Elle amorcera de nombreux projets littéraires ou picturaux, mais ne réussira à en mener à terme que peu. Le cancer l’emportera le 16 janvier 1981.
Peut-être faut-il voir dans Lettres à toi qui n’es pas né au bord de l’eau et dans La belle qui fait la morte, ses deux chefs-d’œuvre, cette dualité qui l’habitait. Si La Marmarelle vit au paradis, Vallée se débat en enfer. Comme Françoise Bujold aux prises avec cette maladie mentale qui l’a conduite de l’autre côté du miroir.
1. Cet article reprend des éléments de l’introduction de ma thèse de maîtrise, Françoise Bujold, œuvres radiophoniques (p. 7-77, Université de Moncton, 1995), reprise en partie dans À toi qui n’es pas né au bord de l’eau (p. 17-39), publié aux éditions Trois-Pistoles.
2. Entrevue réalisée par Gaëtan Dostie, 1978.
3. Fernande Saint-Martin, « Exploration de la solitude humaine », La Presse, 30 mars 1957.
4. Lire à ce propos les travaux de Renée Legris dans L’Annuaire théâtral, n° 9, printemps 1991, et Répertoire des œuvres de la littérature radiophonique québécoise 1930-1970 de Pierre Pagé avec la collaboration de Renée Legris et Louise Blouin (Fides, 1975).
Françoise Bujold a publié :
Livres : Au catalogue de solitudes, poèmes illustrés par l’auteure, Erta, 1956 ; La fille unique, poèmes illustrés par l’auteure, Goglin, 1958 ; Piouke, fille unique, poèmes, radiothéâtres, essais, correspondance, Parti-Pris, 1982 ; Poèmes 1962, poèmes, D’Orphée 1984 ; La Marmarelle, fantaisies, D’Orphée, 1987 ; À toi qui n’es pas né au bord de l’eau, textes présentés et établis par David Lonergan, Trois-Pistoles, 2010.
Livres d’artistes : « La prophétie du tournoi », poème-affiche, sans doute 1953 ; « Les bohémiens » [sans doute avec Gilles Constantineau], poème-affiche, 1953 ; L’île endormie, conte illustré par les enfants du Centre d’art de Percé, Goglin, 1959 ; La Lune au village, conte illustré par les enfants du Centre d’art de Percé, Sentinelle, 1960 ; Une fleur debout dans un canot, poème illustré par les enfants micmacs de la réserve indienne de Maria, Sentinelle, 1962 ; Nagoseteoalesit, la naissance du soleil, fragments de la mythologie des anciens Micmacs illustrés par les enfants micmacs de la réserve indienne de Maria, Sentinelle, 1966 ; Ah ! ouiche-t’en-plain, poème illustré par Kittie Bruneau, La Guilde graphique, 1974.
EXTRAITS
OTAGE
Sais-tu que tu paies par une descente dans l’eau noire
Le cœur d’une étoile !
Au catalogue de solitudes se vendent très cher les dons gratuits
Il y a le grand compartiment de la vie
Qui travaille
Les affaires de l’avant-midiÙ
Il y a la perle de la mer qui projette l’amour aux yeux de fille
Beauté qui fait la guerre
Et ces découvertes entre nous
Pour assister en paix aux funérailles des fleurs fanées
Elle est venue à la rencontre des grimaces de la vie
Et pour ne pas mourir
Elle a provoqué des unions prématurées
C’est la musique que fait la mer qui est si belle
Ce sont les coquillages de la grève qui sont si blonds
Et les rochers des vagues rageuses qui sont si profonds
Mais tu as payé si cher l’aventure
Qu’il n’y a pas d’amour heureux
Au catalogue de solitudes, n. p.
PEINE PERDUE
Le jour est maigre
Et la souffrance est
De temps en temps
Des gens se visitent
Le plus souvent
Une femme se tait
Un homme charrie la vie
Miette par miette
Les soirs se sont accoudés
Les mains se sont munies de bonne volonté
Pour regarder venir
Dans cette allée
Un mirage de l’amour
Une fois dans l’année
Une femme a murmuré
Un homme vient d’abandonner sa brouette
La vie se gaspille
Miette par miette
Les soirs se sont mis au lit
Les mains se sont décroisées
À qui remettre ces bouches bées ?
Le jour est maigre
Et la souffrance est
La fille unique, n. p.
Je ne t’ai pas dit que j’étais arrivée par train. Et une fois arrivée dans mon village, je suis allée chez tous les voisins. Et les voisins me disaient en souriant : pas fâchée d’être en vacances ? Et moi, je répondais : vacances, vacances ! Je n’étais plus un être humain. J’étais une île d’éther, un bagage en sommeil, une terre de lin. Je me suis vautrée dans le foin, dans l’anis, dans les amoureux, dans les pissenlits qui avaient passé fleur, je me suis vautrée dans le vert, dans le roux, dans le noir, dans le bleu, je me suis vautrée dans la terre, je me suis vautrée dans la mer, j’en ai mangé de la terre, j’en ai bu de la mer. J’avais trop rôdé dans ma chambre, comme une bête, en espérant le jour du train et sa petite fenêtre qui m’emmènerait comme un dragon en furie, dans mon bout de pays. Le train avait déjà le bout du nez entré dans la mer et il me montrait mon pays, fleur par fleur, sapin par sapin, rocher par rocher, petit peu de mer par petit peu de mer, minute de lumière par minute de lumière, seconde de vie par seconde de vie et moi, je riais, et moi, je souriais, comme une enfant qui ne comprend rien à une tapisserie. C’est peut-être ça, le bonheur : revenir dans son pays… Ah ! je veux te parler du premier repas que j’ai pris ! Peut-être que tu ne connais pas ça, peut-être que tu n’aurais pas aimé ça ! C’est de la cambuse : des têtes et des foies de morue cuits dans un peu d’eau salée ; on mange ça avec des patates pas pelées et des oignons crus, sur un coin de table, sur le tapis ciré. On regarde dehors, on s’étire, on mange de la tarte à la farlouche ; ça, c’est de la tarte à la mélasse ; on prend du thé et puis on rit. Une fois arrivée dans ma maison, j’ai retrouvé mes vieux habits, c’est comme des vieux jouets pour un enfant, on ne se fatigue pas de les porter, de les charrier, de les user, de les aimer. J’ai un sawech ; c’est un casque en toile cirée comme en portent les pêcheurs ; je le porte quand il pleut, quand je m’ennuie, quand je vais au bout du quai, quand je veux que personne ne me parle ; un sawech, c’est un signe de tempête ; je l’ai souvent sur la tête. J’habite un village où les vaches ont encore le droit d’arrêter le trafic à cinq heures ; elles marchent dans le chemin, elles marchent sur le trottoir, elles marchent sur la promenade ; elles mangent du foin, elles ruminent, elles jonglent, elles songent, elles se lamentent ; elles descendent à la mer, elles entrent dans la cour du voisin quand la porte du cléon n’est pas bien fermée ; elles ne sont pas pressées, les vaches, elles sont bien. J’habite un village de mottes de terre, d’abris, de vents froids, de brises sur la mer. J’habite ce village-ci pour je ne sais combien de temps. Il me prendra une idée d’aller me reposer ailleurs, dans un sable plus chaud, plus rose, plus beau, et je partirai ; je partirai pour l’anse, pour le plain, pour le chenail, pour la grave, je partirai pour l’île où les filles disent : « J’aime autant être noire et ignorante, qu’être blanche et savante. » J’irai à la pêche au hareng, à la morue, aux poules d’eau, aux chancres, aux barlicocos, à la plie, au caplan, à l’éperlan qui vient terrir sur la grève. J’irai à la pêche aux étoiles de mer, au goémon, j’irai à la pêche aux petits couteaux qu’on pêche avec nos dents en plongeant dans la mer. J’irai à la pêche au bonheur. Mais ce soir, le soleil a son bras en écharpe. Le vent renifle aux portes, la mer joue aux oiseaux et les oiseaux jouent à la mer. Et quand la mer joue aux oiseaux, elle reste longtemps dans le ciel comme une statue de sel, elle ne bouge pas. Tout à coup, elle se souvient qu’elle appartient à l’eau et, là, elle redescend avec sa façon argentée, avec le comment faire des oiseaux, avec toutes leurs manières, comme si, elle, la mer, avait habité chez eux longtemps, comme si elle voulait les imiter. Et pendant que la mer joue aux oiseaux, les oiseaux, eux, jouent à la mer. Ils ne volent plus, ils voguent. Ils s’en vont avec des gestes étroits, des gestes salés et gelés. Ils s’en vont en poussant devant eux des petits moutons, à la façon des bergers, des petites bêtes blanches de coton, des petits collets de fourrure qu’ils vont immoler sur la jambe aiguisée d’un rocher. Et si la mer joue aux oiseaux et les oiseaux à la mer, c’est à cause du vent, du vent qui avait beaucoup trop d’énergie pour cette première, pour cette petite journée que je t’envoie avec le vent, en laissant mon haleine dans ta fenêtre, du vent qui est passé en te disant : je t’aime.
À toi qui n’es pas né au bord de l’eau, « Lettres à toi qui n’es pas né au bord de l’eau », p. 109.
Narrateur
Ils habitaient un pays de sorcières, de bateaux en feu sur la mer. Ils habitaient un pays de poignets nerveux, de femmes aveugles, d’enfants muets. Un pays de fleurs sauvages qui sentait bon le muguet. À midi, la table était mise. Les serviettes ne glissaient pas sur les genoux. Les hommes parlaient du gravier mouillé au seuil des portes, les hommes parlaient d’un soleil droit, modeste et résigné. Et les femmes, blêmes comme des coiffes, ne parlaient pas. La neige venait trois fois plus souvent que l’été. Les enfants gardaient le lit avec la fièvre dans leurs poings fermés, la fièvre dans leurs voix entêtées, la fièvre dans leurs bras. Et un jour, les enfants ne jouaient plus avec les flacons vidés d’odeurs, et un jour les enfants n’enterraient plus les sous de leurs sœurs dans le sable mouillé. Et selon leurs maux de croissance, ils devenaient des filles ou des garçons sans importance. Ils avaient tous été faits la même année par devoir d’honnêteté. Ils portaient des noms différents, c’était pour les distinguer. Ils étaient bruns ou blonds ou chagrinés, ils étaient violents ou espions. De toute façon les enfants qui n’étaient plus des enfants devenaient l’inquiétude des parents. Au pays des cœurs tendus, des mains crispées, les enfants couchaient la tête au pied du lit. Les enfants ouvraient leurs yeux sur un plafond blanc et leurs voix réveillaient les parents au milieu de la nuit. Les enfants apeurés, porteurs de germes, malades, infirmes, impuissants comme une miette de pain oubliée dans un tablier. Les parents se levaient ébahis, encore endormis, sur la pointe des pieds, sur la pointe du pays, ils parvenaient aux petits, blanchis d’inquiétude, ridés, vieillis, malheureux d’être réveillés, enlaidis de fatigue. Et les parents qui n’étaient pas instruits, qui ne comprenaient pas le langage de la maladie, soufflaient de la fumée dans les oreilles des enfants, et les parents qui n’étaient pas instruits se tenaient bons, commodes, fidèles, dévoués sur des chaises droites, et résignés durant toute la nuit. La veilleuse, les pots de crème, les mains, le ventre, la fièvre parlaient et les parents ne parlaient pas. Les parents respectaient cette présence nocturne qu’était l’enfant malade. Au pays des mares d’eau, des mottes de terre, des quatre saisons en équilibre, il y avait révoltes, tumultes, conflits. Quand les femmes ne courbaient plus leurs corps sous le désir de l’homme comme des gerbes de blé sous le vent, quand leurs flancs n’étaient plus volontaires, bénévoles ou figés de peur, quand dans leurs têtes à elles, elles apprenaient des airs de liberté par cœur, quand elles n’avaient pas encore tout à fait guéri les élans inoffensifs de la solitude, quand elles se souvenaient en sourdine et en regret de leur nom de jeune fille, les hommes partaient à cheval sur la haine avec des gorgées d’alcool dans leurs gosiers pour prouver leur puissance. La pitié, en femme patiente, hautaine et dédaigneuse, se penchait pour ramasser les débris de guerre. Le cœur de l’homme était blessé de refus, coupable de départ et de fugue, incompris dans son corps, car on avait permis, promis au garçon des corps en travail, des veines qui tambourinent, des cœurs qui cognent, des lampes allumées dans les yeux et le droit de choisir. Les filles étaient nées avec des tempes fragiles, des mains gentes, des ventres éteints, un regard mat, sans espoir, signé d’attente, et leurs têtes ignoraient que leurs corps auraient dû être une avalanche de joie, un grand sourire dans le vent, un fruit qui se laisse cueillir parce qu’aimé. Les garçons qui marchaient avec leurs pieds humides dans les joncs et les garçons qui cassaient des noisettes avec leurs dents en santé ne pouvaient pas soupçonner que sous ces corps bien faits de filles aînées ou cadettes se cachaient des mots durs, des postures amères, de l’incompréhension, de la peur, du deuil, de l’ignorance, du mépris, de la haine. Il aurait fallu voler aux bêtes des forêts des attitudes humaines pour rapprocher la femme de l’homme. Et ce couple, pour se comprendre, devait se parler, articuler des syllabes journalières, utiles et usées. Et malgré toute cette lenteur, cette pénurie de chaleur, cette absence de souffle, malgré cette vie de petites menottes serrées, la femme préférait se coller à son mari qui la rudoyait la nuit plutôt que prendre son balluchon pour où aller ? Elle était peut-être la plus surprise de voir venir au bout de neuf mois un être vivant, elle qui ne se croyait que gonflée d’angoisse. En plus de toute cette misère étaient venus des mots écrits et des hommes costumés pour les interpréter : « Femmes de femmes, vous n’avez rien compris, laissez venir à vous votre mari. Coûte que coûte, des enfants sont nés, des enfants doivent naître, fermez vos yeux, vos bouches bées. » Des enfants venaient hurler, manger, dormir, des enfants venaient se blesser sur leurs frères et sœurs tant ils étaient nombreux dans les maisons. Et ces femmes de femmes qui n’avaient rien compris laissaient venir à elles leur mari. « Peut-être un jour, se répétaient les mères dans leurs cuisines comme pour s’encourager, peut-être un jour quand nos os seront libres, quand notre chair sera dépourvue d’enfants, quand nos cheveux seront blanchis, enfarinés de fatigue, quand nos yeux seront moins bleus, pourrons-nous nous reposer. Serons-nous un peu moins malmenées, un peu plus protégées, un peu plus aimées ? » Dans ce vacarme de bouches affamées, l’homme avec ses seuls bras d’homme se saoulait pour oublier. Et dans cette diminution constante de pain et dans cette marche répétée d’enfants, l’homme légal dans sa légalité, l’homme dans son délire se demandait pourquoi il s’était fié à la vie. Il n’était pas d’une race à se saigner les poignets, il distribuait ses pas dans une démarche raisonnable. La joie qu’il avait reçue de la vie, il se l’était accordée en s’aimant lui-même contre sa femme. Les parents étaient seuls au monde dans une maison meublée de meubles, dans une maison peuplée d’êtres petits et vivants. Quand le sourire, la bonne humeur, l’âme entrebâillée de rires sont des étrangers débarqués ailleurs, quand au bout des mains se sont élevés des murs sans vigne et quand on sait que demain sera constitué dès aujourd’hui d’heures languissantes de vent, de pluie, d’herbes anonymes dégarnies de fleurs collées aux clôtures, on porte la jupe lourde et le champ de terre grasse et humide colle sous les souliers. Et si cette enfant est née, c’est un accident, une méprise des parents, son visage ne retient pas la terreur des rochers, et pour ne pas voir le profil blessé du pays, elle passe ses jours et ses nuits les yeux baissés. On a fouillé dans son maigre vocabulaire comme on creuse une poche pour remettre la monnaie à un pauvre, afin de lui trouver un nom. Un prénom pas nécessairement joli, un nom utile qui répond quand on l’appelle : Vallée. Et on l’a baptisée.
À toi qui n’es pas né au bord de l’eau, « La belle qui fait la morte », p.170
Radiothéâtres : Lettres à toi qui n’es pas né au bord de l’eau, fantaisies signées par La Marmarelle, textes lus par Monique Miller, émission hebdomadaire La Puce à l’oreille, réalisation Lorezo Godin, 9 mars au 21 septembre 1959 à 9 h 30.
Le cœur de l’homme est une péninsule, avec Françoise Faucher, Anne-Marie Malavoy, Marianik, André Pagé et Claude Préfontaine, réalisation Jean-René Major, SIRC, F-148, 29’05″, avril 1959, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Mon pas qui rôde, avec Françoise Faucher, Jacques Galipeau et Lucie de Vienne Blanc réalisation Jean-René Major, SIRC, F-149, 28’40″, avril 1959, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Ville Ô! mon cœur! avec Charlotte Boisjoli, Jean Brousseau, Michel Maillot, Yves Massicotte et Pierrette Stieb, réalisation Jean-Guy Pilon, RFRC, émission Nouveautés dramatiques, 591122-2, 30’, 22 novembre 1959, enregistrement déposé aux Archives de Radio-Canada, Montréal.
La belle qui fait la morte, avec Pierre Boucher, Jean Brousseau, Gisèle Dufour, Gilles Marsolais et Pierrette Stieb, réalisation Jean-Guy Pilon, RFRC, émission Nouveautés dramatiques, 601002-2, 30’, 2 octobre 1960, 601009- 2, 30’, 9 octobre 1960, 601016-2, 30’, 16 octobre 1960, enregistrement déposé aux Archives de Radio-Canada, Montréal.
Gaspésie, pays de mer, 1. 25 d’avri, avons parti, avec Jean-Paul Dugas, Françoise Faucher, Jacques Galipeau, Françoise Graton et André Pagé, réalisation Jean-René Major, SIRC, F-254, 29’25″, avril 1961, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Gaspésie, pays de mer, 2. Mouille, mouille paradis, avec Jean-Paul Dugas, Luce Guilbeault, Françoise Graton, Lucienne Letontal, Marc Olivier et Claude Préfontaine, réalisation Jean-René Major, SIRC, F-255, 29’30″, avril 1961, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Gaspésie, pays de mer, 3. Ils sont venus chercher notre fleur, avec Louise Darios, Jan Doat, Jean-Paul Dugas, Françoise Graton et Lucienne Letontal, réalisation Jean-René Major, SIRC, F-256, 29’20″, avril 1961, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Gaspésie, pays de mer, 4. Saison, je te nommerai la Barbelée, avec Madeleine Gobeil, Françoise Graton, Lucienne Letontal, Claude Préfontaine, Marc Olivier et Lila Valmère, réalisation Jea0n-René Major, SIRC, F-257, 29’25″, avril 1961, enregistrement déposé aux Archives nationales du Canada, Ottawa.
Expositions solos
Monotypes, Galerie libre de Montréal, 5 au 20 septembre 1962.
Monotypes et broderies murales, Galerie libre de Montréal, 12 au 25 mai 1965.
Film
Le Monde va nous prendre pour des sauvages, co-réalisation avec Jacques Godbout, documentaire, ONF, 1964.
Chanson
« La Piouke », paroles écrites en collaboration avec Hervé Brousseau, musique Hervé Brousseau, enregistrée par Pauline Julien pour son premier microsillon Enfin Pauline Julien (1962) et par Hervé Brousseau pour son microsillon Volume 3 (1963).











