Lors d’un périple à pied au Nouveau-Mexique, Agnès André découvre Ellen Meloy, cette autrice de l’Utah qui sait exprimer avec tant de sensibilité son amour du désert américain. C’est un coup de cœur : il faut qu’elle la traduise. Après la parution de C’est d’ici que nous observons d’autres villes croître à en perdre la raison, Nuit blanche rencontre la traductrice.
François Lavallée : Qu’est-ce qui vous a amenée à traduire Ellen Meloy ?
Agnès André : Comme toutes les œuvres que j’ai entrepris de traduire jusqu’à aujourd’hui, il s’agit d’abord d’un coup de cœur pour une écriture, une manière d’être au monde qui trouve des échos en moi. Je dirais aussi qu’il y a quelque chose de « physique » qui doit se passer. Ellen Meloy, je ne l’ai pas découverte en cherchant sur Internet. Je me souviens à vrai dire très bien du premier contact : nous étions dans la Gila Wilderness (Nouveau-Mexique), mon compagnon et moi, étape d’un périple à pied de Denver à Phoenix, lorsqu’une jeune ranger, qui semblait s’ennuyer passablement dans ses fonctions d’orientation des touristes sur le site, commence à discuter avec nous. Nous lui parlons de nos lectures, notamment Desert Solitaired’Edward Abbey, un de nos bouquins préférés. Elle nous mentionne alors Ellen Meloy, « a kind of feminine Edward Abbey ». Évidemment, je me devais de vérifier ses dires ! J’ai commencé par ses livres plus connus, comme The Anthropology of Turquoise, sélectionné au prix Pulitzer. Mais c’est en tombant par hasard sur ce petit recueil posthume (Seasons: Desert Sketches) dans une librairie américaine que j’ai été séduite : son écriture, je trouve, prend toute sa saveur dans la forme courte.
L. : Dans quelle mesure jugez-vous nécessaire de connaître la vie d’un auteur pour le traduire ?
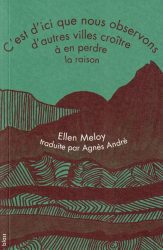 A. : Pour moi, il s’agit plutôt de connaître l’écriture – le style, les thèmes abordés. L’écriture, de toute façon, dit quelque chose sur la vie d’un auteur. Je dirais aussi qu’il n’y a pas de règle universelle : autant, pour Ellen Meloy, j’ai ressenti le besoin de lire l’ensemble de son œuvre pour traduire ce recueil, autant, pour d’autres auteurs, les échos que produira le texte en moi suffiront. Précisons qu’à l’origine, je jugeais moi aussi qu’il fallait connaître à fond un auteur pour pouvoir le traduire, mais j’ai changé d’avis depuis que j’ai fait cette expérience de contact par l’écriture avec un auteur dont je n’ai lu aucun autre ouvrage avant de me lancer. C’est un peu ce que met en question Souleymane Bachir Diagne1 lorsqu’il commente l’affaire Gorman2 : que fait-on de l’expérience individuelle du poème (du texte) ? En d’autres mots, ne nie-t-on pas, en disant qu’il faut être une personne noire (ou connaître cette identité) pour traduire une personne noire, qu’il peut y avoir aussi tout simplement un « appel » du texte au lecteur/traducteur ? Je m’éloigne un peu, car il y a aussi la question d’avoir accès à des connaissances suffisantes pour pouvoir bien traduire : souvent, il est possible de poser des questions à l’auteur pour clarifier un passage, une ambiguïté, etc. ; Ellen Meloy n’étant plus de ce monde, j’ai dû me reposer sur d’autres moyens, dont la lecture de ses œuvres.
A. : Pour moi, il s’agit plutôt de connaître l’écriture – le style, les thèmes abordés. L’écriture, de toute façon, dit quelque chose sur la vie d’un auteur. Je dirais aussi qu’il n’y a pas de règle universelle : autant, pour Ellen Meloy, j’ai ressenti le besoin de lire l’ensemble de son œuvre pour traduire ce recueil, autant, pour d’autres auteurs, les échos que produira le texte en moi suffiront. Précisons qu’à l’origine, je jugeais moi aussi qu’il fallait connaître à fond un auteur pour pouvoir le traduire, mais j’ai changé d’avis depuis que j’ai fait cette expérience de contact par l’écriture avec un auteur dont je n’ai lu aucun autre ouvrage avant de me lancer. C’est un peu ce que met en question Souleymane Bachir Diagne1 lorsqu’il commente l’affaire Gorman2 : que fait-on de l’expérience individuelle du poème (du texte) ? En d’autres mots, ne nie-t-on pas, en disant qu’il faut être une personne noire (ou connaître cette identité) pour traduire une personne noire, qu’il peut y avoir aussi tout simplement un « appel » du texte au lecteur/traducteur ? Je m’éloigne un peu, car il y a aussi la question d’avoir accès à des connaissances suffisantes pour pouvoir bien traduire : souvent, il est possible de poser des questions à l’auteur pour clarifier un passage, une ambiguïté, etc. ; Ellen Meloy n’étant plus de ce monde, j’ai dû me reposer sur d’autres moyens, dont la lecture de ses œuvres.
L. : Le fait de traduire en français une autrice qui est intimement liée au monde du désert américain pose-t-il des problèmes particuliers ?
A. : Il serait difficile de répondre non à cette question ! Ellen Meloy est une écrivaine du genre nature writing, ce qui signifie que l’environnement, son environnement, prend dans son écriture une place importante qu’on ne peut occulter à la traduction. Concrètement, les mentions de la faune et de la flore du désert américain m’ont très souvent obligée à faire un choix difficile entre traduire littéralement le nom vernaculaire anglais ou recourir au nom savant correspondant en français : de fait, certaines espèces n’existant que dans ce lieu précis, nous ne disposons en français que du nom latin pour les désigner ! Par ailleurs, les noms vernaculaires peuvent être multiples et changer de région à région ; c’est un véritable casse-tête pour les scientifiques eux-mêmes. Prenons le terme spiny lizard, par exemple : ce terme désigne le lézard commun américain, à savoir le genre Sceloporus. Traduire par Sceloporus donc ? Peu compréhensible ! Je choisis dans le texte de traduire littéralement par « des lézards épineux » pour deux raisons : d’une part, parce que l’autrice fait dans le texte une distinction entre différents types de lézards (impossibilité, donc, de dire « lézard » tout court) ; d’autre part, parce que le nom vernaculaire alimente l’imaginaire du lecteur. C’est un peu ce dont parle Umberto Eco dans Dire presque la même chose3: il faut pouvoir manifester dans la traduction l’image créée par l’original, ce processus impliquant parfois un écart littéral ou un écart idiomatique. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai inséré quelques notes de bas de page : ici, le lieu et sa présence (faune, flore) est fondamental et il faut pouvoir donner au lectorat le goût de ce lieu, une image de ce lieu.
L. : Disons-le : la traduction du titre surprend ! De trois mots, vous tricotez un énoncé qui prend quatre lignes sur la couverture4. Par quel cheminement êtes-vous passée pour arriver à ce choix ?
A. : Alors ici, comme très souvent par ailleurs, le titre n’est pas de mon fait mais de celui des éditrices. Il s’agit d’une phrase qu’elles ont particulièrement aimée, tirée d’un des textes du recueil. C’est l’occasion de rappeler que le processus de traduction est solitaire, mais aussi « œuvre collective », à savoir que plusieurs acteurs gravitent autour de l’œuvre traduite et y contribuent : traducteur, auteur, éditeur, relecteur, spécialistes consultés, etc5. C’est-à-dire que le traducteur propose un titre, mais c’est l’éditeur qui aura le dernier mot pour des raisons de mise en marché. À savoir si j’approuve ce choix plutôt qu’un titre plus proche de la lettre, c’est-à-dire Saisons. Esquisses du désert, la réponse est oui, pour la simple et bonne raison que le mot « désert » pour un lecteur français n’a pas les mêmes connotations que le mot desert pour un lecteur de l’Ouest américain. Pour un Français, le désert, ce sont les dunes du Sahara, ce qui n’a rien à voir avec le désert d’Ellen Meloy. Alors oui, on perd le rythme des saisons, important dans le recueil, mais il me semble que le titre choisi parle pertinemment de l’amour de l’autrice pour ce lieu singulier. Quant à la longueur, je crois bien qu’il y a une mode dans l’édition de nos jours pour le titre à rallonge !
L. : Jugez-vous qu’il y a forcément un écart entre un texte original et sa traduction ?
A. : Vous savez, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur cette question ! (Rires.) Oui, il y a des écarts à faire, mais la clé, c’est de rester fidèle à l’intention. Illustrons par un exemple typique d’écart littéral. Dans « California », Ellen Meloy dit « We were not a ‘think of starving children in China’ kind of family», que j’ai traduit par « Le classique ‘pense aux petits Africains’ n’a jamais pris dans notre famille ». Écart flagrant : on passe de la Chine à l’Afrique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’équivalent de cette phrase cliché en culture francophone européenne est, de mémoire d’enfant, « pense aux petits Africains qui meurent de faim ». Parler de la Chine aurait introduit une curiosité, alors qu’ici l’intention est de qualifier le type de famille dans lequel vit la narratrice au moyen d’un cliché. Ce paramètre de « l’effet » était par ailleurs primordial à l’échelle du texte et du recueil : nous avions affaire à des textes originellement radiophoniques, courts et incisifs, avec des petites pointes d’humour ici et là. Il m’a fallu ainsi soigner la forme, et tout particulièrement l’incipit, les enchaînements et la chute, pour que cet effet humoristique et saisissant soit équivalent en langue cible.
L. : On dit souvent que le français est nécessairement plus long que l’anglais. Comment abordez-vous cette question dans votre travail ?
A. : Voilà un paramètre que j’ai ici peu considéré ! (Vais-je en choquer quelques-uns ?) Je parle de paramètre car, selon moi, un texte littéraire est à traduire selon une multitude de paramètres – ou critères (propos, forme, effet du texte, bagage du lectorat cible, intertextualité, importance de la référence, etc.) – qui, en fonction du sens profond du texte, sont plus ou moins importants. En fait, oui, indirectement j’ai dû y penser, car traduire une phrase de trois mots en une phrase de dix mots ne produit pas le même effet ; j’y ai donc pensé en termes d’effet, mais pas forcément de concision, comme il est d’usage en traduction non littéraire. Mon but n’était ainsi pas d’être la plus concise possible ou de dire les choses de manière idiomatique dans le même nombre de mots, mais bien de reproduire le rythme du texte pour produire un effet équivalent. Je dirais que c’est là la grande différence d’avec un texte commercial ou administratif : on ne peut, en traduction littéraire, faire fi de la forme de la phrase, car très souvent cette forme fait sens.

L. : Pourriez-vous nous donner des exemples de phrases qui vous ont posé des problèmes particuliers ?
A. : Comme je le disais précédemment, nombre de chutes m’ont donné du fil à retordre. Prenons la fin de « Orignaux », par exemple. En anglais, ce sont trois phrases laconiques en trois, trois et quatre mots, assorties d’assonances et d’allitérations : « I move on. I love moose. The dopier the better.» Déjà si l’on essaye de traduire la première phrase, on obtient un foisonnement terrible : « Je quitte mon lieu d’observation ». Oui, on pourrait penser à « Je m’en vais », mais cette traduction implique une perte de sens par rapport à ce qui vient avant dans le texte. Le tout est de premièrement se demander quel paramètre importe le plus ici : est-ce le sens (« je retourne vaquer à mes affaires, j’adore les orignaux, plus ils ont l’air bête, plus je les aime ») ? Ou bien la forme, à savoir les sons et le rythme ? Malheureusement, dans ce cas, les deux sont également importants. Cette fin me turlupine encore… Je pourrais aussi parler de passages qui m’ont menée à insérer une note de bas de page. Contrairement à Umberto Eco, qui les qualifie sans ambages de « faillite du traducteur », je vois les notes, dans le contexte de ce recueil, comme un moyen de donner au lecteur francophone les clés de ce lieu que l’autrice décrit, lorsque celles-ci lui sont inaccessibles. Prenons la phrase suivante, tirée de « Bluff» : « After killing a policeman in nearby Colorado, three anti-government extremists surfaced east of Bluff, where one of them shot and wounded a local deputy ». Comment un lecteur comprendra-t-il le terme « anti-gouvernement » ? Il y verra très certainement un brin d’anarchisme, puisqu’il s’agit du seul mouvement politique, côté francophone, où l’on voit une opposition à l’existence d’un gouvernement. Or, le terme anglais ne fait absolument pas référence à l’anarchie, mais à une réalité américaine bien précise qui est celle d’une opposition au concept de terres publiques issu de l’esprit pionnier et grossièrement résumable ainsi : « On était là sur ces terres depuis le début ; on ne voit pas pourquoi l’État viendrait s’immiscer dans nos affaires ». Cette réalité façonne depuis des années le paysage de l’Ouest américain ! L’occulter aurait été une perte. Aurait-il été possible de manifester cet élément autrement dans le texte cible ? J’aurais pu mettre quelque chose comme « trois extrémistes libertariens », mais cela n’aurait pas, pour le lecteur francophone, immédiatement créé un lien entre ce mot et les conflits politiques qui habitent l’Ouest américain évoqué dans ce texte.
 Agnès André a les pieds en France et la tête au Canada, où elle enseigne (à l’Alliance française de Moncton) et traduit (en Ontario et au Québec). Titulaire d’une maîtrise en littérature comparée (Grenoble) et en traduction (Université Laval), ce sont sûrement ses multiples lieux de vie (Australie, Allemagne, Tchéquie, États-Unis, Hongrie, Pologne et Canada) qui l’ont amenée à s’intéresser à la traduction.
Agnès André a les pieds en France et la tête au Canada, où elle enseigne (à l’Alliance française de Moncton) et traduit (en Ontario et au Québec). Titulaire d’une maîtrise en littérature comparée (Grenoble) et en traduction (Université Laval), ce sont sûrement ses multiples lieux de vie (Australie, Allemagne, Tchéquie, États-Unis, Hongrie, Pologne et Canada) qui l’ont amenée à s’intéresser à la traduction.
* Cactus cholla flore locale typique du Sud-Ouest des États-Unis, au coucher du soleil après un violent orage qui aura transformé les arroyos en torrents d’eau rouge. (Ici : aux abords de Mountain Air, Nouveau-Mexique.)
** Le San Lorenzo Canyon est un exemple de la géologie particulière de cette région des États-Unis : piliers, saillies, renforcements de grès (sandstone) ; une roche ronde sculptée par l’eau. (Ici : aux abords de Socorro, Nouveau-Mexique.)
1. Souleymane Bachir Diagne, De langue à langue. L’hospitalité de la traduction, Albin Michel, Paris, 2022, p. 13.
2. Une traductrice néerlandaise, après avoir reçu une commande d’un éditeur, a dû renoncer à traduire la poétesse Amanda Gorman à cause du tollé entourant le projet : les militants antiracistes jugeaient qu’une traductrice blanche ne pouvait traduire un texte écrit par une auteure noire.
3. Umberto Eco, « Faire voir » dans Dire presque la même chose, chap. 8, Grasset, Paris, 2007.
4. Ellen Meloy, C’est d’ici que nous observons d’autres villes croître à en perdre la raison, traduction d’Agnès André, Blast, Toulouse, 2021 (titre original : Seasons: Desert Sketches, Torrey House Press, Salt Lake City [Utah], 2019).
5. La traduction est « un sport co », nous dit Nicolas Richard dans Par instants, le sol penche bizarrement. Carnets d’un traducteur, Robert Laffont, Paris, 2021.
EXTRAITS
When the world bears down, what counts is not a self-indulgent wallow. What counts are small acts of defiance.
Lorsque le monde pèse trop lourd, se complaire dans un état d’autobienveillance ne sert pas à grand-chose. D’insignifiants actes de défi, voilà ce qui fait la différence.
Some English simply does not translate. Freckles, for instance. There is no Navajo word for freckles.
Certaines expressions anglaises ne sont tout simplement pas traduisibles. Les taches de rousseur, par exemple. Il n’existe aucun mot en navajo pour les taches de rousseur.
So, the first meaning of being Utahn is the slick rock beneath my heartbeat as I lie facedown on Utah itself.
Car habiter l’Utah, c’est d’abord ceci : le lisse de la roche sous les battements de mon cœur, allongée face contre terre, la terre de l’Utah.
The nightly news dumps an avalanche of misery and terror into my living room but says nothing about how I am to endure it.
Les infos du soir vomissent une avalanche de misère et de terreur dans mon salon, mais restent muettes sur la façon dont je suis censée faire face à la chose.










