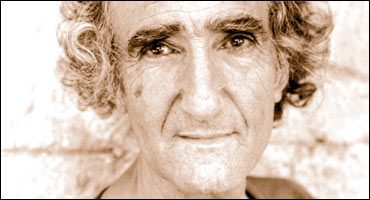Pour plusieurs, Serge Rezvani n’est encore que l’autobiographe des Années-lumière, sinon l’auteur de quelques chansons popularisées par Jeanne Moreau vers la fin des années 1960. Pendant trente ans, il a pourtant construit une œuvre littéraire touffue et surprenante, loin de l’actualité littéraire et des courbettes médiatiques.
Dans sa résidence hivernale, à Venise, on découvre un révolté silencieux, sûr de lui, bouillonnant d’idées, savourant avec la calme « Lula » l’approfondissement de leur présence au monde.
Un nom comme un rasoir dans un rideau d’ombres. Une renommée épisodique, qui masque un peu la continuité d’un parcours créateur multiforme, fruit de divers tournants et ruptures. Serge Rezvani, peu étudié, apprécié surtout par une diaspora de connaisseurs et de curieux, est l’auteur d’un ensemble de livres qui appelle le défrichage pour en mesurer la cohérence, l’envergure. Quelques authentiques chefs-d’œuvre, une sensibilité unique dans la littérature, mais surtout l’aptitude très personnelle d’appréhender le monde actuel et sa fascination souvent morbide pour les objets.
Nombre de personnes reconnaîtront en lui le sympathique Cyrus Bassiak du film Jules et Jim de Truffaut. Personnage secondaire, il grattait la guitare au salon en entonnant avec Jeanne Moreau l’inoubliable chanson « Le tourbillon de la vie », sur le rythme de la « rocking-chair qui nous mène aux plaisirs de la chair1 » : « On s’est connu, on s’est reconnu, on s’est perdu d’vue, on s’est r’perdu d’vue… » Ses chansonnettes, qu’il compose à temps perdu dans son atelier, car il peint déjà depuis longtemps, se situent quelque part entre Moustaki et Cohen ; certaines furent interprétées dans quelques autres films, dont Pierrot le fou de Godard, ce qui lui assura un peu de liberté financière et l’achemina vers l’écrit.
Né à Téhéran en 1928 d’une mère russe et d’un père persan, il a une enfance mouvementée qui le mène dans diverses pensions et jusqu’au Paris de la Deuxième Guerre. Cette errance sera plus tard le sujet de son premier livre, Les années-lumière, où il raconte ses allées et venues entre sa mère, les orphelinats, ce tragi-comique prestidigitateur et diseur de bonne aventure qu’était son père et la solitude de chambres sordides. Ayant tôt pris l’habitude de s’évader en dessinant des sirènes nues, il deviendra peintre dès la fin de son adolescence, avant de rencontrer celle qui partage ses jours depuis cinquante ans, Danièle. Ou Lula, ou Alex, ou encore l’Eleinad de ses poèmes, tous des synonymes. Un phare féminin qu’il ne fait que contourner par le langage et la peinture, et qui l’a fait accéder à une unité auparavant improbable. Le second roman, Les années Lula, forme d’ailleurs avec le précédent un diptyque indissociable, où l’errance initiale est entièrement mise en relief par l’assurance que la femme procure.
Depuis longtemps, il se réfugie dans une campagne au sud de la France pour créer, loin des arts plus médiatisés. Après l’avoir longtemps désiré, voilà enfin que Danièle et lui trouvent le pied-à-terre rêvé en Italie, où ils viennent se ressourcer durant la saison morte, renouant alors avec une vie sociale plus étendue. C’est à la fin du mois d’octobre que, bifurquant par là, je sollicitais quelques minutes à ce personnage ; je ne pouvais supposer qu’il se montrerait si accueillant.
La voix, au téléphone, vient d’emblée démentir l’image d’ours querelleur que je m’étais formée de lui. Une voix incroyablement douce, tout à fait celle du fameux Bassiak immortalisé par la pellicule il y a quelques décennies. Parti de la froideur de Lille et après une nuit de sommeil sur les rails entre Nice et la mer Adriatique, c’est par une Venise aux multiples pastels que je suis accueilli. Venise avec ses façades si bien entretenues, ses couleurs d’algues et de fleurs, ses touristes rose fluo, ses téléphones cellulaires, une place Saint-Marc entièrement inondée et des volées inépuisables de pigeons, avec aussi, en prime, une certaine image du bonheur, celle de ces deux septuagénaires pour qui l’art demeure en gestation : avant les objets et le tourisme, avant le téléphone arabe du journalisme auquel je participe aussi.
Une poétique de la circonvolution
« On sollicite de plus en plus les artistes pour en faire des portraits, tout en lisant de moins en moins profondément leurs œuvres », me dira-t-il bientôt. Lui, il préfère accumuler les stratégies pour se rendre invisible, pour différer de son image, notamment de celle que l’on aperçoit de temps à autre dans les magazines.
Si on peut faire face à Serge Rezvani quelque part, c’est dans les entrecroisements. Nous discutons ainsi, à travers le bruit des pompes qui irriguent le quartier, du parolier, du peintre, du dramaturge, du romancier, du poète, sautant d’une période à l’autre en tentant d’établir de fragiles filiations.
« Je revendique d’être quelqu’un de pluri-indisciplinaire. Je suis absolument contre l’enfermement du créateur dans une discipline. Je pense que nous sommes voués à nous exprimer par tous les moyens. J’écris avant tout, maintenant, mais la peinture, comme autrefois la musique et la chanson, parvient à me débloquer, parfois, lorsque je n’arrive pas à bien comprendre ce que j’écris. » Dans plusieurs de ses romans, cette tendance aux mises en contraste devient une polyphonie théâtrale, tant par l’importance des voix que par la complexité de la construction. C’est la confrontation de multiples perspectives qui nous révèle les choses, c’est en tournant autour des échecs que les personnages de Fous d’échecs mettent à nu les liens entre ce jeu et la nature humaine. Dans plusieurs romans récents, la description est même totalement éludée, l’action nous étant entièrement révélée par la voix de plusieurs narrateurs-personnages. « Je suis passionné par les voix qui décentrent. Plus mes livres divergent entre eux plus je suis passionné, contrairement à l’homme de lettres qui fait œuvre de langage et se situe toujours au centre du problème. Alors que la périphérie, par une espèce de mouvement rotatif, de tourbillon, finit par ramener indirectement au centre. »
Ainsi, les différents masques artistiques portés par Serge Rezvani trouvent écho dans une poétique de la circonvolution, de l’indirect. Comme Lula, qu’il a peinte incomplètement à de nombreuses reprises, l’objet du livre est irreprésentable. Le discours livresque n’est qu’une incitation à entendre et la peinture une invitation à poursuivre le regard. C’est le sens de son intérêt pour la nouvelle « Le portrait ovale » de Poe, dont il a jadis emprunté le titre pour un de ses livres, lui-même réécrit et réédité plus tard sous le titre de L’antiportrait ovale ! Chez Poe, le ravissant modèle d’un peintre finissait par mourir tant la pose était longue, fable qui pour Rezvani répond à sa méfiance très orientale à l’égard de l’image trop fidèle, fermée à la vie.
Tiers inclus
« Les deux dernières personnes au monde qui ne bougent pas et qui se taisent, ce sont l’écrivain et le lecteur. Ce sont les derniers solitaires, face à face. C’est pourquoi je demande au lecteur de faire la moitié d’un travail que je laisse inachevé. Je ne suis pas intéressé par l’objet parfait. Je fournis un excitant pour l’imagination et non un objet fini. Les best-sellers ressemblent aux histoires que l’on raconte aux enfants pour leur faire trouver le sommeil. Moi, je préfère raconter des histoires qui n’endorment pas. »
C’est qu’il est prolifique en histoires, cet homme. À part une série de romans autobiographiques2 qui va des premiers coups de pinceau jusqu’aux Repentirs du peintre (1993), on dénombre des écrits satiriques (Les américanoïaques), des romans sur l’art (La nuit transfigurée, Feu, Phénix), des poésies amoureuses et, plus récemment, des récits aussi baroques que philosophiques. Si la peinture est très souvent intégrée à ces univers, la dramaturgie trouve aussi de nombreuses occasions de dialogue avec le domaine romanesque : « Beaucoup de mes romans ont donné lieu à une, deux pièces de théâtre. Cela me permet d’amener sur la scène d’authentiques personnages de roman, qui ont déjà toute une vie écrite. » Par le chemin inverse, Un fait divers esthétique (1999) est une modulation de la pièce La glycine, et sa construction emprunte sa diversité de perspectives au Rashomon du cinéaste Kurosawa. Ici encore, Serge Rezvani accorde une priorité absolue à l’autour. Ce que certains nomment le perspectivisme, basé sur l’impossibilité de rendre compte des choses par une seule et unique représentation.
Détruire, dit-il
Ce besoin de complexité n’est pas qu’un amusement formel. Accro à la solitude, Rezvani a toujours dit aimer les communautés… sans en être. Fuyant la peinture, les institutions trop accaparantes, visitant plusieurs éditeurs successifs, il profite de ses succès périodiques pour rompre la routine. « Je ne veux pas me soumettre à un éditeur ou à un marchand de tableaux. Tout doit se faire dans l’amitié, pour éviter la marchandisation », dit-il avec un brin d’idéalisme.
Cette attention jalouse pour sa créativité lui fait occuper une drôle de position, un peu retirée, où le succès ne se jauge pas tellement aux ventes de ses livres mais à la préservation d’un projet de vie et d’une originalité que lui ont léguée les circonstances. « Ma poésie, malgré moi, n’est pas française. J’écris une poésie orientale. Même chose pour mes romans. En esprit, j’écris en russe. Je squatte la langue française, c’est tout. Mon rythme, mes thèmes, certaines dérives philosophiques ne sont pas français. […] Je ne suis pas un homme de lettres, je refuse absolument tout ce qui est autour de la littérature. Je ne fais d’ailleurs jamais la promotion de mes livres, j’accorde assez peu d’entrevues. Je ne fais pas partie du sérail parisien. Mon problème, c’est que je suis plutôt un homme de vie. L’art est un moyen de vie, de contenir notre vie, de la faire avancer, et pas tellement de livrer des objets. Tant mieux si, après avoir traversé notre vie, c’est diffusé. »
Ce n’est pas tant un mépris des intermédiaires que la constatation qu’ils prennent souvent toute la place. Content de compliquer la tâche aux faiseurs de thèses en menant une carrière à plusieurs pans, Serge Rezvani craint que le commerce actuel ne masque une difficulté de la culture à se renouveler, ce qui transparaît dans le rapport muséologique que nous entretenons avec les œuvres du passé, dans la façon dont notre mémoire s’articule.
Prenant comme exemple Lascaux ou Venise, il souligne le ridicule d’une conservation à outrance, qui empêche finalement tout sens de surgir. Pour lui les choses vivent de leur destruction et de leur reconstruction. « Il ne faut jamais oublier que Rome a été construite à l’aide des ruines du Colisée. Nous vivons quant à nous dans une époque de conservation. Il n’y a plus d’avenir, plus d’utopie, nous ne touchons plus aux œuvres. Nous manquons d’iconoclastie. La culture actuelle recule, elle est en train de s’éteindre faute de s’alimenter de ses ruines. Nous ne sommes plus destructeurs mais admirateurs, du fait que nous avons tué l’utopie. Mais c’est l’excès de conservation qui détruit vraiment, car il retire les œuvres de la vie. »
On pourrait lui répliquer que les avant-gardes sont aujourd’hui très libres de secouer nos présupposés, souvent avec moult subventions. Mais ce qui est en cause est plutôt la façon dont la majorité d’entre nous consomment de toute façon la culture, y compris ses aspects subversifs. Avaler n’est pas digérer, voir et entendre ne sont pas comprendre. Comprendre un livre de Rezvani par contre c’est se retrouver emmailloté avec lui dans une interprétation mouvante du monde, avec un juste dosage de clarté et d’ouverture.
Toute cette appréhension envers l’objet culturel se traduit dans les romans de Serge Rezvani par plusieurs personnages d’artistes destructeurs et de collectionneurs insensibles. Entre vivre et posséder, la réconciliation se révèle ardue, tout comme entre l’intuition et la raison. Ainsi la curiosité malsaine des scientifiques de La cité Potemkine n’aboutit-elle qu’à une fatale régression vers des formes archaïques de la vie, comme si la connaissance devait obligatoirement susciter des catastrophes quand elle est privée de projet. Objectiver ou posséder une chose, c’est encore une fois risquer de tuer son rapport au reste du monde.
« La symétrie, poursuit-il en plaidant pour le mouvement, c’est vraiment la mort. C’est la guerre, la vendetta, ce qui veut s’achever. C’est primitif. L’homme et le poète introduisent l’asymétrie, la notion de – non-réponse –. Parmi les hommes qui veulent répondre à tout prix, abolir l’énigme, il y a les dictateurs. Nous habitons l’énigme, alors pourquoi se limiter à un monde de réponses toutes faites tel qu’on nous le propose souvent ? »
Même s’il n’était pas l’auteur du scénario de Jules et Jim, et même si les triangles amoureux du film n’ont rien à voir avec sa vie personnelle, Serge Rezvani semble irrémédiablement marqué par les structures triangulaires. Sa représentation du monde et de lui-même est constamment infidèle, les couples de ses romans doivent se déformer et se reformer pour persister. Travailler à fragiliser les choses et les relations, ce serait donc le paradoxe qui permet de maintenir leur vivacité. Fragilisation qui n’est rien de moins qu’un travail artistique, périlleux peut-être, mais beaucoup moins que l’absence de mouvement.
Voies d’évitement
En allant déposer livres et cassettes chez le poète Riccardo Held, ami de Rezvani qui m’offre gracieusement le gîte, je m’attends presque, devant l’Accademia ou dans les ruelles mouillées, à rencontrer un autre Rezvani, accompagné d’une autre Danièle. En soirée, c’est à peu près les mêmes que je retrouverai en compagnie de leurs copains, sans que je cesse de m’égarer dans l’image que je me fais d’eux, mais que je voudrais aussi mobile que le Fait divers esthétique où chaque narrateur ouvre davantage de possibilités d’interprétation.
Côte à côte dans un sofa, discutant de la farce millénariste, de Marlene Dietrich et de la crème glacée italienne, ces deux inséparables donnent envie de détruire amoureusement la réalité. « Indiscontinuellement3 », dans la persistance du souffle et le respect des pressentiments.
1. Citation tirée du film Jules et Jim.
2. Cinq livres ont été rassemblés en 1997 dans un volume de la collection « Thesaurus » d’Actes Sud, tout comme les nombreuses pièces de théâtre (deux tomes).
3. André Breton.
Serge Rezvani a entre autres publié :
Les années-lumière, Flammarion, 1967 ; Le canard du doute, Stock, 1979 ; La nuit transfigurée, Seuil, 1986 ; J’avais un ami, Bourgois-10/18, 1987 ; Phénix, Gallimard, 1990 ; La traversée des monts noirs, Stock, 1992 ; Les repentirs du peintre, Stock, 1993 ; Élégies à Lula, Deyrolle, 1996 ; Fous d’échecs, Actes Sud, 1996 ; La cité Potemkine ou Les géométries de Dieu, Actes Sud, 1998 ; Un fait divers esthétique, Actes Sud, 1999.