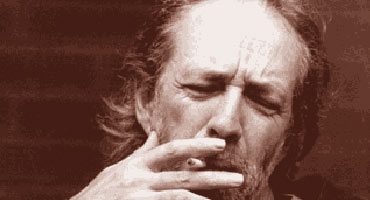Le Bouillon de culture consacré au Québec a ramené sur le devant de la scène Pierre Falardeau, le bouillant réalisateur de films sur la dissidence, la marginalité, passé à l’écriture avec La liberté n’est pas une marque de yogourt, entre autres. Il signait tout dernièrement un texte dramatique diffusé par Radio-Canada.
Lorsqu’il allait à l’école, Pierre Falardeau s’asseyait dans un coin, le long du mur. Du genre plutôt timide, il se taisait plus souvent qu’autrement. Mais à un moment donné, le silence des autres le contrariait. Pourquoi ne parlent-ils pas ? se disait-il. Puisque personne ne voulait prendre la parole, il finissait par s’en emparer malgré lui. Déjà Pierre Falardeau exécrait ceux qui ont le pouvoir de dire les choses et qui optent pour le silence.
Si pour le cinéaste Pierre Falardeau « la liberté n’est pas une marque de yogourt », de Lorimier, c’est bien plus qu’une rue de Montréal. Les lettres d’un patriote condamné à mort de Chevalier de Lorimier ont en effet inspiré son dernier scénario intitulé 15 février 1839, un projet toujours à l’étude et qui, à l’instar d’Octobre, embarrasse, selon lui, Téléfilm Canada. Alors que le peuple du Québec est celui qui en Occident consacre le moins d’heures à l’apprentissage de son histoire, Pierre Falardeau rappelle un événement que la mémoire, volontairement ou non, tend à oublier : les conséquences de la rébellion de 1837. On ne s’étonne guère de voir le cinéaste pamphlétaire incarner à travers la figure mythique de Chevalier de Lorimier les thèmes qui lui sont chers : la liberté, la révolte, le combat, l’attente, l’espoir, la défaite, l’emprisonnement et l’indépendance. Pierre Falardeau signait d’ailleurs récemment la préface d’une réédition des lettres de ce rebelle, pendu en 1839. C’est au Salon du livre de Québec que nous avions rendez-vous. Devant la baie vitrée qui surplombe le cimetière St. Matthew, sa cigarette traçant des arabesques au rythme de ses emportements, Pierre Falardeau, le mal engueulé, répondra à mes questions avec sa franchise coutumière.
Le cinéaste parle beaucoup de liberté et le thème de l’emprisonnement, du cloisonnement, revêt beaucoup d’importance dans son Suvre : je pense au Party, à Octobre, à l’arène de boxe dans Le steak, même à Elvis Gratton qui, d’une certaine manière, demeure prisonnier de son masque, de son bungalow. Avec 15 février 1839, Pierre Falardeau poursuit dans cette voie, mais a-t-il d’autres projets en tête ?
« Je pense qu’il faudrait que je me fasse psychanalyser Que j’essaie de comprendre ce qui est arrivé dans ma vie pour que ça m’accroche comme ça. J’ai l’intention de continuer, tu vois, le scénario que je viens de publier se passe encore dans une prison l’enfermement il doit y avoir quelque chose
« Dans mes films de fiction, je me suis aperçu que je faisais des huis clos, parce que ça coûtait moins cher. Donc, tu pars avec une espèce de défaut que t’essaies de transformer en qualité. Quand j’ai fait Octobre, je me disais, là, c’est un huis clos, quatre personnes dans une maison. Es-tu capable de tenir les spectateurs attentifs avec si peu de chose ? L’affaire de l’enfermement, ce que j’aime peut-être là-dedans, c’est que dans des endroits clos naissent des moments très intenses, qui forcent les individus à se réveiller. »
La Rébellion et ses figures mythiques auront marqué l’imaginaire de plusieurs auteurs québécois ; Jacques Ferron y puisera Les grands soleils, Louis Caron, Le canard de bois, Roland Lepage, La complainte des hivers rouges. Pierre Falardeau ne pouvait pas rester indifférent au cri de « Vive la liberté et Vive l’indépendance ! » de Chevalier de Lorimier. Il consulte plusieurs ouvrages historiques sur la Rébellion, en plus des lettres de Chevalier de Lorimier, ces lettres d’adieu touchantes et d’une grande lucidité écrites par un homme qui s’apprête à monter sur le gibet. Un texte de fiction d’Hubert Aquin sur la révolte de 1837 a également nourri son inspiration. Le scénario raconte les vingt-quatre dernières heures de Chevalier de Lorimier et de quatre compagnons qui vont être exécutés pour haute trahison. Il s’agit d’une Suvre dans laquelle fusionnent la fiction et la réalité historique, un texte dur, dans la lignée d’Octobre. À propos d’une séquence amusante, où l’on voit les Patriotes en train de se donner des cours, je lui demande s’il s’agit d’un fait historique.
« Récemment, j’ai rencontré un ex-prisonnier politique argentin. Il m’a dit : ‘Nous autres, on avait des cours’. Les Patriotes eux aussi ont dû se donner des cours. Comme tous les prisonniers politiques du monde. Les cours de natation, ça vient de l’Argentin. Il m’a dit : – J’ai suivi des cours de cinéma, il y a des films que je sais par cœur, je peux les raconter et je ne les ai jamais vus. On se les racontait par les égouts. Moi, en prison, j’ai eu des cours de marxisme, de lancer à la mouche ; il y avait un gars qui donnait des cours de piano et il n’y avait même pas de piano. On avait des cours de natation – Comment ça des cours de natation ? – On mettait le gars dans son lit avec un bol d’eau, puis il nageait’. Je me suis dis que les Patriotes ont dû se donner des cours. Parce qu’il faut que tu survives. »
Prendre les armes ?
Hubert Aquin croyait qu’il faudrait prendre les armes pour faire l’indépendance du Québec. Dans Octobre, Pierre Falardeau met en scène les membres d’une cellule felquiste qui utilise cette voie. De Lorimier et les Patriotes ont défendu leur liberté jusqu’au bout, avec le résultat qu’on connaît : exécutions et déportations. Dans La liberté n’est pas une marque de yogourt Pierre Falardeau défend les rebelles de l’IRA ; il termine son livre en citant Malcolm X : by any means necessary. Un appel tout de même explicite. Est-ce que l’indépendance du Québec, advenant des circonstances extraordinaires, passe en ultime recours par la sédition et la révolte armée ?
« C’est ce que j’ai écrit en préface des Lettres d’un condamné à mort. Quand je me suis relu [il se redresse] : ‘Oh ! qu’est-ce t’as écrit là, Falardeau !’ Mais je mesure très bien le côté délirant d’un tel discours. Il me semble que la situation qu’on vit présentement ressemble beaucoup à celle de 37-38. Pendant que du côté des Patriotes on faisait des discours, eux autres, ils avaient déjà leur régiment de volontaires, ils se préparaient alors que nous autres Je ne lance pas un appel aux armes, il faut juste essayer de penser l’impensable. Au moins l’envisager. Je trouve ça assez tough d’amener ça comme proposition dans un pays où sévit la pensée Passe-partout On est tous des petits amis, on est tous gentils, pas de troubles. »
Est-ce qu’il y a des matins où Pierre Falardeau croit sérieusement que la situation pourrait s’envenimer ? Qu’on pourrait en arriver là ?
« Il me semble, d’après ce que j’ai lu sur la vie humaine, que ça a souvent ‘toujours’ passé par là. Je regarde un pays comme la Tchécoslovaquie Sauf qu’il n’y pas cinq cents Vaclav Havel c’est-à-dire, des gars pas trop primes. À Ottawa, je ne suis pas sûr qu’il y ait des Havel. D’autre part, les gens ici vont-ils oser ? Il ne s’agit pas de prendre les armes. Il faut juste dire ‘nous on fait ce pas-là. Vous voulez venir ? Venez !’ J’ai lu au cours de l’année Géopolitique et avenir du Québec, un livre qui est passé presque inaperçu, écrit par J. R. M. Sauvé, un ancien militaire québécois. Pour lui, les armes, c’est pas un mystère, alors que pour toi et moi, les crayons Il dit que si tu ne veux pas que ça arrive, il faut que tu sois prêt. C’est ça la game. Quand l’autre sait qu’il peut se faire faire mal il viendra peut-être pas Faut réfléchir à ça. Chez Cole, à Montréal, il y a un rayon, Strategy and military history. Dans les librairies françaises, ça n’existe pas ; dans la pensée québécoise, ça n’existe pas, dans leur pensée aux Anglais, ça existe en esti ! C’est grave. Avant 1760, on est un peuple très guerrier, après on perd la tradition militaire. C’est pas dans nos mentalités. Moi, je suis trop mou, je ne pense pas que je peux passer à l’offensive. Ça peut être défensif notre affaire. Donc, c’est pas belliciste »
Dans la lignée de Martin Luther King ? « Euh Non, non, non, non non. C’est plutôt se défendre par tous les moyens. Il y a des valeurs qu’il faut défendre à tout prix, dont la liberté. Ils vont peut-être me faire marcher à genoux, j’aime pas ça marcher à genoux ‘Y a besoin de pas se retourner avec son gun‘ »
Références littéraires
Julien Gracq écrivait que « la littérature naît de la littérature ». Dans La liberté n’est pas une marque de yogourt, l’auteur fait référence à des polémistes importants : Jules Fournier, Olivar Asselin, Pierre Vadeboncœur, Hubert Aquin. Qu’est-ce qu’il retient de ces œuvres et ont-elles eu une influence sur son travail de créateur ?
« Ces gens-là m’ont nourri intellectuellement. Pierre Vadeboncœur, je trouve ça riche comme pensée. Il a beaucoup aimé La liberté n’est pas une marque de yogourt. Moi, je ne me considère même pas comme un écrivain. De sorte que si un écrivain que je respecte aime ‘la petite affaire’ que j’ai faite, ça me fout par terre. Par exemple, au moment où j’ai découvert Jules Fournier, Olivar Asselin, j’écrivais déjà et les trucs que je faisais n’étaient pas publiés. On disait, ‘mon cher monsieur, on n’écrit plus comme ça. Ce n’est plus le XIXe siècle’. Mais Asselin et Fournier écrivent comme ça ! On a le droit d’être choqué ! On a le droit de rire ! »
Dans un passage de La liberté n’est pas une marque de yogourt, Pierre Falardeau fait allusion à la perversion – on pourrait même dire au viol – dont sont victimes certains mots, notamment de la part des publicitaires, et qui s’usent au point de ne plus vouloir rien dire. Est-ce que ce serait une raison qui l’empêcherait de se consacrer entièrement à la littérature ?
« Non, les mots sont autant pervertis par la littérature que dans le langage. Par exemple, des mots comme fasciste, antisémite, raciste. Ce que j’haïs [Falardeau hausse la voix], c’est quand The Gazette me traite de raciste, d’antisémite. Moi, je suis un internationaliste. Je trouve l’argument grossier. Qu’est-ce que ce serait s’il s’agissait de vrais racistes, de vrais fascistes ? Mais, ce n’est pas cela qui m’empêchera d’écrire, au contraire. En écrivant, il faut cependant que tu fasses attention aux mots que tu emploies. »
L’écrivain-cinéaste avoue d’ailleurs mal supporter l’image de « pur et dur » qui le suit.
« Tantôt, on parlait des mots qui sont travestis : ici, tu émets la moindre pensée, t’es un pur et dur. Moi, je me sens pas pur, premièrement, puis je me sens pas dur. Tu défends l’affichage en français, t’es un extrémiste… »
Bien qu’il soit à l’aise dans l’écriture pamphlétaire, l’image est-elle plus forte, plus apte à exprimer le fond de sa pensée ?
« Je me suis jamais pris pour un écrivain. J’ai jamais même pensé que je pourrais écrire. Quand j’allais au collège, il y avait des gars qui écrivaient, qui collaboraient au journal étudiant, qui voulaient devenir romanciers. Moi, je faisais du sport. Je lisais pareil, j’aimais beaucoup lire. J’ai commencé àfaire des images lorsque j’étais en anthropologie, je faisais ma thèse de maîtrise sur la lutte au Forum. J’allais à la lutte le lundi soir. Je trouvais ça bien agréable, ça me sortait de l’université. L’atmosphère qu’il y avait là, je me demandais comment la décrire. Pour décrire ça avec un crayon, il faut que tu sois un grand écrivain, il faut que tu t’appelles Hemingway ou Camus. Moi, je ne savais pas écrire. Et j’ai découvert au même moment les documentaristes québécois. [Falardeau s’emballe.] Une caméra ! Peut-être qu’on pourrait décrire le réel avec ça. Par la suite, je me suis mis à écrire des lettres aux journaux. C’était pas tant pour écrire, que pour me battre, pour intervenir. Elles n’ont pas été publiées, j’ai pas pu me prendre pour un écrivain. Les gens disaient : ‘C’est tellement mauvais, mon cher ami’. Après quinze lettres, j’ai arrêté. Quand tes textes sont refusés partout, tu peux pas te prendre pour un écrivain. Après, j’ai écrit des scénarios. J’ai jamais considéré ça comme de la vraie écriture. À un moment donné, des gens m’ont dit que c’était bien écrit et j’ai fait un livre. Soudain, j’étais promu écrivain. Les bouts que j’aime le mieux, c’est pas quand ça parle, c’est les passages qui sont écrits grands comme ça : Hindelang mange son pain. Tu donnes ça à un acteur : ‘Toi tu vas mourir dans deux heures, c’est ton dernier repas. Go !’ »
Le batailleur
Pierre Falardeau fait souvent référence à la boxe, un sport qui le fascine. Il a d’ailleurs tourné un film avec le boxeur Gaëtan Hart, en 1990. Le rôle du pamphlétaire n’est pas sans rappeler celui du pugiliste : frapper, mais s’attendre à encaisser également. Très souvent, au cours de sa carrière, Pierre Falardeau a dû défendre son œuvre, ses projets, sa réputation, son gagne-pain. Il se retrouve souvent mêlé à des polémiques. On se rappellera ses démêlés dans Le Devoir avec une pléthore de personnages : sénateurs, publicistes, intellectuels, journalistes. Devant un (autre) refus de Téléfilm Canada, il s’adresse avec ironie au jury en commençant sa lettre par « Chers jurés. Chers numéro un, deux et trois ». Pierre Falardeau trouve toujours l’énergie de réagir, en dépit des attaques, des refus, « de l’attente qui ramollit le cerveau », il se relève toujours. Je ne peux m’empêcher de lui demander s’il craint de recevoir la droite de sa vie, celle qui le mettra K.O.
« Non, j’ai jamais réfléchi à ça ; je devrais… À la boxe, j’ai lu ça quelque part, la seule certitude c’est la défaite. »
Dans ce cas est-il fatigué de répliquer et d’encaisser ?
« Oui ! oui ! Je réponds à un tel, à un autre. Parfois je me dis : ‘Lâchez-moi ! Qu’est-ce que vous avez tous ?’ Ma blonde me dit : ‘Gagne donc de l’argent, qu’on achète un nouveau frigidaire. T’as passé l’été à écrire au Devoir’. L’article que j’ai écrit à Milot, ça m’a pris deux semaines. C’est de l’énergie. Dans la société, il y a un débat d’idées et j’essaie d’y participer. J’ai pas réagi à la sortie du film de Jacques Godbout, Le sort de l’Amérique. Mais je trouve ça grave de le voir dire les niaiseries qu’il raconte. Godbout il n’a jamais été attaqué parce que c’est un gros morceau. Si je m’attaque à lui, lui aussi peut frapper bas. La première attaque, c’est un jeune qui l’a lancée dansLiberté, « La fatigue culturelle de Jacques Godbout ». Je n’avais pas trouvé l’article bien fort, mais je me disais : ‘Y a un jeune qui a osé… Bravo’. Puis j’ai croisé Godbout, quelques jours après… ‘me semble que t’as l’air fatigué, Godbout’. Il avait dû mal le prendre. »
Pierre Falardeau a été visiblement dérangé par ce film, qu’il considère « comme une vaste escroquerie ». Je lui demande s’il a l’intention de faire un sort à l’Amérique de Jacques Godbout.
« Ils m’avaient invité à Radio-Québec pour parler du film. Ils avaient aussi invité Godbout. Je lui réservais une traite. Dans l’après-midi, il a appelé la recherchiste : ‘J’aimerais ça parler à Falardeau pour savoir qu’est-ce qui va dire’. Moi, j’ai répondu : ‘Un gars à qui je veux casser la gueule, je ne veux pas lui parler dans l’après-midi’. Il n’est pas venu. Il a envoyé le jeune avec qui il a travaillé. Moi, j’ai été obligé de bûcher sur ce petit gars-là. »
Pierre Falardeau a fait des études classiques. Je lui demande s’il a fait de la rhétorique puisqu’il manie habilement les figures de style. On dirait, par moments, en lisant La liberté n’est pas une marque de yogourt, une vaste entreprise de persuasion.
« Je devrais fermer ma gueule… C’est ce que je me dis des fois. T’as raison, j’essaie de convaincre. Je suis un rhétoricien sans le savoir… En même temps, je suis devenu orateur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Après Octobre, les jeunes dans les cégeps se sont mis à m’appeler : ‘Viens nous parler’. Pendant le référendum, j’ai dû faire quarante discours. »
Une tâche qui l’intimide malgré tout, puisqu’il ne se considère pas comme un orateur. On se souvient que c’est lors d’un de ses discours qu’il avait suggéré à Yvon Deschamps – qui s’était dit épuisé de parler de souveraineté – d’aller se recoucher s’il était fatigué.
Comment a-t-il réagi à la nouvelle de la mort de Robert Bourassa, un homme qu’il n’appréciait guère ? N’est-il pas tenté d’écrire à son sujet des blâmes funèbres ?
« Oui ! oui ! oui ! Peut-être que c’était un bon gars. Peut-être qu’il remerciait la serveuse. Pis qu’il était gentil. So what ! Vous n’avez pas vu tout ce qu’il a fait ? Et Jacques Godbout, qui fait Le mouton noir ! Je me dis ‘pourquoi t’as fait ce film-là, tu redonnes la parole à ceux qui ont toujours la parole’. Moi, ce qui m’intéresserait à propos de l’indépendance, c’est de savoir où le gars de l’usine ou du restaurant en est rendu dans sa démarche… Pas ce que les politiciens ont à dire. Ils parlent tous les jours. Dans son film, il me fait découvrir les jeunes politiciens, qui sortent de Brébeuf, comme leur père, qui sont comme les vieux. ‘Pourquoi avoir fait un film là-dessus ; avoir filmé une commission ? – C’est le plus grand exercice de démocratie qu’il y a eu au Québec’. Maudit ! La journée où sort le film, Bourassa prend le rapport Bélanger-Campeau et le met aux poubelles. ‘T’es un méchant analyste politique, Godbout.’ La démocratie ! ? »
Pierre Falardeau vedette
Devant son ascension médiatique, est-ce que l’éditeur de Pierre Falardeau le pousse à écrire ?
« L’année passée, il m’a dit : ‘J’ai une idée, on t’assied, toi puis Richard Desjardins, avec une enregistreuse, vous parlez puis on enregistre ça’. C’est un peu vite fait. Desjardins, moi, je l’aime bin gros, mais je m’entends pas sur tout avec lui. »
Je ne peux m’empêcher de lui demander en terminant comment il s’est retrouvé à Bouillon de culture.
« J’ai abouti là parce que Denys Arcand n’était pas libre, puis Robert Lepage n’était pas libre et trois ou quatre autres. J’étais là comme cinéaste, pas comme écrivain. Je ne vois pas pourquoi les littéraires m’en voudraient. Ils m’ont pris comme cinéaste parce que j’étais le quatrième, parce que les autres n’étaient pas libres. Quelqu’un a envoyé mon livre en France, ça doit être Stanké. Pivot a lu le livre dans l’avion. À Montréal, je lui ai refilé Le temps des bouffons. Son équipe a capoté sur le film. »
Depuis, Pierre Falardeau continue de faire « capoter » ses partisans et ses détracteurs. Il faut souhaiter qu’il ne soit pas emporté par le cirque médiatique. Pierre Falardeau, le populiste, celui qui aime par dessus tout recevoir les salutations du camionneur au coin d’une rue – « Lâche pas Falardeau, on va les avoir… » –, n’a pas fini d’épuiser le sens du mot liberté.
Pierre Falardeau a publié :
Octobre, Stanké, 1994 ; La liberté n’est pas une marque de yogourt, Stanké, 1995 ; 15 février 1839, Stanké, 1996.