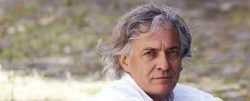« Le banquet de la vie est devant nous et donc la seule question qui se pose, est celle de notre appétit. »
Lin Yutang, L’importance de vivre.
Le bonhomme a belle allure. Cheveux longs, poivre et sel ou sel et poivre selon le point de vue, il affiche un sourire chaleureux mais discret, au milieu d’un visage basané. Il ne sourit pas inutilement comme ces gens nerveux qui, incapables de se contenir, exhibent sans raison tout le niais des rictus vides et répétitifs. C’est peut-être la rareté de son sourire qui le rend remarquable.
Jean-Paul Dubois, journaliste au Nouvel Observateur et auteur du roman Une vie française, Prix Femina 2004, entre au Grand café avec la nonchalance de ceux qui n’ont rien à prouver. Ce n’est pas par excès de confiance. C’est plutôt parce qu’il ne joue pas le jeu : il n’est ni dans le train ni là à le regarder passer. Il sait qu’il y a « parade », mais, plutôt que de perdre son temps à choisir entre un rôle d’acteur ou de spectateur, il préfère ne pas en tenir compte. Conséquemment, malgré un « emploi » au Nouvel Observateur et son succès comme écrivain, il refuse de vivre à Paris – là où il devrait – pour vivre dans le Sud, à Toulouse, sa ville.
Jean-Paul Dubois n’hésite pas à déboulonner certaines statues, à défaire certains mythes, à critiquer tout autant les États-Unis que quelques-uns des sacro-saints canons de la littérature française, bref, à avoir des opinions. Ainsi on constate, à la lecture de ses essais sur l’Amérique (L’Amérique m’inquiète[1996] ; Jusque là tout allait bien en Amérique [2002]), qu’il n’a pas la langue dans sa poche. Mais s’il dénonce et souligne certaines absurdités étasuniennes dans ses essais, il aime à exprimer ses diverses névroses et obsessions dans ses romans. On retrouve ainsi, parmi les personnages de Dubois, des agoraphobes obsédés par la tonte du gazon ou des écrivains anxieux qui, plutôt que d’allumer une cigarette, s’envoient des verres de lait froids… Il se soigne, selon ses propres mots, en écrivant des livres. Il admire Philip Roth et Raymond Carver, mais aussi Cioran et attribue à Boris Vian le fait qu’il écrive des livres « différents, moins structurés ». Enfin, ce soixante-huitard (il avait 18 ans en Mai 68), qui n’a jamais voté de sa vie et qui considère l’écriture comme un travail, déteste travailler et jure que s’il en avait les moyens financiers, il n’écrirait plus ! À peine surprenant que cet iconoclaste soit le premier étonné de son succès.
Comment un tel personnage en arrive-t-il à l’écriture ? Comment s’y prend-il ? A-t-il une « méthode » ? Le succès affecte-t-il sa routine d’écrivain ? Il a déjà dit qu’il s’assoyait une fois par année, 10 à 12 heures par jour pendant un mois pour écrire un livre… et que ça fonctionnait chaque fois. Voilà pour la méthode ! Et l’angoisse de la page blanche, elle ? Et l’inspiration, les muses, le talent, le sang et la sueur dans tout ça ? De la foutaise, nous dira-t-il.
L’écriture et la paresse
Jean-Paul Dubois est venu à l’écriture par paresse. Écrire, c’est un mode de vie. « Vous n’avez d’autorité sur personne. Personne n’a d’autorité sur vous. » C’est donc pour ne pas avoir à se lever tous les matins1, ni avoir un patron sur le dos, ni être hypnotisé par la valse métro-boulot-dodo, etc., qu’il est venu à l’écriture : « C’est le métier le plus facile ». Pour lui, toutefois, si écrire et gagner sa vie en le faisant demeure un privilège, l’écriture est bien « une manière de vivre, très loin de la littérature au sens de l’art ». Ainsi, Dubois, en choisissant d’écrire, choisissait la facilité. La page blanche n’a rien d’inquiétant. Oublions l’inspiration, le mythe. Rien ! Il s’agit simplement de s’asseoir et d’écrire, car « écrire, c’est normal », affirme-t-il. Mais, il faut pratiquer. « L’écriture, c’est comme la gymnastique. Plus vous la pratiquez, plus c’est simple. L’écriture est une gymnastique du poignet et de l’esprit. » De plus, en vivant sa vie, ce que certains appellent vieillir, celui qui écrit (et qui s’entraîne) trouve au fond de lui de plus en plus de matière à création. Avec le temps, le travail, la pratique, l’accès à cette matière se simplifie. Arrogant Jean-Paul Dubois ? Pas du tout. Confiant, peut-être.
Il sait que dans l’écriture « tout se paie dans tous les sens du mot ». Il n’y a rien d’innocent. Pour lui, les mots, les histoires, les personnages, les livres à écrire sont au fond de nous. « Les livres se construisent avec ce qu’on vit avec l’éducation qu’on a ou qu’on n’a pas. » En somme, pour Jean-Paul Dubois, l’écriture fait partie de la vie. Il ne s’agit pas d’une activité hautaine et étrange, qui se déroule en secret, derrière de lourds rideaux fermés. C’est une activité humaine guère plus mystique que de se brosser les dents. Ainsi, lorsqu’on se demande pourquoi ses personnages lui ressemblent, quelle est la part d’autobiographie dans ses ouvrages, il se marre un peu. Pour lui, il n’y a qu’un seul Dubois, écrivain ou non. Ce qu’il raconte touche parce que c’est possible, c’est humain et que ça pourrait bien lui être arrivé à lui, tout comme à vous ou à moi. Il raconte donc l’histoire de n’importe qui, de tout le monde, de tous les hommes… Ses personnages « n’existent […] peut-être pas dans la vie, mais ce sont des gens réels » avec leur sensibilité et leurs pulsions propres. On peut ainsi aimer ses livres, parce qu’on s’y reconnaît ou parce qu’on s’identifie à plein aux personnages, que les détails mis en scène rejoignent notre expérience ou encore par voyeurisme parce qu’on aime être un témoin privilégié de ce qui arrive aux autres. Écrire, c’est comme jouer du piano, dira-t-il : lors de l’exécution, on est bien dans la vie, avec les mains, le talent et le piano que la vie nous a donnés. Le résultat n’existe que dans la vie. Il n’y a pas la vie d’un côté et la musique (ou l’écriture) de l’autre. La fiction est incarnée dans le réel.
Vivre ou écrire ?
Jean-Paul Dubois préfère la vie à l’écriture. Il a déjà dit qu’il valait mieux réussir sa vie plutôt que ses livres… Il vit, il écrit… mais ne vit pas lorsqu’il écrit. Malgré cela, puisqu’il faut gagner sa vie et qu’il a choisi de la gagner ainsi, au printemps, par exemple, il s’attable. Pendant un mois, il rédige son roman à paraître : « huit pages par jour, tous les jours ». Toujours la même recette, sauf pour Une vie française qui lui a demandé deux mois et huit jours. « Comme je suis paresseux, je dois me fixer des règles. Si je ne fais pas ça, je ne fais rien. Alors, je fais mes huit pages. Parfois plus, si je suis en forme, mais jamais moins. […] J’écris lentement. […] Des fois je ne fous rien pendant deux heures. Le matin, je relis ce que j’ai écrit la veille. À la fin, je relis tout et c’est tout. »
Dans Tous les matins je me lève, il évoque sa manière de procéder. « En me levant le lendemain, j’ai eu une idée de livre. Enfin, pas une idée de livre, une idée de phrase. Quand je commençais une histoire, c’était toujours à partir d’une phrase qui me passait par la tête, une phrase de rien du tout. Je me suis mis à table et j’ai écrit : ‘Quand je commence un livre, j’ai peur de mourir avant l’avoir fini. Même quand je n’écris pas un livre, j’ai toujours peur de mourir.’ Et j’en suis resté là. J’ai passé une heure à essayer de trouver une suite, mais je n’y suis pas arrivé. J’avais dû me tromper, ce n’était sans doute pas un bon début. Il ne ramenait rien d’autre dans ses filets. J’avais beau le traîner derrière moi, il n’appâtait pas les autres mots. J’ai pensé que, si les gens savaient comment je travaillais, ils n’achèteraient pas mes livres. Quand je finissais une page, je n’avais pas la moindre idée de ce que j’allais raconter sur la suivante. Je n’avais ni plan, ni idée, ni but, ni scénario. Les mots, les mots seuls me tiraient ligne après ligne, c’étaient eux qui faisaient tout le travail. »
Il travaille donc sans plan, sans filet. Par exemple, dans le cas de son précédent roman, Une vie française, il n’avait, pour commencer, que la dernière phrase. « Je songeais à tous les miens. En cet instant de doute, au moment où tant de choses dépendaient de moi, ils ne m’étaient d’aucune aide, d’aucun réconfort. Cela ne m’étonnait pas : la vie n’était rien d’autre que ce filament illusoire qui nous reliait aux autres et nous donnait à croire que, le temps d’une existence que nous pensions essentielle, nous étions simplement quelque chose plutôt que rien. » (Une vie française, p. 357) Cette phrase, il l’avait notée une nuit, après la mort de sa mère. Sans trop savoir où elle le mènerait, ce qu’elle deviendrait, il savait qu’elle serait la dernière d’un roman. « À la disparition de ma mère, j’ai écrit cette phrase […] je savais que ce serait la dernière du livre. » Le livre s’est ensuite construit vers un but précis, pour « aller rejoindre cette phrase ». C’est cette simple phrase qui a déclenché la suite sur la « fragilité de la vie, les gens qui sont là, qui n’y sont plus, qui sont disparus, [et] naturellement, sur la mémoire, ces choses qui sont toujours présentes en moi ».
La littérature naît au fond de lui. Il lui suffit d’ouvrir les vannes, de laisser cette énergie, ce courant, bref, de laisser sortir ce qui gît au fond de lui. Pas besoin de plan, car « tous les livres qu'[il écrit] sont à peu près les mêmes. Ça tourne autour de l’embarras de sa propre vie, la difficulté d’être proche des autres… qui sont les préoccupations de bien des gens qui écrivent, ce n’est pas que les [s]iennes ». Ces « obsessions, ces névroses », une fois couchées sur le papier ne le quittent pas. Pas de salut ! Pour Jean-Paul Dubois, l’écriture n’est pas thérapeutique. Elle peut aider, tout au plus, mais les préoccupations, elles, restent en lui et c’est peut-être une bonne chose… s’il veut continuer d’écrire. Écrire peut aider à se connaître soi-même, à projeter dans le temps ce qu’on ne sera jamais, mais ça n’aide pas à se guérir de ses peurs, de ses angoisses. « Un livre, ça n’éduque pas. Ça aide peut-être à se supporter. » Une fois que vous savez comment vous écrivez, « savoir pourquoi » n’a guère d’importance. Au fond, écrire c’est un métier comme les autres. C’est celui qu’il a choisi… et c’est peut-être par le choix qu’il lui a demandé que ce métier se distingue un peu des autres.
Réussir sa vie d’abord
Lorsqu’il n’écrit pas, il aime se vautrer dans la banalité quotidienne : faire de la mécanique, s’occuper de ses arbres, de son petit-fils… Dans ces moments-là, l’écriture n’existe tout simplement pas. Il n’est écrivain que lorsqu’il écrit. Il fait du sport et s’investit dans son bonheur. C’est ainsi qu’il est heureux et, comme il aime à le répéter, il est moins heureux lorsqu’il écrit. Il sait que ce sera difficile… Mais c’est très relatif. Il reconnaît qu’il s’agit de problèmes de luxe, qu’il est un privilégié et il est parfaitement conscient que son travail de journaliste l’a aidé. Néanmoins, entre vivre et écrire, il choisit irrévocablement vivre.
Le succès, les gros tirages, le Femina, tout cela est « une chance financière » qui lui permet « plus de paresse », comme s’il y avait divers degrés de paresse. Ça demeure toutefois étrange. « Les lecteurs sont indulgents. S’ils aiment c’est tant mieux. […] Lorsqu’on dépasse 150 ou 200 000 de tirage, on entre dans un autre monde […]. Un autre monde auquel on n’aurait pas dû accéder. Il y a un malentendu. C’est bizarre d’être aimé pour ce qu’on n’est pas. »
L’univers romanesque de Jean-Paul Dubois n’est pas que lourdeur ténébreuse et dépression cataclysmique. Certaines scènes de ses romans sont dignes des frères Marx. En effet, grand amateur de cinéma – particulièrement de cinéma burlesque – l’écrivain y puise son humour. Il rit autant qu’il pleure en écrivant. Encore ici, il puise en lui, dans ses souvenirs d’enfant : Jerry Lewis, Laurel et Hardy, etc. Parfois, dans la surprise des images qui naissent, il se fait rire… involontairement. À la manière de Mozart, sans brouillon, sans ratures, un peu de façon automatique, Dubois laisse libre cours à son imagination, une imagination profondément ancrée dans l’intime, le vécu, les détails de la vie ordinaire, mais débridée, imprévisible. Ainsi naissent des images inusitées – ce qui pourrait bien constituer la marque de commerce de l’auteur – où la poésie naît de la juxtaposition de mots ordinaires décrivant une réalité saturée de banalités quotidiennes comme : « Dehors, la chaleur rendait les bruits collants » (Les poissons me regardent) ; « Dans ma pièce, le soleil me suçait le bout des doigts. C’était un rayon si fin et si plat qu’on aurait dit une tranche de jambon » (Tous les matins je me lève) ; « Le jour me sauta dessus. Je n’essayai même pas de me défendre » (Les poissons me regardent). Il n’y a que dans cet univers où la mère d’un personnage en vient à sentir « le sucre à force de faire des gâteaux » et où « porter les vêtements de la veille, c’est comme se glisser dans les restes d’une journée ».
Il importe peu qu’on soit dans le drame autobiographique ou que les romans se recoupent parfois, car l’ambiance insolite de chaque roman est, elle, unique. Qu’il s’agisse de l’histoire de Paul Blick, un Français moyen traversant la deuxième moitié du XXe siècle dans Une vie française, ou de la psychose paranoïaque baignée dans l’horreur et les religions de Paul Klein dans Je pense à autre chose, ou de la déchéance d’un père suicidaire dans Les poissons me regardent, il y a toujours, grâce au langage précis, direct, souvent surprenant, parfois songeur et qui révèle une « âme théologique », des univers intimes, engageants, voire enveloppants.
« Il y a des livres français, ce que je fais très peu », dit-il, car ses livres à lui peuvent se passer n’importe où. C’est l’histoire d’un type « fait de tous les hommes », à travers tous les événements de la vie.
Jean-Paul Dubois n’est pas triste. On l’a déjà qualifié de « pessimiste gai2 ». Il est peut-être un peu nostalgique et se plaît à se nourrir de la solitude et des moments qui en naissent et qu’on ne peut partager avec personne. Bien que ce soit le passé qui l’inspire, l’écrivain, l’homme est planté dans le présent. En effet, c’est toujours dans le présent qu’on se souvient. Quel adulte s’émeut encore de dormir avec un bébé ou de voir le vent déraciner un arbre ? Dans ses romans, les enfants sont des personnages actifs qui soutiennent souvent la progression dramatique, qui « ne sont jamais neutres », « des causeurs de problèmes », qui posent des questions… auxquelles on n’a jamais de réponses. Ces questions avec lesquelles ils nous agressent nous ramènent souvent à notre faillibilité, à nos imperfections.
« Lorsqu’un proche dit Je donne des pourboires royaux pour que les génuflexions soient plus basses vous devez vous situer très vite : je serai comme lui ou je ne serai pas comme lui. » Vous choisissez votre camp. Très jeune, Jean-Paul Dubois a choisi son camp. Libertaire, il aime mettre en scène les luttes sociales, les rapports de force de la société en recréant ces tensions à l’intérieur d’une famille. En montrant diverses facettes du monde. Il y a Dubois l’écrivain qui est aussi Dubois le citoyen et, comme la fiction fait partie du réel, il ne faut pas être aveugle. Écrire ainsi, c’est sa façon à lui de « faire toujours de la politique ». Comme pour rappeler qu’il y a – car un grand nombre semblent l’oublier – « des gens qui ont et des gens qui n’ont pas », des gens qui dominent et d’autres qui sont soumis et que « la société sécrète en permanence ce genre de relations d’injustice ». Selon lui, « même dans le mauvais sens, l’inégalité est fondateur d’une société ».
L’inquiétante Amérique
Dans ses essais sur l’Amérique, Jean-Paul Dubois dénonce, ou du moins cherche à montrer l’absurdité des profondes injustices qui corrodent l’idéal démocratique du rêve américain mis de l’avant par les médias et les autorités étasuniennes. Ici aussi, c’est souvent en racontant l’histoire d’individus ordinaires, celle d’un homme « fait de tous les hommes et qui les vaut tous et vaut n’importe qui » (L’Amérique m’inquiète), qu’il s’agisse du Dr Death (Jack Kevorkian), de prisonniers en attente dans le « couloir de la mort » ou de riches Texans, qu’il dessine ce portrait guère reluisant de cette inquiétante Amérique. À la manière d’un acteur qui se cache, se fond dans son personnage, Jean-Paul Dubois, qui « préfère se faire oublier, [se] fondre dans le décor, regarder la forme des choses et le contour des gens, les observer, les écouter tandis qu’ils racontent le bruit de leur vie » (L’Amérique m’inquiète), nous fait « le compte-rendu têtu de rencontres et d’événements singuliers, révélateurs de l’âme d’une nation » (Jusque-là tout allait bien en Amérique). Bien que le portrait qui émane de ces descriptions, plus incroyables les unes que les autres, soit peu enviable, jamais l’auteur ne sombre dans un antiaméricanisme accusateur. Au contraire ! C’est l’étonnement permanent et la désillusion, voire la tristesse du constat qui démontrent bien l’affection (et parfois le dégoût) qui habite ce voyageur traversant cette Amérique qui sait maintenant (depuis septembre 2001) qu’elle n’est pas invincible, mais qui semble, malgré tout, incapable d’arrêter de se vautrer dans un excès de pacotilles et de paillettes. Si Dubois se sent bien au Canada, il est très mal « en Amérique. » Il pourrait peut-être habiter Montréal ou Vancouver, mais ne se voit pas vivre aux États-Unis… sauf peut-être à Miami ou à San Francisco, car ces villes ne « ressemblent pas à l’Amérique ». Cela dit, il n’y a aucun doute qu’il préfère sa Toulouse natale. C’est là qu’il est ancré et qu’il prend le temps d’écrire ses histoires qui nous parlent de mondes réels et vivants, qui ressemblent souvent aux mondes et aux réalités au cœur desquels nous vivons. C’est, en somme, grâce à son extraordinaire transposition de l’ordinaire, à la construction de phrases où le beau et l’effort font place à l’imprévisible et au naturel et, enfin, dans la création d’univers où évoluent des personnages qui ne sentent pas la fiction que Jean-Paul Dubois nous cloue à ses livres. S’il ne se regarde pas écrire, ses lecteurs, eux, n’ont guère le loisir de se regarder lire.
1. Titre d’un de ses romans : Tous les matins je me lève, Robert Laffont, 1998.
2. Le Figaro, 1er février 1996.
Jean-Paul Dubois a publié :
Compte rendu analytique d’un sentiment désordonné, Fleuve noir, 1984 ; Éloge du gaucher, Robert Laffont, 1987 ; Tous les matins je me lève, Robert Laffont, 1988 ; Maria est morte, Robert Laffont, 1989 ; Les poissons me regardent, Robert Laffont, 1990 ; Vous aurez de mes nouvelles, Robert Laffont, 1991 ; Parfois je ris tout seul, Robert Laffont, 1992 ; Une année sous silence, Robert Laffont, 1992 ; Prends soin de moi, Robert Laffont, 1993 ; La vie me fait peur, Seuil, 1994 ; Kennedy et moi, Seuil, 1996 ; L’Amérique m’inquiète, L’Olivier, 1996 ; Je pense à autre chose, L’Olivier, 1997 ; Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, L’Olivier, 1999 ; Jusque-là tout allait bien an Amérique, L’Olivier, 2002 ; Une vie française, L’Olivier, 2004.
EXTRAITS
Telle était ma famille de l’époque, déplaisante, surannée, réactionnaire, terriblement triste. En un mot, française.
Une vie française, p. 30.
Empoignant alors son machin au travers du tissu de son pantalon, il grommelait cette incroyable phrase enrobée à la fois de regret, de douleur et de fureur : « Putain, si ma mère était belle, je la baiserais ! »
Une vie française, p. 33.
D’abord je le sors du frigo une ou deux heures avant pour qu’il soit à une température normale, tu vois. Ensuite, je prends un couteau assez large et je fais une entaille, bien au milieu du rôti, pile au centre. Pas trop large non plus, juste comme il faut. Ensuite, je mets le tablier, je baisse mon froc et la partie peut commencer. Sauf que souvent, ma putain de mère, elle fourre le rôti avec de l’ail. Alors quand je tombe sur une gousse et que je m’y frotte dessus, j’ai la bite qui pue pendant deux jours. Quoi, qu’est-ce que t’as ? C’est l’ail qui te dégoûte ? On dirait que tu viens de voir le diable.
Une vie française, p. 37.
Il était impossible de ne pas avoir son baccalauréat en 1968. Amputé de ses épreuves écrites, l’examen se résumait à une méfiante poignée de main entre l’élève et le professeur, ce dernier félicitant systématiquement le premier pour la brillance et la concision d’un exposé qui parfois n’avait même pas été prononcé.
Une vie française, p. 49.
[…] les naissances, comme les morts d’ailleurs, ont l’étrange pouvoir de lubrifier les cœurs et d’effacer les ardoises surchargées du passé.
Une vie française, p. 164.
En ces années quatre-vingt, il fallait être mort pour ne pas avoir d’ambition. L’argent avait l’odeur agressive et prémerdeuse des déodorants pour toilettes.
Une vie française, p. 198.
Durant cette maladie, j’ai souvent perdu pied, j’ai plié mais je n’ai jamais prié.
Une vie française, p. 218.
Le 17, la guerre du Golfe éclata. […] Comme tous les autres Français, je m’assis alors devant la télévision et regardait comment s’y prenait l’Amérique pour embobiner le monde. Altération de la réalité. Malversations sémantiques. Falsification des causes. Amplification des effets. Témoignages truqués. Contrefaçon des preuves. Détournement des buts. Déguisement de la souffrance. Dissimulation des morts. Ces gens d’outre-Atlantique incarnaient la forme civilisée de la barbarie. Manipulateurs de conscience, exterminateurs de pensée, inséminateurs d’idées prédatrices, ils avaient fait de l’image un miroir mensonger qu’avec la complicité des hâbleurs stipendiés, ils pouvaient déformer à leur guise en fonction de leurs besoins.
Une vie française, p. 259.