Auteure d’une épopée western (À la recherche de New Babylon) et d’un roman d’aventures maritimes (Les marins ne savent pas nager), Dominique Scali nous ouvre les portes de son imaginaire. Nous l’avons rencontrée à Moncton, dans le cadre de l’édition 2023 du Festival Frye1.
Patrick Bergeron : Vous êtes à la fois écrivaine et journaliste. Comment parvenez-vous à concilier ces deux activités ?
Dominique Scali : Ce sont deux activités qui se nourrissent. Je vois des liens entre les deux. Au début, j’avais l’impression que le fait d’écrire de la fiction m’aidait à écrire des articles, à sortir des formules toutes faites. Mais j’ai aussi réalisé que l’inverse fonctionnait. Le Journal de Montréal est un journal populaire où tout est vulgarisé. Il faut que ce soit très clair, que tout soit très imagé, très concret. Il y a quelque chose qui vient avec l’expérience du journalisme et qui force à illustrer par les mots. Cela me sert aussi quand j’écris de la fiction.
P. B. : Vous êtes également docteure en psychologie. Or, quand on lit vos romans, on constate que vous plongez très peu dans l’intériorité de vos personnages. Est-ce que la psychologie et la littérature font chambre à part chez vous ?
D. S. : Je pense qu’elles dorment ensemble mais inconsciemment ! Elles ne veulent pas se l’avouer. C’est un choix littéraire, stylistique : ne pas m’appuyer explicitement sur la psychologie des personnages quand je raconte. Je sais qu’il y a des lecteurs qui préfèrent ce qui est très intimiste, où l’on décrit tout ce que le narrateur pense. Mais, en tant que lectrice, plus je lis et plus je deviens impatiente avec les romans trop psychologisants. Le déclic a été en lisant Cormac McCarthy, un auteur américain chez qui il n’y a à peu près pas de psychologie. Cela peut être très déroutant parfois parce qu’on ne comprend pas ce qui se passe, comme si les personnages n’avaient pas d’intentions. Ce sont juste des descriptions de paysages et de comportements. Quand j’ai lu Cormac McCarthy, je croyais encore que la littérature servait essentiellement à être proche de la pensée des gens. Et puis là, c’était un choc. Ah, on peut aussi faire ça ! J’ai l’impression qu’il y a quelque chose de philosophique dans ce choix.
P. B. : Vous avez déjà raconté que l’idée des Marins ne savent pas nager vous était venue alors que vous preniez un bain.
D. S. : Oui, j’étais dans mon bain et je pleurais. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que cela m’arrivait très souvent de pleurer dans le bain. Seulement dans le bain. Toute une réflexion est partie de là, de l’eau qui retourne à l’eau. Est-ce l’eau qui monte qui fait pleurer ou est-ce les larmes qui font monter l’eau ? Cela me rappelait le conte « La petite sirène » d’Andersen, l’histoire d’une sirène qui vit dans l’eau et qui est triste de ne pas être parmi les humains. C’est de là que m’est venue l’idée d’inventer un monde où je pourrais reproduire cette dynamique d’une femme qui essaye de passer dans un autre monde, mais sans queue de sirène, sans dimension fantastique.
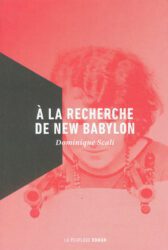 P. B. : Parlons de votre premier roman, À la recherche de New Babylon, publié en 2015. L’impact a été immédiat : l’ouvrage est présélectionné pour le Prix littéraire du Gouverneur général, traduit en anglais et en espagnol, et repris par un éditeur français, Libretto. Ce livre a-t-il nécessité de longues années d’écriture ?
P. B. : Parlons de votre premier roman, À la recherche de New Babylon, publié en 2015. L’impact a été immédiat : l’ouvrage est présélectionné pour le Prix littéraire du Gouverneur général, traduit en anglais et en espagnol, et repris par un éditeur français, Libretto. Ce livre a-t-il nécessité de longues années d’écriture ?
D. S. : Près de cinq ans, mais pas à temps plein. Pendant cinq ans, je ne lisais que des westerns. Je faisais aussi de la recherche et je pondais des fragments : des idées, des scènes, des dialogues ou juste des descriptions de paysages. Pendant longtemps, je ne savais pas si j’allais en faire un roman. Les fragments se sont accumulés. À un moment donné, je ne savais plus où je m’en allais, j’ai pris une pause, je n’y pensais plus, puis je me suis dit : « Avec tout ça, tu as un puzzle, il faut juste l’assembler ». Il y a donc deux phases : celle où je construis par fragments et celle de l’assemblage, de l’écriture active, où je ramasse tout et où j’en fais quelque chose de cohérent.
P. B. : Vous parliez de Cormac McCarthy, un écrivain connu pour ses westerns crépusculaires : Méridien de sang, La trilogie des confins. Or, peut-être davantage qu’un genre littéraire, le western est un important genre cinématographique. Avez-vous regardé plusieurs films avant d’écrire votre roman ?
D. S. : Tous les westerns que j’ai pu trouver, je les ai regardés. Les bons, les mauvais, les archi-mauvais. Mon roman a beaucoup été inspiré par le cinéma. Il y a bien sûr des phases : les westerns américains des années 1950 ne sont pas du tout comme les westerns italiens des années 1960. Ce n’est pas le même message, le même propos, mais quelque chose me fascinait dans les deux. Je pense que tout cela a été rendu possible grâce à l’inspiration de Cormac McCarthy, parce que des romans littéraires westerns, je n’en ai pas trouvé énormément. C’est beaucoup du roman de gare, facile à consommer, où la psychologie est très biaisée. Mais avec Cormac McCarthy, c’est comme si je tombais sur quelque chose de sacré. C’est comme l’Ancien Testament. Ma lecture de Méridien de sang a été très marquante. Je l’avais commencé une première fois, j’avais arrêté au premier tiers parce que je ne comprenais rien, mais l’ambiance créée dans ce roman est tellement forte que j’y suis revenue. Je ne peux toujours pas vous raconter ce qui se passe dans ce livre ! Mais je pense que c’est un peu cela que j’ai essayé de faire : reproduire cette ambiance, retrouver cette puissance d’évocation.

P. B. : Votre roman présente des personnages plus fascinants les uns que les autres : le révérend Aaron, un prédicateur qui ne prêche pas ; Charles Teasdale, un bandit pyromane et boxeur qui a échappé dix fois à la pendaison ; Pearl Guthrie, une jeune femme partie à la recherche du bon mari, qui simule une trentaine de mariages avant d’avoir vingt et un ans ; William Tattenbaum, alias Russian Bill, prétendu fils d’une comtesse russe et hors-la-loi qui rêve de fonder la ville de New Babylon. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces personnages ?
D. S. : De façon générale, la clé que je peux vous donner, c’est que les personnages sont des facettes de moi-même. Ce ne sont pas tant des individus. Si je faisais des romans qui se passent à Montréal en 2023, peut-être que je m’inspirerais de telle ou telle personne. Mais non. C’est tout moi. Ces personnages sont différentes possibilités basées sur le contraste, les contradictions, le paradoxe. Ils se présentent d’une certaine façon, mais agissent de façon contraire. Un prédicateur qui ne prêche pas, c’est particulier. C’est l’idée de se réinventer. C’est un peu cela pour moi le Far West : partir de zéro, aller dans un lieu donné, un désert, puis se reconstruire comme on veut, comme construire une ville à partir de rien. Mais derrière tout cela, il y a une critique ou une moquerie de l’obsession nord-américaine pour la liberté. Les personnages ne font que répéter la même chose en se faisant croire qu’ils sont en train de changer. Parce qu’on peut changer comme on veut, vu qu’on est libre. Comme Pearl Guthrie, qui se marie sans cesse avec le même homme.
P. B. : New Babylon est une ville qui n’existe pas, que Russian Bill rêve de fonder. Une ville sans lois, sauf celle qui interdit les hommes de loi. Ce sera un endroit dangereux, où, comme vous l’écrivez, « on aura constamment le souffle coupé, parfois à cause des paysages, d’autres fois parce qu’on se sera fait trancher la gorge ». Habiteriez-vous un tel coupe-gorge ?
D. S. : Je ne pense pas que je survivrais longtemps ! C’est pour cela que j’écris des romans. Je peux imaginer bien des choses, mais non.
P. B. : Vous n’avez pas le goût du risque ?
D. S. : En littérature seulement. Ce qui me fascinait dans le western, c’est la tension, la menace constante. C’est d’être dans une ville où on ne sait jamais quand on va se faire attaquer, prendre une diligence pour aller dans l’autre ville et être toujours sur ses gardes. Il y a quelque chose de très menaçant et aussi de très excitant. Je pense que c’est de là que vient la fascination du western. Même chez les enfants qui jouent aux cowboys. J’ai essayé de reproduire cette tension qui est toujours là, mais il n’arrive jamais rien. Comme dans nos vies, quand on s’attend à ce que quelque chose se produise, mais qu’il ne se passe rien.
P. B. : Un autre aspect qui frappe à la lecture de votre roman, c’est votre souci de la composition. L’intrigue évolue en zigzags, avec des bonds en avant et des retours en arrière. Comment vous y êtes-vous prise pour assurer la cohérence de votre roman ? L’ordre dans lequel on lit votre histoire correspond-il à celui dans lequel vous l’avez écrite ?
D. S. : Pas du tout. En fait, le concept de structure était : un chapitre, une ville. Chaque chapitre décrit ce qui se passe dans une ville. Chaque ville a sa couleur, son histoire, son ambiance. En même temps, toutes les villes se ressemblent parce que ce sont les villes champignons du Far West. Très souvent, elles deviennent des villes fantômes. Ce sont les villes qui rythment la structure du roman.
P. B. : Vous publiez votre deuxième roman, Les marins ne savent pas nager, en 2022. Encore une fois, l’accueil est plus que favorable2. L’œuvre est retenue en première sélection du Grand Prix de l’Imaginaire 2023 en plus d’être finaliste au Prix littéraire des collégien·ne·s et au Prix des libraires du Québec. La critique semble unanimement séduite. Êtes-vous sensible à ce type d’accueil ? Lisez-vous les critiques de vos livres ?
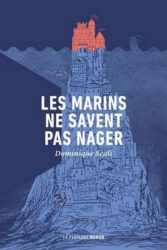 D. S. : Je les lis. Je suis sensible, surtout quand c’est positif. Mais ce n’est pas pour cela que j’écris. Écrire demande du temps et de la réclusion. Pour que ce soit le but, cela ne vaut pas la peine, la récompense est trop décalée. Le vrai plaisir, c’est de faire le livre. C’est de le pondre. C’est de vivre dans cet univers. C’est de le voir fini. Il n’y a rien qui puisse battre la sensation de me coucher le soir, d’éteindre la lumière puis de devoir la rallumer parce que j’ai une idée. Une fois que le livre est sorti, c’est comme s’il ne m’appartenait plus. Il a sa propre vie.
D. S. : Je les lis. Je suis sensible, surtout quand c’est positif. Mais ce n’est pas pour cela que j’écris. Écrire demande du temps et de la réclusion. Pour que ce soit le but, cela ne vaut pas la peine, la récompense est trop décalée. Le vrai plaisir, c’est de faire le livre. C’est de le pondre. C’est de vivre dans cet univers. C’est de le voir fini. Il n’y a rien qui puisse battre la sensation de me coucher le soir, d’éteindre la lumière puis de devoir la rallumer parce que j’ai une idée. Une fois que le livre est sorti, c’est comme s’il ne m’appartenait plus. Il a sa propre vie.
P. B. : Les marins ne savent pas nager se déroule sur l’île fictive d’Ys, au milieu de l’Atlantique. On y trouve deux catégories de population : les citadins sont protégés par de hautes murailles alors que les riverains sont exposés aux grandes marées des équinoxes qui peuvent être meurtrières. Comment l’idée de cette île vous est-elle venue ?
D. S. : Plein d’éléments volés un peu partout m’ont permis, une fois mis ensemble, de construire cette idée. J’avais fait une tournée en France pour mon premier roman. Je suis allée à Saint-Malo par curiosité. Il m’a semblé qu’il y avait quelque chose de très fou dans cette vision d’une cité fortifiée avec l’eau des marées qui se frappe contre les murailles. C’est de là que m’est venue cette idée de cité fortifiée à l’abri des eaux. J’ai eu l’idée des grottes où se cachent les riverains quand je lisais du folklore breton, des histoires de grottes, de goules et de fées. C’est une façon pour moi de recréer la dynamique des sirènes et des humains, les gens qui vivent au sec et les gens qui vivent dans l’eau. Il y a aussi la légende bretonne d’Ys, qui est venue tard dans mon processus. Ys était une cité médiévale qui s’est engloutie avec toutes ses richesses. Je me suis dit que, s’il y avait une île au milieu de l’Atlantique où des pêcheurs se rendent, des pêcheurs bretons, et qu’ils voyaient cette île aux très fortes marées, ce ne serait pas impossible qu’ils lui donnent le nom d’Ys parce qu’elle leur rappellerait la légende de chez eux.
P. B. : Le personnage principal du roman s’appelle Danaé Poussin, une orpheline de neuf ans, au début du livre, que l’on retrouve à différents moments de sa vie adulte dans les parties suivantes. Elle possède un don rare, celui de nager, car même si les îliens dépendent de la mer, la plupart sont incapables de s’y baigner. Comment êtes-vous passée de Pearl Guthrie à Danaé Poussin ? Dans les deux cas, ce sont des personnages féminins qui évoluent dans des univers masculins.
D. S. : Je ne peux pas m’expliquer pourquoi j’aime autant construire des univers virils alors que je n’évolue pas du tout dans un tel univers dans ma vie ! Mais j’aime bien cette idée de présenter des personnages féminins dans un monde où les codes de valeurs sont très peu ou pas du tout féminins. Danaé, pour moi, est le fil conducteur du roman. Elle est ma petite sirène, qui rêve de passer de l’autre côté, et qui y arrive d’une certaine façon mais qui échoue en même temps. C’est beaucoup dans les thèmes de l’échec et de la réussite.
P. B. : Le roman nous entraîne dans un univers que vous avez entièrement créé. Vous avez mis beaucoup de soin à décrire la façon de vivre, de penser et même de parler des riverains, des citadins et des marins, qui pratiquent différentes activités comme le cabotage. Vous avez même inclus une carte d’Ys et une ligne du temps, puisque votre île possède sa propre chronologie. Qu’avez-vous inventé d’autre à propos d’Ys que vous n’avez pas réussi à mettre dans votre livre ?
D. S. : Il y a beaucoup de fragments que je n’ai pas mis, mais l’essentiel est là. Il y a effectivement une ligne du temps dans le roman. J’utilisais un tableau Excel avec seize colonnes. C’était compliqué ! Il fallait que je m’assure que tout soit cohérent. Le défi que j’avais avec ce livre était d’inventer un monde puis de m’en dissocier. Non seulement l’île d’Ys n’existe pas, mais s’il y avait vraiment une telle île au milieu de l’Atlantique, cela changerait complètement l’histoire de l’Occident. Cela me permettait donc de faire une uchronie et de réinventer l’histoire à partir de là, de créer une culture. Une culture où tout est marin, où tout le monde pense en marin même si tout le monde ne sait pas naviguer.
* « Une culture où tout est marin, où tout le monde pense en marin […]. » Photo: Sophie Gagnon-Bergeron.
1. Le présent article reproduit des extraits d’un entretien de 60 minutes qui s’est déroulé le 22 avril 2023 dans le cadre du festival littéraire international Frye, avec l’appui du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Transcription : Mega Satish.
2. L’entretien a eu lieu près d’un mois avant l’annonce que Dominique Scali remportait le Prix des libraires du Québec 2023, le prix Jacques-Brossard [Québec] et le prix Imaginales [France].











