Hélène Leclerc habite le monde en poète. Elle écrit de brefs poèmes – que l’on appelle haïkus – où la vie se déploie et s’éveille. Ces trois petites lignes, qui ressemblent à une respiration, apportent un rythme très particulier à la poésie. Elles nous apprennent à lire, elles nous réapprennent à voir. En aérant le poème, Hélène Leclerc nous rappelle la nécessité de la lenteur et de la méditation.
Ses haïkus apaisent notre agitation et laissent entendre, souvent pour la première fois, le chant allégé de la terre. Ainsi, le vaste univers qui nous entoure prend la parole. Elle écrit dans son très beau recueil Des étages de ciel :
au bout du champ
une silhouette familière
la montagne bleue
Immédiatement on aime cette « montagne bleue », mystérieuse présence rendue visible grâce à l’écriture. Elle se tient au bout du champ, mais aussi au bout du poème, dans une sorte de fulgurance que seule l’attention au présent permet de percevoir. Elle nous attend, cette « montagne bleue », depuis toujours, pourrait-on croire. Elle semble toute légère, avec seulement sa couleur pour peser sur le monde. Et on voudrait la tenir au creux de la paume, en faire à son tour un poème, un petit amoncellement éphémère. Hélène Leclerc écrit :
par la fenêtre
sa petite main ouverte
pluie d’été
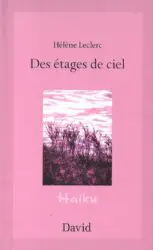 Quelle merveille que cette « petite main » de toutes les enfances qui touche le ciel et attrape la pluie de l’été ! Et si c’était cette « petite main » qui écrivait les haïkus ? La main que chaque poète tend vers le monde pour ne plus être seul et participer entièrement à la vie. Cette rencontre avec le réel, Hélène Leclerc y parvient avec une rare sensibilité par une suite de dépouillements qui caractérisent sa pratique du haïku. La brièveté des poèmes n’est que la partie visible de son travail d’écriture ; elle s’avère pourtant le résultat d’un long et discret cheminement vers la simplicité.
Quelle merveille que cette « petite main » de toutes les enfances qui touche le ciel et attrape la pluie de l’été ! Et si c’était cette « petite main » qui écrivait les haïkus ? La main que chaque poète tend vers le monde pour ne plus être seul et participer entièrement à la vie. Cette rencontre avec le réel, Hélène Leclerc y parvient avec une rare sensibilité par une suite de dépouillements qui caractérisent sa pratique du haïku. La brièveté des poèmes n’est que la partie visible de son travail d’écriture ; elle s’avère pourtant le résultat d’un long et discret cheminement vers la simplicité.
Je souhaitais faire entendre la voix discrète de cette poète. Voici, le plus simplement du monde, notre échange.
Michel Pleau : Est-ce qu’il y a un lien entre l’enfance (et peut-être même ton enfance) et le haïku ?
Hélène Leclerc : Je ne peux pas répondre pour le haïku en général parce que nous avons tous une manière différente d’en écrire mais, personnellement, je répondrais oui à ta question. J’étais une enfant hypersensible et vraiment très timide. J’observais tout avec intensité et je parlais peu. (J’entends rigoler ceux qui me connaissent aujourd’hui, je sais que c’est difficile à croire !) Je collectionnais des instants et je les rangeais précieusement dans une grande armoire mémoire. Comme une collection de billes. Dans mes plus belles, il y avait beaucoup de brillance qui provenait de nos vacances en forêt : le lac à l’aube, les nombreuses randonnées en canot avec mon père, les longs bras du soleil qui faisait danser la brume et la brise qui caressait ma joue. J’avais du mal à bien respirer à l’école mais, dès que j’allais en forêt, je me sentais à la maison. Ma mémoire sensorielle est devenue un atout précieux quand j’ai commencé à écrire des haïkus. Avec les années, je suis devenue une collectionneuse d’instants.
Il y a aussi quelque chose de l’enfance dans ma façon d’aborder le haïku, quelque chose dans le regard. Quand on est enfant, on apprend à nommer, à identifier : ceci est un arbre ; là, c’est une fleur. Ici, ça s’appelle une maison et là, c’est une route. La neige qui tombe, la lune, le lac, les étoiles. Plus tard, on ne s’y attarde presque plus, on vit dans notre tête, dans notre moulin à penser, c’est comme si un voile plus ou moins opaque masquait notre vision. Le haïku m’a aidé à écarter un peu ce voile et à retrouver ce que j’appellerais l’innocence du regard. Le voile est devenu une voile pour avancer dans le vent. Je n’en reviens pas encore de la beauté des arbres, je n’en reviendrai jamais de la lumière qui flotte sur l’eau et de la façon dont les grandes herbes se balancent dans le vent. L’odeur d’une pluie d’été, la tendresse d’une amitié et la poésie des chats. Je n’y arrive pas toujours mais, pour écrire, je m’applique à regarder ce qui m’entoure comme si c’était la première fois.
M. P. : Comment as-tu fait la rencontre de cette poésie brève et pourquoi a-t-elle marqué autant ton existence depuis près de vingt ans ?
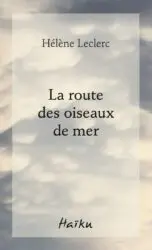 H. L. : J’ai commencé à écrire au milieu des années 1990. À l’époque, j’écrivais surtout ce qu’on appellerait aujourd’hui des fragments. Puis, avec le temps, j’ai délaissé peu à peu l’écriture et c’est à la suite d’une perte d’emploi, une dizaine d’années plus tard, que le désir d’écrire a refait surface. Comme si c’était une question de survie, j’ai dépoussiéré mes petits écrits pour aller, bien naïvement, à la recherche d’un éditeur. En fouillant sur le Web à la recherche d’éditeurs de poésie brève, de clic en clic je me suis retrouvée… sur un site de haïkus québécois ! « Quoi ? Ça existe des haïkus québécois ? » Je l’ignorais complètement. Les haïkus d’André Duhaime m’ont particulièrement frappé, spécialement celui-ci : « sur les vitres / des traces de nez et de doigts / regardent encore la pluie ». C’est difficile à expliquer, mais cette découverte a été fulgurante, l’émotion a été instantanée. J’ai su dès cet instant que cette forme de poésie allait devenir importante dans ma vie. Je connaissais vaguement l’existence des haïkus, mais je croyais que c’était une poésie pratiquée seulement par des maîtres japonais du XVIIe ou du XVIIIe siècle ; je ne savais pas qu’il s’en écrivait encore aujourd’hui et, surtout, qu’il s’en écrivait au Québec.
H. L. : J’ai commencé à écrire au milieu des années 1990. À l’époque, j’écrivais surtout ce qu’on appellerait aujourd’hui des fragments. Puis, avec le temps, j’ai délaissé peu à peu l’écriture et c’est à la suite d’une perte d’emploi, une dizaine d’années plus tard, que le désir d’écrire a refait surface. Comme si c’était une question de survie, j’ai dépoussiéré mes petits écrits pour aller, bien naïvement, à la recherche d’un éditeur. En fouillant sur le Web à la recherche d’éditeurs de poésie brève, de clic en clic je me suis retrouvée… sur un site de haïkus québécois ! « Quoi ? Ça existe des haïkus québécois ? » Je l’ignorais complètement. Les haïkus d’André Duhaime m’ont particulièrement frappé, spécialement celui-ci : « sur les vitres / des traces de nez et de doigts / regardent encore la pluie ». C’est difficile à expliquer, mais cette découverte a été fulgurante, l’émotion a été instantanée. J’ai su dès cet instant que cette forme de poésie allait devenir importante dans ma vie. Je connaissais vaguement l’existence des haïkus, mais je croyais que c’était une poésie pratiquée seulement par des maîtres japonais du XVIIe ou du XVIIIe siècle ; je ne savais pas qu’il s’en écrivait encore aujourd’hui et, surtout, qu’il s’en écrivait au Québec.
Tout dans cette forme de poésie me plaisait : sa brièveté, ses mots simples, sa fulgurance, son habileté à dire beaucoup avec si peu de moyens. Cette façon de s’émerveiller devant le presque rien. Je me suis reconnue dans tout. J’ai eu la nette impression que, pendant toutes ces années, il y avait en moi un très vieux poète japonais qui s’était assoupi au pied d’un arbre. Son œil était maintenant ouvert.
M. P. : Qu’est-ce que le haïku t’a appris et qu’est-ce qu’il nous apprend du monde ?
H. L. : Le regard que la pratique du haïku m’a aidé à développer m’accompagne au quotidien ; il m’anime, m’habite, m’aide à traverser les épreuves, même quand je passe des mois sans écrire une seule ligne ! Ça va au-delà du simple geste d’écrire. Avant la poésie, il y a le regard et c’est ce regard qui m’aide à vivre. J’y puise une grande force, une douceur. Pour répondre plus directement à ta question, je dirais que le haïku m’apprend à voir la beauté dans les replis ordinaires du monde. Je n’écris pas que sur la nature, je ne fais pas de discrimination entre les thèmes qui sont traditionnellement plus poétiques et ceux qui le sont moins. Peux-tu croire que j’ai écrit sur le petit bol d’air que creuse au fond de la paume le séchoir à main ? (Rires.) Sans oublier le trafic sur l’autoroute 20, le GPS, les cônes orange. La poésie est partout, dans l’ordinaire du quotidien ; c’est ce que le haïku m’apprend du monde.
M. P. : Le haïku explore-t-il le visible ou l’invisible ?
H. L. : Le haïku est une poésie du visible, du concret ; il s’écrit en s’inspirant de nos cinq sens, mais il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une série de haïkus uniquement descriptifs. Je crois que pour ressentir la poésie du monde, il faut être attentif autant à ce que l’on voit qu’à ce que l’on ne voit pas. Il faut se laisser toucher par un paysage pour en percevoir le chuchotement. Je dis peut-être n’importe quoi, mais j’ai l’impression que le visible est soutenu par l’invisible. Les oiseaux pourraient nous en parler. On connaît si peu de chose de notre monde, on ne peut que s’exercer à le ressentir. On a découvert il y a quelques années que les arbres communiquaient entre eux par les racines, qu’ils s’entraidaient. À force de fouiller dans les entrailles du monde, peut-être qu’un jour les scientifiques découvriront le plus beau des poèmes !
M. P. : Il y a une belle communauté haïku au Québec. Comment vois-tu l’avenir de cette forme poétique chez nous ?
 H. L. : Tu as raison, il y a une belle communauté haïku au Québec, nous avons ici des haïkistes au talent exceptionnel. Je pourrais en nommer plusieurs, mais spontanément je pense à Jimmy Poirier, Jeanne Painchaud, Hélène Bouchard, France Cayouette. Nous écrivons un haïku nord-américain fortement inspiré de la démarche du poète japonais Masaoka Shiki (1867-1902), qui prônait la simplicité et le haïku croqué sur le vif. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans notre approche, on rigole beaucoup lors des rencontres de haïkistes ! Notre rapport à la nature est puissant, nos grands espaces sont traversés par un fleuve qui nous traverse aussi. L’intensité de nos quatre saisons transparaît aussi dans nos écrits.
H. L. : Tu as raison, il y a une belle communauté haïku au Québec, nous avons ici des haïkistes au talent exceptionnel. Je pourrais en nommer plusieurs, mais spontanément je pense à Jimmy Poirier, Jeanne Painchaud, Hélène Bouchard, France Cayouette. Nous écrivons un haïku nord-américain fortement inspiré de la démarche du poète japonais Masaoka Shiki (1867-1902), qui prônait la simplicité et le haïku croqué sur le vif. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans notre approche, on rigole beaucoup lors des rencontres de haïkistes ! Notre rapport à la nature est puissant, nos grands espaces sont traversés par un fleuve qui nous traverse aussi. L’intensité de nos quatre saisons transparaît aussi dans nos écrits.
Je suis assez optimiste concernant l’avenir du haïku au Québec. On n’a qu’à regarder le succès du magnifique album jeunesse Mon été haïku, créé par Jeanne Painchaud. Enfin, si je me fie aux réactions des jeunes dans les écoles quand j’anime des ateliers d’introduction au haïku, « le haïku, c’est cool » et il fera partie du paysage littéraire du Québec pendant encore très longtemps.
M. P. : Tu as fait de ta pratique du haïku un engagement profond : poète, anthologiste, conférencière, animatrice d’ateliers. Il est difficile d’imaginer ta vie sans la présence du haïku. Quels sont tes prochains projets ?
H. L. : Je n’ai pas de recueil personnel en route, mais je publie ces jours-ci chez David un projet un peu particulier dont le titre est Le plus petit poème au monde. Introduction au haïku, suivi d’une anthologie. C’est un livre qui a été conçu en deux parties : une première dans laquelle j’explique mon approche et les différentes caractéristiques propres à cette forme de poésie, et une seconde où le lecteur pourra lire des haïkus d’une cinquantaine de haïkistes du Québec et de la francophonie canadienne.
Hélène Leclerc a publié cinq recueils de haïkus, tous chez David (Ottawa) :
Lueurs de l’aube, 2007 ; Cette lumière qui flotte, 2009 ; Des étages de ciel, 2011 ; Entre deux ciels, 2017 et La route des oiseaux de mer, 2020.
EXTRAITS
corde à linge
le vent tente d’enfiler
un pantalon
Lueurs de l’aube, p. 64.
je t’écris un courriel
mon ombre
joue du piano
Cette lumière qui flotte, p. 68.
rencontre matinale
toutes les forêts du monde
dans les yeux du cerf
Entre deux ciels, p. 82.
brise sur la grève
quitter un instant le roman
pour lire le fleuve
La route des oiseaux de mer, p. 7.
jardin d’hiver
soudain visible
la poésie du monde
La route des oiseaux de mer, p. 56.











