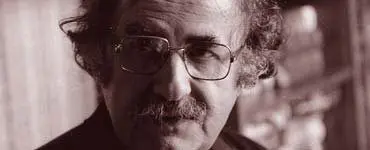On est toujours un peu surpris lorsqu’on entend dire qu’un tel a publié 100 romans, qu’un autre en a fait paraître 200, voire (pourquoi pas ?) 300. On se dit, sans même les avoir lus, qu’ils auraient dû en écrire moins et s’appliquer un peu plus, pas vrai ?
Quand il s’agit de Georges-J. Arnaud, on parle de plus 400 romans, qui lui ont valu des mentions dans Le livre des records Guinness, bien sûr, mais aussi (et surtout) plusieurs distinctions et prix littéraires, et une reconnaissance par ses pairs et par les acteurs des milieux littéraires. Comme quoi chez cet auteur, quantité a souvent rimé avec qualité. Ce qu’il y a de bien avec cet honneur que l’on fait à l’auteur en rééditant ses œuvres, c’est qu’il le mérite.
La rencontre du double
Georges Arnaud est né en 1928 à Saint-Gilles dans le Gard. Il a une enfance assez mouvementée, connaissant une succession de déménagements. Il fait des études de droit mais à peine la vingtaine passée, il est contraint de faire son service militaire, ce qui n’est pas chose facile pour ce non-conformiste. Rêvant depuis toujours de devenir écrivain, il envoie un manuscrit au Prix du Quai des Orfèvres, un des prix le plus courus de la littérature policière, qu’il remporte en 1952, coiffant sur la ligne Léo Malet qui le taquinera longtemps avec cette anecdote, mi-sérieux, mi badinant. Mais 1952, c’est aussi l’année d’un autre grand roman : Le salaire de la peur de Henri Girard qui décide de prendre le pseudonyme de Georges Arnaud. Le roman fait un tel tabac et connaît un tel succès qu’il sera adapté au grand écran par Henri Georges Clouzot et gagnera l’année suivante le Prix du meilleur film à Cannes. « En ce qui concerne la découverte du Salaire de la peur dans les vitrines des librairies dans le début des années cinquante, je préfère oublier le choc viscéral, intellectuel qui me mit K.-O. Dans un flash de naïveté stupide je crus un instant que j’étais l’auteur inconscient de ce bouquin avant de tomber dans l’effroi. Effroi d’un avenir perdu avant d’avoir commencé. Tout faraud j’arrivais avec mon premier roman policier très éloigné du chef-d’œuvre, mais qui me paraissait tel cependant dans mes vingt-quatre ans narcissistes. Je me suis senti nain auprès d’un géant avec un rude handicap à surmonter. Je couvris ma honte de pseudonymes. » Devant le retentissant succès que connaît l’œuvre de celui qui lui a volé son patronyme, Arnaud se voit obligé par son éditeur de prendre un pseudonyme et Ne tirez pas sur l’inspecteur paraîtra sous le nom de Saint-Gilles en référence à son lieu de naissance. C’est seulement sept ans plus tard, lorsqu’il fera son entrée au Fleuve noir, qu’il retrouvera son nom en lui ajoutant un J qui fera toute la différence. Arnaud, heureux d’avoir retrouvé son nom, croit que l’histoire de l’homonyme est maintenant une chose du passé, mais il n’en est rien.
En 1987, bien assis dans son fauteuil, Georges-J. Arnaud regarde le bulletin de nouvelles de TF1 lorsqu’il voit apparaître sa propre photo sur l’écran. Le présentateur annonce la mort de l’auteur français. On vient de lui refaire le coup de l’homonyme ! Cependant, connaissant les déboires d’Henri Girard, il a une pensée pour ce dernier : pauvre Arnaud, on lui a fauché sa propre mort. Ce n’est qu’au bulletin de nouvelle de 23 heures que l’on rectifiera. Arnaud ne juge pas nécessaire d’assister aux obsèques de son homonyme. « […] pour moi depuis pas mal de temps l’ambiguïté était close, j’avais grâce à cette lettre unique, le J qui suit mon prénom Georges, conquis mon lectorat. […] Si Girard m’a volé une partie de ma vie, disons une quinzaine d’années, je lui ai volé sa mort comme l’ont écrit les journaux, en ce sens que le soir même de l’annonce de son décès, TF1 toujours aussi inénarrable de bêtise a diffusé une interview de moi. »
« Série Noire » vs Fleuve noir
Georges-J. Arnaud a un profond dédain pour l’élitisme et tous ceux qui se pavanent. Après la guerre, il fallait avoir un pseudonyme américain pour publier à la « Série Noire » des éditions Gallimard et plusieurs auteurs français ne se gênaient pas pour le faire. Le cas de Boris Vian, voulant venir en aide à un copain éditeur en manque de textes américains, représente bien la situation. J’irai cracher sur vos tombes, paru sous le pseudonyme Vernon Sullivan, aux sonorités combien américaines, connaîtra succès et scandale. À la fin des années 1950, Arnaud, après une rencontre avec François Richard, passera des éditions l’Arabesque à la grosse machine du Fleuve Noir où il pourra enfin vivre pleinement de sa plume. Au départ, il signe des gros romans, puis il fait son entrée dans les collections « Spécial-Police » (1960) et « Espionnage » (1961). « Quand j’ai commencé au Fleuve Noir, les tirages des polars étaient de quarante mille contre les six, sept mille de la ‘Série Noire’. Tous ces auteurs dits littéraires de la SN venaient sous pseudonymes gagner leur croûte au Fleuve… […] Certains abandonnèrent carrément la SN pour le Fleuve. Quarante mille exemplaires en polar et cent à deux cent mille pour l’espionnage, et nous étions payés sur le tirage qu’il soit ou non complètement vendu. […] Pour ma part le FN m’a permis de réaliser mon rêve d’adolescent, vivre de mes bouquins dans une tranquille aisance. »
Érotisme et fantastique en parallèle
Parallèlement à la carrière qui se dessine pour lui au Fleuve Noir, où il se consacrera, jusqu’en 1980, surtout au polar noir et à l’espionnage, Georges-J. Arnaud publie à l’Arabesque quelques romans policiers de facture plus classique et des romans érotiques. Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, Arnaud ne renie pas ces écrits. Il avoue d’ailleurs avoir une certaine sympathie pour la série Marion. La majeure partie de ces œuvres publiées sous différents pseudonymes fut reprise par l’éditeur Eurédif à compter de 1971. En 1974, il commence à rédiger sous le pseudonyme d’Ugo Solenza le cycle historique et galant de Marion qui lui demande une importante documentation. Il terminera cette série de 15 titres en 1976.De 1979 à 1984, il signe le cycle des Pascal, une série érotique de 17 romans.
Le polar : roman d’humeur et critique sociale
Mais jusqu’en 1980 environ, époque à laquelle il commence la rédaction de La Compagnie des glaces (près de 95 titres depuis 1980), c’est le polar (mais aussi l’espionnage) que privilégiera Georges-J. Arnaud. Le romancier a d’ailleurs souvent soutenu qu’il a écrit des romans d’espionnage uniquement parce que cela lui permettait de pouvoir écrire des polars, un genre qui rapportait moins d’argent, mais dans lequel il devenait, pour reprendre les paroles de Michel Lebrun : « Un redoutable créateur d’univers ». Rapidement, Arnaud abandonne le personnage récurrent de ses premiers romans, l’inspecteur Sigorgne, pour se tourner vers des romans au décor plus politique (Tatouage, 1967). Ses personnages, souvent des femmes, refusent de se laisser manipuler et montrent bien toute la place qu’elles commencent à prendre dans la société (Tel un fantôme, 1966 ; Un petit paradis, 1974 ; Afin que tu vives, 1962). Réagissant promptement à différents phénomènes de société, Arnaud rédige des romans d’humeurs dans lesquels il dénonce l’État, les sociétés de travail temporaire et les multinationales. « J’ai eu la prétention parfois de dire que je faisais ce que les journalistes d’une certaine presse ne faisaient pas […] et ces mêmes journalistes à plusieurs reprises se sont étonnés que je possède une telle documentation […]. Mes romans n’étaient pas aussi spontanés que vous le pensez car ils nécessitaient une importante documentation pour éviter les procès. » Le meilleur exemple de ce type de roman est sûrement Plein la vue ( 1976), un livre pro-écologie qui s’interroge sur les effets dévastateurs des produits chimiques sur l’environnement. La même année, l’auteur gagne le Prix mystère de la critique pour son roman Enfantasme qui le consacre comme un des plus importants auteurs de romans noirs contemporains. Lecteur des grands romanciers du XIXe siècle, Arnaud n’est pas moins proche de ses classiques. « Lorsque j’apprenais nos classiques, Corneille, Racine, Molière, j’étais vraiment séduit par la règle des trois unités : ‘Qu’en un jour, un seul lieu, un seul fait accompli tiennent jusqu’à la fin le théâtre rempli’ (Boileau). Je suis resté fidèle à cette règle dans l’ensemble. » En raison de ces resserrements du temps, du lieu et de l’action, la maison devient un des thèmes les plus importants dans l’œuvre arnaudienne : la maison comme refuge (Le coucou, 1980 ; Le veilleur, 1984) et la maison mystérieuse (La maison-piège, 1975 ; Bunker parano, 1982). En 1986, alors que la collection « Spécial-police » est en perte de vitesse, l’écrivain a l’honneur de publier le numéro 2000 de la nouvelle collection « Polices ». Mère carnage marque donc la fin d’une époque, et le début d’une autre où l’auteur natif des Corbières se consacre à des romans historiques et à une saga familiale.
La Compagnie des glaces : héritière des grands cycles balzaciens
De 1971 à 1973, Georges-J. Arnaud publie dans la prestigieuse collection « Anticipation » des éditions Fleuve Noir ses trois premiers romans de science-fiction qu’il regroupe sous l’appellation Chronique de la grande séparation. Malgré le fait que cette trilogie connaisse un certain succès, la science-fiction demeure encore, pour lui, un genre moribond. L’écrivain est cependant bien loin de se douter alors que ce genre littéraire deviendra sa principale préoccupation de la décennie 1980 jusqu’à aujourd’hui. En 1980, paraissait, toujours dans la même collection, le roman La Compagnie des glaces. La première série, qui ne devait compter que quelques titres, en comprendra finalement 63. Sans réellement s’en rendre compte au départ, Arnaud est en train d’écrire un grand cycle digne de La comédie humaine de Balzac, des Rougon-Maquart de Zola ou des Habits noirs de Féval, trois auteurs qui l’ont marqué et dont il lit les plus belles pages encore aujourd’hui.
Mais lorsqu’on s’est donné les habitudes de travail permettant d’écrire 63 romans en 12 ans (de 1980 à 1992), que l’on s’est attaché aux personnages qui ont traversé toute cette période, il n’est pas facile de tourner la page. L’écrivain sent le besoin de reprendre certains éléments de cet univers. Il écrira de 1995 à 2000 les onze volumes qui forment les Chroniques glaciaires avant d’entreprendre, en 2001, La Compagnie des glaces nouvelle époque, une nouvelle saga sur l’univers de la Compagnie des glaces qui comptera une vingtaine de titres d’ici la fin de l’année 2004.
Bien qu’il semble manœuvrer dans ce milieu comme un poisson dans l’eau, Georges-J. Arnaud avoue lui-même ne pas vraiment être à sa place dans le milieu mondain de la S. F. « J’écris de la science-fiction (même si à mon sens ce que je fais n’en est pas) mais je ne me sens pas chez moi dans les conventions ou festivals de ce type de littérature […]. En réalité, je m’y ennuie copieusement, alors que je m’attarde volontiers dans les réunions de polardeux […]. D’abord je n’en lis jamais. Ma culture se limite à Jules Verne et aux Chroniques martiennes, par la suite quelques Brussolo. Ce qui, je pense, fait ma différence c’est que ce que j’écris dans la CDG n’a rien d’épique, ni rien de lyrique, relève du quotidien, ne néglige pas le commun, le banal, le petit peuple si j’ose dire, les contingences de la vie qui, malgré les bouleversements continuels, se poursuit souterrainement, sans princesses, sans mondes survoltés, sans philosophie bâtarde, dans un prosaïsme qui ne s’effacera jamais car il est la nature même de l’homme. Mon homme à moi et surtout ma femme héroïne sont toujours aussi frileux dans leurs ambitions, toujours aussi terre à terre. Ils gèlent mais que trouvent-ils comme défense ? Un teuf-teuf, un vulgaire tortillard pour se donner un peu de chaleur, de lumière et de quoi affronter l’horreur extérieure. La plupart sont dépenaillés, affamés et ne sont que les héritiers misérables de notre monde. Ils récupèrent les déchets, les ordures d’une civilisation comme les éboueurs du Caire ou de Mexico. Ma seule création peut-être S. F. c’est le bulb, mais avec une volonté sarcastique de le rendre grotesque […]. Donc pas de S. F. héroïque chez moi, c’est-à-dire pas de S. F. mais ce que j’appellerais une sorte d’anticipation pessimiste. »
S. F. ou pas, l’entreprise d’Arnaud fait des petits ; après tout, on est à l’heure des produits dérivés : jeu de rôles, bandes dessinées de la première époque, chandails et une série télé de la Compagnie des glaces qui devrait paraître sous peu à l’écran.
Auteur d’une œuvre qui continue de séduire peu importe le genre, Arnaud est sans aucun doute un magnifique créateur d’univers qui attire de plus en plus les lectorats spécialisés. Le sympathique et disponible Georges-J. Arnaud est l’un des auteurs les plus lus de sa génération ; gageons que celui qui en a déjà écrit plus que sa part saura nous divertir encore, tous genres confondus. Après tout, n’est-ce pas là le rôle premier des romanciers populaires ?
Georges-J. Arnaud a publié, entre autres :
Enfantasme (Prix mystère de la critique 1977), « Spécial-police », Fleuve Noir, 1976 ; Le coucou, « Spécial-police », Fleuve Noir, 1980 ; La Compagnie des glaces (réédition en 15 omnibus de 4 romans chacun), Fleuve Noir, 1996 ; L’antizyklon des atroces, « Le Poulpe », Baleine, 1998 et Librio, 2001 ; L’étameur des morts (Trophée de l’Association 813, remis au meilleur roman, 2001), Du Masque, 2001 et Le livre de poche, 2003 ; Le cavalier-squelette, Du Masque, 2002 ; Les intégrales, tome I (5 romans), Du Masque, 2002, tome II à paraître au printemps 2005 ; La Compagnie des glaces, Lien Rag (cycle Jdrien) (bande dessinée), Jotim-Dargaud, 2003 ; Les secrets de l’allée Courbet, « Noir urbain », Autrement, 2004.