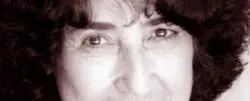Le silence premier des êtres proches, fait de tout ce qui n’a pas été dit, qui pourrait et devrait être dit. Ou bien tant de mots vains et vides qui courent, s’entassent et étouffent qui les entend. Où trouver la voie de la délivrance ? Un jour, elle écrirait
« Enfant, elle ne parlait pas », dit Esther Croft d’une petite fille qui lui ressemble étrangement. Un silence et une absence : « Ma mère n’était pas là à ma naissance ». Phrase étonnante de la narratrice à la première ligne de La mémoire à deux faces, premier livre de nouvelles publié par l’auteure. Dès ses débuts, l’essentiel de l’œuvre est ainsi posé, le point névralgique autour duquel elle va tourner et qui va imposer rapidement Esther Croft parmi nos écrivains.
Des études au Collège Bellevue de Québec, puis en pédagogie à l’Université Laval. Elle se passionne pour Georges Bernanos, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Romain Gary, « la génération des désespérés », pour Dostoïevski. Et spécialement pour le théâtre, dont elle a la révélation par les pièces télévisuelles de Marcel Dubé. L’histoire des couples, les tensions qui s’y exercent : ces pièces mettaient en scène ce qu’elle observait sans avoir encore trouvé le moyen de l’exprimer. Ainsi s’ouvrait le champ d’exploration par les mots d’une réalité contemporaine immédiate : ce n’étaient plus des pièces venues d’ailleurs et qui parlaient d’un ailleurs mais du milieu québécois en son inaptitude si répandue à communiquer. « J’écrirai, moi aussi, pour faire entendre ce qui se tait en moi et autour de moi. J’ai quinze ans et je veux comme Dubé avoir accès à ce qui se cache ‘De l’autre côté du mur’. » S’ouvrait en même temps le champ de la fiction, elle-même révélatrice de la réalité.
L’intention d’Esther Croft de passer à l’écriture se précise lors de deux séjours prolongés à Paris avec son mari et grâce aux encouragements du P. Benoît Lacroix à qui elle fait lire des textes. Il contribue à faire jouer Les mains libres à l’Université McGill en 1974. L’élan décisif est donné et Radio-Canada diffusera plusieurs pièces radiophoniques en ces mêmes années soixante-dix. « La voix sans le corps » lui permet de trouver la sienne propre par l’intermédiaire d’une autre. Plus encore, la radio, par sa nature même, impose à l’écrivain d’apprendre à modeler et à moduler la phrase en son rythme et son intonation, ce qu’Esther Croft parviendra à maîtriser dans ses livres avec la plus grande justesse.
Lever les interdits
D’autres rencontres d’écrivains, qu’elles soient personnelles ou par l’entremise des livres, l’éclairent et la confortent dans son désir d’écrire, même si elle recule encore devant la publication. À maintes reprises elle leur a rendu hommage avec émotion. Au premier rang Françoise Loranger – qui a encouragé plusieurs vocations dans les lettres québécoises. Audacieuse dans son théâtre où elle met en scène des sujets qui en étaient jusque-là exclus – l’euthanasie, l’inceste, l’indépendance du Québec –, Françoise Loranger savait en quelques mots parfois abrupts toucher au cœur l’écrivain débutant et le révéler à lui-même. De Claire Martin, Esther Croft a retenu le courage de montrer la famille et l’éducation, également pétries d’hypocrisie sous le voile de la religion, l’étouffement et la souffrance de l’enfant soumis à l’autorité écrasante, onctueuse ou brutale. Anne Hébert, souvent relue quand monte l’angoisse et que vient la tentation de se dérober à l’exigence lucide. « Grâce à elle, dit Esther Croft, je tenterai à mon tour de m’inscrire dans une littérature du vrai, c’est-à-dire une littérature qui ne triche pas par rapport à ses pulsions profondes. »
D’autres noms d’écrivains se présentent encore : Suzanne Jacob, « pôle d’attraction séduisant et déroutant », en perpétuel renouvellement, et dont le regard « nous laisse sans repos, il nous force à tout voir, tout supporter, tout intégrer ». Esther Croft se sent en proximité avec celles qui, selon des degrés variables de « féminisme », s’efforcent de définir et de vivre la condition de femme, de Monique Proulx et Monique LaRue à Aude et tant d’autres. Son admiration reconnaissante va tout autant à Réjean Ducharme qui donne à l’enfance « une voix attendrissante et aussi tragique, aussi naïve et aussi dure », à Yves Thériault dont la violence âpre fait « vibrer ce qui reste d’amérindien en chacun de nous, le primitif prêt à recommencer le monde ».
Ces parentés, parfois ces influences – ou, dit-elle, ces « permissions » – ont en commun de référer à des briseurs de silence. Les écrivains dont Esther Croft se réclame, plus spécialement les femmes, furent souvent les premiers et les premières à rompre des tabous qui emprisonnaient la société québécoise dans le mensonge, la macération du dolorisme, les routines de la pensée et du verbe, à révéler la part d’ombre collective soigneusement occultée. Esther Croft prend place dans cette lignée : elle livre une vérité qu’elle éprouve dans son cœur, sans élever la voix, sans amplifier l’expression, sans complaisance et cette parole, dans sa retenue et sa mesure, en acquiert d’autant plus de vigueur. Mais comme chez Anne Hébert, sous la douceur policée, quelle somme de colère inspire une grande partie de l’œuvre ! Même si Esther Croft a des devancières dans l’acte de délivrance par l’écriture, il lui a fallu beaucoup de courage et de patience au sein même du doute pour en assumer la charge explosive.
Au retour de Paris, elle entreprend des études en littérature, met en chantier une thèse en création théâtrale, continue d’écrire pour la radio, donne à l’Université Laval des cours d’écriture et de critique dramatiques. Elle se rend compte cependant qu’une carrière universitaire traditionnelle dans ses constituantes figées d’enseignement, de recherches méthodiques, de fonctions administratives, de promotions, n’est pas sa voie. En 1980 elle inaugure des ateliers d’écriture qu’elle offre sans interruption jusqu’à ce jour avec beaucoup de succès. L’objectif est de permettre aux participants de s’exprimer par eux-mêmes – plusieurs d’entre eux parviendront d’ailleurs à la publication.
Les recueils de nouvelles
Un premier recueil d’Esther Croft, La mémoire à deux faces, paraît en 1988, suivi d’Au commencement était le froid en 1993 (qui obtient le Prix Adrienne-Choquette de la nouvelle), et Tu ne mourras pas en 1997. Les trois recueils peuvent être vus comme une trilogie, reliés par des galeries souterraines qui s’enfoncent toujours plus avant. Les titres eux-mêmes révèlent ce mouvement de retour à la recherche d’un foyer, avec l’espoir qu’il éclairera l’existence.
Dès l’ouverture ces textes sont étonnants de concision et de justesse. En quelques pages ils font surgir la situation d’un enfant, avant même sa naissance. Le petit être se demande s’il va s’incarner, car déjà il sait qu’il trouvera dans le monde souffrance et horreur. (Je repense ici à des poèmes de Jules Supervielle évoquant les limbes où flottent les êtres incréés, formes virtuelles qui le resteront peut-être). Venir au monde ou non, et, pour la mère, donner la vie ou la refuser ? Le récit se situe ici – et c’est à cela que tient sa réussite difficile à obtenir – non pas dans la pensée consciente mais au niveau viscéral. Ce qui se passe dans le corps traduit métaphoriquement chez la mère le désir simultané de faire vivre et d’imposer la mort.
Le mouvement vers la vie l’emporte en ces moments mais la victoire n’est pas acquise et elle ne le sera jamais définitivement. Entre la mère et le très jeune enfant se livrent des luttes muettes parce qu’elle sont en deçà du langage, dans le contact corporel refusé, les deux êtres semblant dans une incapacité totale à se rejoindre. Plus tard, à l’âge où l’enfant entend les propos qu’échangent les adultes, en l’occurrence les parents, elle comprend que le vrai n’y est pas dit, qu’il est toujours masqué. Le doute s’installe en la fillette puisque elle-même devine une réalité au-delà des apparences. Est-elle donc la seule à la percevoir, est-ce normal : « [S]uis-je folle ? », « est-ce que j’existe ? » Elle s’impose des tests pour le vérifier : est-elle vue et entendue des autres ? Pour échapper à l’angoisse, elle se donne une personnalité qui, elle, aura des chances d’être validée : la fillette sage, obéissante, parfaite. Dans un concours scolaire d’éloquence ce sera « l’autre » qui parlera à travers elle. La vraie s’est effacée, elle a « déserté » en une « éclipse totale », elle s’est installée dans l’imposture.
Que sera donc la vie adulte ? La continuation du mensonge qui, peut-être, un jour deviendra intolérable ? Et ce sera une chance que cette rupture, parfois même l’effondrement, puisque s’ouvrira enfin la possibilité du changement. Combien d’entre nous avons vécu cette mutation dans les douleurs d’une nouvelle naissance ? De cette expérience à la fois commune et individualisée, Esther Croft tire de courts récits bouleversants dont chacun approfondit celui qui a précédé, comme si une autre strate pouvait encore être atteinte et devait l’être. Ils sont nés souvent à l’improviste, d’impressions inscrites dans le cœur (par exemple « La mémoire » après la mort du père), d’une phrase intérieure (comme il en surgit dans l’écriture automatique que l’auteure a pratiquée) et voilà que la gratuité, parfois le non-sens apparent entrouvrent un monde ! Le discours s’organise en monologue qu’Esther Croft sait conduire avec maîtrise, rythmé selon le mouvement de l’émotion en ses méandres, parfois tenue à distance par l’ironie, voire la drôlerie. La sensation enregistrée, réactualisée, et l’imaginaire s’y fécondent mutuellement.
La situation dramatique tient souvent à une relation triangulaire enfant-mère-père dont, selon le cas, sera privilégié l’un des vecteurs. « À la mort de mon père, j’ai décidé de détester ma mère. » Mais le père est apparu parfois dans sa déchéance, dont l’enfant, malgré la honte qu’elle éprouve, essaye de le tirer. Parfois la frappe l’évidence : ses parents se sont détestés, la mère dominatrice, le père faible – un sujet pour François Mauriac À la mort du père, la mère pleure, pourquoi ? La haine n’est peut-être pas irrémissible, elle recouvre le sentiment d’un ratage, alors qu’il aurait pu en être autrement, un espoir qui, lui, n’est pas tout à fait mort ?
La voie romanesque
Ainsi les trois recueils composent les maillons d’une chaîne ou, plus exactement, une spirale descendante vers les zones les plus enfouies. Esther Croft a eu conscience d’être ainsi entraînée vers « le fond de la mine » – ce n’est pas seulement une image –, vers le dangereux, « le physiquement étouffant ». Il lui fallait remonter à la surface, aller ailleurs : il s’est trouvé qu’un roman se présentait, en quoi on peut voir sans risque excessif de simplifier, après le long travail de l’introversion accompli dans les nouvelles, un mouvement d’extraversion.
Des personnages y paraissent, dotés cette fois d’un nom, d’un état civil, d’une profession, d’un statut social. Le roman De belles paroles, dit Esther Croft, est né de la colère. « Bien avant sa conception […] il y a eu cette montée d’indignation, de plus en plus fréquente, de plus en plus envahissante face à certaines formes de mauvais traitements auxquels est soumis, trop souvent, le langage. » Colère face à ces « mauvais traitements », certes, mais aussi face à ceux qui les administrent, qui font de la parole un usage déloyal et mensonger, ceux qui trahissent la confiance qu’on leur accorde. « Histoire de séduction entre un brillant professeur de philo et une pédagogue timide. » Catherine sera une des victimes de Marc-André, qui disparaît sans laisser de traces et qui se révélera l’auteur d’actes criminels.
Le récit s’ouvre sur une longue lettre que Catherine écrit à l’intention de l’amant envolé, qui ne rejoindra évidemment pas son destinataire et restera sans réponse. Plutôt, elle se l’écrit à elle-même, pour essayer de comprendre, avec l’espoir de calmer sa blessure. Elle a été plus qu’abandonnée : trahie. Peu à peu sont mis en place dans la narration les éléments dramatiques et, progressivement, est révélée la situation morale de Catherine. Pas d’apitoiement chez elle, ni donc d’amplification rhétorique dans la narration qu’elle assume. Dans ces rappels du passé s’introduisent un à un de menus faits, gestes et paroles de Marc-André qui laissent entrevoir la vérité du personnage et rétrospectivement se chargent de sens, autant de failles qui se sont ouvertes dans la confiance. Des policiers viennent interroger Catherine sur la disparition de Marc-André : le récit omet leurs questions, le lecteur les devine, et, habilement, le dialogue revient au monologue. Ainsi l’unité de ton est préservée, le roman se resserre autour des thèmes qui le portent : confiance-tromperie, parole vraie-parole fausse, qui n’en constituent qu’un seul sous des facettes complémentaires.
Curieusement, la rédaction de ce roman – qui a connu un grand succès et valu à son auteure le Prix France-Québec – a été amorcée par la deuxième partie, alors que Catherine comprend qu’il lui faut entreprendre une vie différente, partir, travailler. Autre paradoxe : le dialogue commence avec des aphasiques (!) alors que Catherine se consacre à leur rééducation laborieuse mais soutenue par l’espoir.
Le long retour en arrière s’achève, le bilan a été dressé, nous suivons Catherine dans sa nouvelle existence, d’autres personnages paraissent, destinés précisément à en souligner la nouveauté et à faire progresser l’histoire. Le roman évoque en des épisodes émouvants des aspects de la vie sociale qu’on ne veut trop regarder, les prisons – Catherine encourage des détenus à dire par écrit ce qu’ils ont toujours tu –, la rééducation des handicapés de la parole. L’écriture d’Esther Croft s’oriente ici en des directions où elle s’était peu engagée. Des passages dialogués y prennent une valeur quasi documentaire mais le récit ne s’éloigne pas de sa ligne directrice.
L’exercice du langage est ainsi considéré sous des angles divers : chez ceux qui en ont toujours été incapables, chez ceux qui en ont perdu l’usage. Chez des privilégiés qui le manient avec virtuosité, pour le plus grand bénéfice de leur ego, pour le plus grand risque de ceux qui cèdent au mirage. On pourrait dire du langage ce qui a été dit, selon la formule célèbre, de la science : langage sans conscience n’est que ruine de l’âme Et enfin il y a les êtres qui doivent réapprendre la vérité des mots : Catherine elle-même. Chez elle l’amour pour un homme s’est identifié à celui du langage. Quand la confiance est rompue, les certitudes s’effondrent : « De quel côté des choses se trouve donc la réalité ? » Le roman rejoint ici le cœur des trois recueils de nouvelles.
Qui faut-il accuser, le maître-trompeur qui tire de son pouvoir des gratifications narcissiques et s’aveugle sur les ravages qu’il cause ? Catherine est-elle pour autant exonérée ? Aux dernières lignes elle s’interroge : « […] quand j’ai vu se refermer sur lui la portière de la voiture de police, j’ai su qu’une partie de moi s’apprêtait à comparaître en justice. Même si je n’ai pas encore fini de comprendre laquelle ». Ne faut-il pas incriminer le pourrissement global du langage dans notre société – notre époque n’en ayant pas l’exclusivité –, l’envahissement, souvent dénoncé parce que omniprésent, du stéréotype, de l’artifice, de l’automatisme des mots renvoyant à celui de la pensée, un langage corrompu qu’il faudrait purifier, revitaliser ? Redonner un sens plus pur aux mots de la tribu : reprendre la tâche mallarméenne, qui est aussi celle de Sisyphe
Vers l’apaisement
Ni le roman ni les nouvelles d’Esther Croft ne se referment sur un constat d’échec. Bien au contraire, une lumière les traverse, discrète mais agissante, particulièrement sensible dans la dernière nouvelle qu’elle a publiée à ce jour, « Libre chute ». Un couple âgé, elle peintre, lui musicien, parvient à la fin de leur vie commune. L’amour est toujours en eux et entre eux, mais la femme, malade incurable, décline, l’espace qui lui est accessible se restreint. Elle confie son désir à son époux : choisir le moment de sa mort. Et en pleine conscience elle s’abandonne au torrent qui coule près du chalet de leurs dernières vacances. Beau texte, pudique et tendre, d’où rayonne l’émotion que suscite l’exemple de la vieillesse vécue dans l’amour partagé. Des notes se font entendre ici, absentes ou rares jusqu’alors dans l’œuvre d’Esther Croft : à la guerre larvée que se livraient tant de couples succèdent l’accord profond, à l’angoisse la paix profonde, à la duperie la confiance sans faille, au silence asphyxiant le partage par les mots, les gestes, la musique. Fin de vie, mais on pourrait dire qu’elle continue de s’épanouir, en un temps où si souvent le monde perd ses couleurs et que le cœur se dessèche. Il palpite ici avec une douceur inconnue et la nature se fait neuve dans sa fraîcheur et sa beauté.
Si tant de personnages de ces récits vivent dans la souffrance, ils n’y sont pas irrémédiablement plongés, la noirceur ne semble que temporaire, comme une épreuve à traverser et qui peut l’être. Nulle condamnation n’est prononcée, nul jugement porté, seulement un constat, qui n’exclut ni l’indignation ni le refus, ni évidemment la douleur. La fatalité n’a pas sa place dans l’œuvre. Aux dernières lignes des nouvelles les plus sombres, souvent une lueur, le signe incertain d’un autre mode d’existence. C’est peu et c’est immense. Toujours Esther Croft enveloppe ses personnages de compassion et quand elle place devant nous ce vieux couple amoureux, elle nous dit sans ambiguïté : voilà comment, jusqu’à la fin, il faut vivre.
Œuvres d’Esther Croft :
La mémoire à deux faces, nouvelles, Boréal, 1988 ; Au commencement était le froid, nouvelles, Boréal, 1993 ; Tu ne mourras pas, nouvelles, Boréal, 1997 ; De belles paroles, roman, XYZ, 2002 ; « Libre chute », nouvelle, dans L’atelier des apparences, collectif, L’instant même, 2004. À signaler aussi un CD où Esther Croft s’entretient avec Alain Beaulieu, dans la série que celui-ci a réalisée à CKRL-MF 89.1, diffusée entre 1999 et 2002.
EXTRAITS
Tu avais souvent été fascinée par la nuit. Bien plus que par le jour. Pas seulement la nuit pleine de lune ou traversée d’étoiles filantes ; ni celle qui est criblée de sapins lumineux, d’accords tapageurs ou d’invitations douteuses au coin des rues clignotantes des centres-villes. Non, l’autre nuit aussi savait t’envoûter. Celle qui peut se faufiler clandestinement par la fenêtre d’une chambre désertée et s’affaler de tout son long au beau milieu du vide. L’audacieuse capable de pénétrer par effraction en plein centre de l’âme à trois heures de l’après-midi, d’y déballer en toute impudeur ses draps de satin noir et d’y faire ses petits. C’est celle-là, au fond, que tu connaissais le mieux, pour lui avoir été d’une fidélité presque parfaite.
Tu ne mourras pas, Boréal, p. 77.Ce soir-là, je suis restée longtemps à la fenêtre du salon. La rue était déserte, comme si toutes les voitures, déjà, avaient trouvé leur destination. Le fleuve se reposait en silence au bout de sa marée basse. Seules les cimes des ormes et des peupliers manifestaient un peu de vie dans le paysage éteint. Notre vieille maison craquait, comme d’habitude; mais étrangement, ce bruit sec me devenait presque rassurant. Et le silence qui suivait semblait avoir perdu le pouvoir qu’il possédait, la veille encore, de me projeter dans l’absurde.
De belles paroles, XYZ, p. 22.Durant les semaines et les mois qui ont suivi cette descente aux enfers, j’ai vu les arbres se dépouiller, le sol se durcir, les canards et les oies s’envoler, le fleuve se figer. J’ai vu les verts et les bruns blanchir sous le poids d’un autre hiver, le ciel se refermer sur une grisaille qui avait l’air définitive, les nuits avaler tout rond de grands morceaux de jour. J’ai vu les vitres s’embuer, les routes rétrécir, les maisons s’engouffrer dans des falaises de neige. À l’intérieur de la nôtre, qui ne parvenait pas à devenir 1a mienne, je pouvais sentir le silence et le froid s’installer, la lumière s’étouffer entre les fenêtres et les rideaux.
De belles paroles, XYZ, p. 50.Je n’étais pas toujours certaine d’exister vraiment. Il m’arrivait parfois de douter de ma présence dans le monde, de douter même de ma réalité physique. Peut-être qu’après tout j’étais un ange comme mon frère, celui qui était mort quelques années avant ma naissance mais qui n’avait jamais cessé de planer dans la maison comme s’il n’avait jamais disparu. Peut-être que j’étais morte, moi aussi, et que j’étais devenue un pur esprit sans le savoir, une sorte de fluide intangible que l’on appelle quand on en a besoin et qu’on laisse errer le reste du temps. Sinon, comment expliquer que ma présence dans un lieu puisse passer si souvent inaperçue ?
Au commencement était le froid, Boréal, p. 27.Ma mère est là, étendue sur son lit, pâle comme le satin des tombes. Son corps, momifié sous les couvertures, ne tremble même pas. Ses yeux, parfaitement immobiles, sont fermés aussi dur que ceux des morts. Paralysée dans l’embrasure de la porte, je n’ose m’approcher d’elle.
De loin, je la contemple et la peur monte en moi, aussi froide que le vide qu’elle a voulu créer autour d’elle. Je capte le silence, l’immobilité des choses, l’épaisseur de l’air, le mince filet de lumière de sa lampe de chevet qui dirige son rayon indécent sur la peau de son visage et en fixe la blancheur.
Au commencement était le froid, Boréal, p. 61.Quand je suis rentrée de l’école, il n’y avait personne à la maison. Comme hier et comme avant-hier et comme le jour précédent. Lorsque je dis personne, cela veut dire ma mère, bien entendu. De qui d’autre voudriez-vous que je vous parle ? Après elle, il n’y a rien dans ma vie qui vaille la peine d’être mentionné. Elle devrait bien le savoir.
Pourtant, aujourd’hui elle m’avait juré qu’elle serait déjà là au moment où j’arriverais. Elle m’avait même promis une surprise si je réussissais à améliorer mes résultais en français. Et j’ai réussi. Pour elle, j’ai accordé tous mes participes passés et je n’ai pas oublié un seul « s » au pluriel. J’ai soigné mon écriture et ma signature était presque aussi belle que la sienne.
La mémoire à deux faces, Boréal, p. 53.C’était un matin de septembre, un premier jour de classe. Quelle année ? Comme si cela pouvait avoir de l’importance. Tous les premiers jours de classe de tous les mois de septembre se ressemblent dans les écoles de filles. C’était donc un premier matin de n’importe quelle année, aux odeurs de cire forte, de Spic and Span et d’eau bénite rafraîchie pour la circonstance. Pas une seule trace, encore, laissée par les plumes qui crachent, les doigts collés de mélasse ou les genoux qui saignent. Rien qu’un garde-à-vous uniforme d’obéissance et de peur. Pour éviter le purgatoire.
La mémoire à deux faces, Boréal, p. 65.