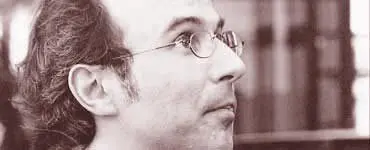Depuis qu’il a troqué la carrière de juriste pour celle de romancier, Philippe Besson est passé d’un livre à l’autre comme à travers des vases communicants, dans ce qu’il décrit lui-même comme un seul mouvement d’écriture.
Si le succès ne s’est pas fait attendre, l’homme ne s’est pas laissé distraire d’un patient affinage de son style, dans des récits qui exploitent tous la richesse d’une rencontre singulière et la nouvelle réalité qui en résulte. Qu’il s’agisse de la rencontre troublante d’un jeune adulte avec Marcel Proust, ou de celle d’un homme et de son frère mourant, la relation humaine est toujours le prétexte d’une transformation, d’un nouvel éclairage sur la personne. Comme dans certains films policiers où se succèdent les perspectives sur un même événement, les romans de Philippe Besson semblent tous déployer une même enquête sur la liaison des êtres, par-delà la variété de lieux et d’époques qu’on y retrouve. Relativement discret, d’une intelligence preste et affûtée, l’écrivain se livrait à Nuit blanche lors du plus récent Salon du livre de Québec, quelques mois avant la parution des Jours fragiles, son cinquième roman en autant d’années.
Nuit blanche : Vous avez un rythme de publication très soutenu depuis votre premier roman. Comment cela s’est-il enclenché ?
Philippe Besson : C’est un enchaînement qui a commencé à se produire ces dernières années, puisque j’ai commencé à écrire en 1999. Par contre je m’étais déjà familiarisé avec les mots à travers les très nombreuses lettres que j’ai écrites dès l’âge de dix-sept ans. J’en écrivais une à deux par jour, dont une par jour à la même personne pendant plus de dix ans. Puis un jour il s’est produit plusieurs incidents, dont la séparation d’avec la personne avec qui je vivais, ce qui a rendu disponible une grande quantité de temps et d’énergie. J’ai alors eu le désir, contrairement à ce qui se passe dans la correspondance, d’écrire à la fois à quelqu’un et à personne en particulier, ce qui m’a mené vers la fiction, en l’occurrence l’écriture d’En l’absence des hommes, dont je ne savais pas trop s’il allait devenir un livre. Il y avait là une innocence et un jeu que je ne pourrai jamais retrouver.
Bien vite, après que trois éditeurs se furent montrés intéressés (j’ai choisi le moins connu des trois) et voyant un autre livre se profiler en moi, je me suis rendu compte que j’étais entré dans « cela », l’écriture, et que je ne pouvais pas faire autrement que continuer. J’ai eu l’impression, dans une grande jubilation, d’entrer profondément dans ce que j’avais envie de faire. J’ai alors, il y a deux ans, complètement arrêté de travailler – ce qui peut être dangereux, mais depuis, les ventes de mes livres m’ont permis de vivre tout à fait à l’aise. On verra bien où ça me mènera !
Vous arrive-t-il d’être à nouveau tenté par le Droit ou par l’enseignement ?
P. B. : J’ai été heureux quand j’étais enseignant. Je ne renie rien de ma vie d’avant. Ce qui a été plus difficile, c’est que mes élèves avaient toujours vingt ans et que moi j’avais toujours un an de plus qu’avant. Mais il n’y a pas de trace de ma vie ancienne dans mes livres, pas plus d’ailleurs que de ma vie actuelle. Je me décris comme un romancier, c’est-à-dire quelqu’un qui invente des histoires. Donc je ne raconte pas ma vie dans mes livres – même si on écrit forcément à partir de sa propre intimité, de sa névrose, de ses souvenirs, tout ça. D’ailleurs c’est très ennuyant ma vie, ça ne mériterait pas qu’on en fasse des livres. Mais quand j’écris Un garçon en Italie, j’adorerais être Luca, j’adorerais être Anna, ou Léo. Je suis très énervé de ne pas être eux.
On retrouve tout de même trace du pédagogue çà et là dans vos romans, par exemple En l’absence des hommes qu’on pourrait considérer comme un roman d’apprentissage.
P. B. : Je suis d’accord pour dire que c’est une sorte d’éducation sentimentale que le personnage de Marcel Proust exerce à l’endroit du jeune Vincent. Je ne me reconnais pas pour autant dans un ou l’autre de ces deux personnages. Ce que je fais dire à Proust à propos de l’écriture n’est pas ma propre pensée, du moins pas entièrement. Contrairement à lui, qui exige qu’on se consacre en permanence à l’écriture, je suis un type très paresseux, je dors, j’ai une vie sociale ailleurs que dans les livres. Mais ça fait partie du vrai plaisir du romancier que de brouiller les pistes, si bien que j’ai été très amusé, après la publication de Mon frère, que des gens m’offrent leurs condoléances pour la mort de mon frère !
Aujourd’hui, vous reconnaissez-vous autant dans En l’absence des hommes que dans Un garçon en Italie ?
P. B. : Oui et non. Chose certaine, je n’écrirais pas En l’absence des hommes aujourd’hui, d’abord parce que je ne suis plus la même personne, puis parce que j’ai perdu l’état d’innocence que j’avais alors. En le relisant, je le trouve un peu précieux, bourré de clichés, mais en même temps je l’assume complètement, je suis content qu’il existe et je ne le renie pas. Je crois que les livres sont des moments, et à ce moment-là, le livre que j’avais à écrire c’était celui-là. Idem pour les suivants. On continue son chemin, voilà tout. J’espère seulement que mon écriture a gagné en simplicité.
Dans l’ensemble de vos romans, on remarque un travail sur les voix, les jeux de perspectives S’agit-il de variations conscientes ?
P. B. : Je suis de ceux qui croient qu’il y a beaucoup moins de stratégie qu’on ne le pense dans les livres. On ne peut pas soupçonner la part de ce qui nous échappe. On fait les choses, et ce n’est qu’après coup qu’on sait si on a bien fait. Je vois bien ce travail sur les voix qui traverse tous mes livres, mais j’en suis encore à me demander pourquoi c’est si présent.
Vous êtes tout de même attentif à ne pas répéter les mêmes configurations.
P. B. : Je ne veux surtout pas réécrire le même livre. Chaque fois j’essaie de trouver un dispositif narratif et un lieu différents, malgré les thèmes récurrents. Par exemple, je me suis obligé à ne pas écrire de lettres dans un roman parce que je l’avais déjà fait, tout comme je me suis interdit un autre dispositif à trois voix comme celui d’Un garçon en Italie. Pour autant, il y a encore des choses qui se répondent et qui reviennent.
La mort et l’écriture sont dans un rapport constant chez vous. Je pense notamment aux épigraphes de vos quatre premiers romans, qui contiennent toutes une mention de la mort.
P. B. : La mort est présente partout dans mes livres, et c’est encore pire dans le cinquième. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je n’en ai pas très peur pourtant. C’est, faut-il dire, un thème très romanesque, car la mort modifie tous les liens que les gens entretiennent entre eux. C’est aussi, au moins pour la moitié de mes livres, une façon pour moi de parler du corps.
Vous vous êtes montré très satisfait de l’adaptation filmique de Son frère par Patrice Chéreau, à qui vous avez ensuite dédié L’arrière-saison. En quoi situez-vous sa fidélité au livre ?
P. B. : À plusieurs niveaux. D’abord parce que j’ai senti, en l’interrogeant, qu’il allait faire ce film pour les mêmes raisons qui m’avaient conduit à faire le livre. Ensuite il a filmé au plus près des corps, du corps supplicié, alors que la maladie n’est qu’un prétexte au rapprochement. En même temps c’est un authentique film de Chéreau, on ne dirait pas du tout qu’il s’agit d’une adaptation. C’est un film dur, sans pathos, sans indulgence, de compassion. Un film qu’il faut regarder les yeux secs.
La notoriété vous est arrivée très vite, avec les obligations que l’on sait. Comment vivez-vous cette représentation publique en tant qu’écrivain ?
P. B. : Ça ne change rien à mon rapport à l’écriture, car une de ses vérités absolues est la solitude. On est absolument seul dans l’écriture, dans ce qui est presque une forme de sauvagerie, qui exclut tous les autres. Le reste ne peut atteindre cette sphère. C’est difficile pour ceux qui m’entourent parfois. Mais les livres sont toujours plus intéressants que ceux qui les écrivent.
Philippe Besson a publié :
En l’absence des hommes, Julliard, 2000 ; Son frère, Julliard, 2001 ; L’arrière-saison, Julliard, 2002 ; Un garçon en Italie, Julliard, 2003 ; Les jours fragiles, Julliard, 2004.
EXTRAITS
Il n’y aura pas d’autre issue que la mort. Cette révélation presque tranquille me glace le sang. Oui, il y a cela, très distinctement, tout à coup : je sais que nous allons perdre Thomas, qu’il surviendra ça, la perte de Thomas, que nous ne l’empêcherons pas, que nous serons dans l’impossibilité de l’empêcher. Ils auront beau affirmer que les chances de survivre l’emportent sur celles de succomber, ils auront beau avoir, au moins au début, la raison et les probabilités de leur côté, ils n’empêcheront pas la mort de se produire. Nous savons ce qu’ils ne savent pas, nous avons cette intuition fabuleuse, un désespoir intégral, très pur.
Son frère, p. 47-48.
Et, subitement, ça lui revient. Il se rend compte à cette occasion qu’il n’a sans doute conservé d’elle que ses bons côtés, et qu’il a effacé, inconsciemment ou non, les autres. Il a fait d’elle un être idéal, dénué de défauts, de déficiences, de difformités. Au fond, avec le temps, les images d’hier sont devenues imprécises, simplificatrices. Ce qui surnage, c’est le bonheur des années passées ensemble et l’apparence d’un être presque irréprochable. Du reste, à ceux qui l’interrogent encore sur sa vie d’avant avec elle, il raconte une histoire embellie, qui n’a plus grand-chose à voir avec la vérité. Louise vient de ramener Stephen dans le réel.
L’arrière-saison, p. 89.
On s’y laisse forcément prendre, à cet air angélique, à ces manières de Christ, à cette négligence dans la posture, à ces yeux qui fouillent au-dedans de nous alors qu’ils paraissent à peine nous regarder. Oui, on a envie de le prendre entre nos mains, ce visage d’enfant de chœur à qui on ne donnerait pourtant aucun bon Dieu sans confession, à ce sourire qui creuse des fossettes et qui ramène à l’adolescence, à ce que nous avons perdu.
Et, tout aussitôt, nous n’avons plus été seulement dans l’évidence : nous avons été dans l’urgence. C’est ça : le sentiment d’une urgence a surgi, s’est imposé.
Comme si nous devions, sans délai, rattraper le temps perdu, comme s’il nous fallait tenter de reconquérir les années passées sans l’autre, comme si nous étions tenus d’abolir les distances que le hasard avait, jusqu’à cet instant, placées entre nous deux.
Un garçon en Italie, p. 98-99.