Elle s’est fait connaître avec des romans inspirés de ses années de réclusion volontaire dans les bois. Dans son plus récent roman, Hexa, elle transpose son écomilitantisme dans un récit de science-fiction1.
Patrick Bergeron : Vos débuts d’écrivaine remontent à 2018 avec le roman Encabanée, bientôt suivi de Sauvagines en 2019 et de Bivouac en 2021. Les trois œuvres forment un ensemble. Prévoyez-vous donner un titre à cette trilogie ?
Gabrielle Filteau-Chiba : On avait pensé l’appeler « Trilogie de Kamouraska », parce que c’est le nom de la rivière au bord de la cabane. Mais pour des raisons commerciales, l’éditeur préférait que ce soit plutôt flou, pour qu’on puisse prendre le triptyque par le début, la fin ou le milieu et que chaque œuvre se tienne.
P. B. : Le deuxième volet, Sauvagines, a remporté plus de succès que les deux autres. Vous avez déjà dit que c’était grâce à votre chienne Sequoia, qui a été votre source d’inspiration. Est-ce qu’à vos yeux également ce deuxième roman se distingue des deux autres ?
G. F.-C. : Oui, je pense que Sauvagines est mon plus réussi. Peut-être pour une question d’émotion féminine : la colère des femmes est rarement exprimée dans les arts. On l’associe à une forme d’hystérie ou de folie. On a peur d’aller dans cette zone, qui est pourtant très puissante une fois canalisée.
P. B. : Vos romans ont été traduits dans plusieurs langues. Vos lecteurs s’intéressent-ils aux mêmes aspects de vos œuvres, peu importe qu’ils vivent au Québec, en France, en Italie ou en Allemagne ?
G. F.-C. : C’est très similaire. Il est surprenant de voir, d’une culture à une autre, à quel point les enjeux de protection de l’environnement sont à l’avant-plan des préoccupations de la jeune génération, qui a très peur pour son avenir. J’ai l’impression que mes livres lui donnent de l’espoir, lui fournissent des idées pour se rallier autour d’une cause concrète, se mettre en action, faire communauté.
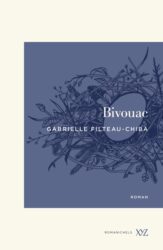 P. B. : Votre trilogie s’inspire d’une expérience à la Walden de Henry David Thoreau, celle d’une vie solitaire et rustique dans les bois. Vous avez habité pendant huit ans dans la forêt du Haut-Kamouraska. L’expérience est terminée. Vous vivez maintenant dans les Cantons-de-l’Est. Mais une telle expérience peut-elle réellement prendre fin ? Les ouvrages que vous avez publiés après Bivouac portent encore la trace de votre ermitage forestier. Avez-vous l’impression d’être tout à fait sortie du bois ou bien une partie de vous est-elle restée « encabanée » ?
P. B. : Votre trilogie s’inspire d’une expérience à la Walden de Henry David Thoreau, celle d’une vie solitaire et rustique dans les bois. Vous avez habité pendant huit ans dans la forêt du Haut-Kamouraska. L’expérience est terminée. Vous vivez maintenant dans les Cantons-de-l’Est. Mais une telle expérience peut-elle réellement prendre fin ? Les ouvrages que vous avez publiés après Bivouac portent encore la trace de votre ermitage forestier. Avez-vous l’impression d’être tout à fait sortie du bois ou bien une partie de vous est-elle restée « encabanée » ?
G. F.-C. : Je suis encore dans ma cabane. En fait, c’est très reposant d’imaginer cela. J’ai trouvé mon rythme dans cette forêt : un culte de la lenteur dans toute chose. L’importance du sommeil, du silence… Ma philosophie de vie s’est forgée au contact des éléments, des saisons et de cette grande solitude.
P. B. : Jusqu’à quel point l’apprentissage des arts de la survie a-t-il été rude pour vous ?
G. F.-C. : C’était rude. En apprenant à fendre le bois, j’étais terrifiée à l’idée de me planter la hache dans le tibia ou dans le pied presque à chaque coup, jusqu’à ce que cela devienne une technique maîtrisée et même une source de fierté. Pareil pour les plantes médicinales. J’avais suivi, pendant deux ans, des cours d’herboristerie en ligne. J’avais fait des récoltes, de la transformation. J’avais envie de faire mes propres repas avec des plantes qui poussent en haute forêt. Mais j’avais lu Into the Wild de Jon Krakauer. On connaît la fin tragique de Supertramp, qui s’est empoisonné avec des graines de patates sauvages qui ne sont toxiques que dans une période bien précise de l’année. J’étais consciente que j’avais déjà acquis des connaissances avant de partir m’installer dans la cabane, mais je n’étais pas à l’abri de m’empoisonner ou de m’entailler les pieds. Cela a été dur mais, en même temps, cela a été hyper-révélateur parce que je me rendais compte que j’étais beaucoup plus forte physiquement que je ne le pensais, que finalement toutes les peurs qui m’habitaient s’en allaient tranquillement et cela me donnait vraiment confiance en moi.
P. B. : Des ermites aux anachorètes, de Robinson Crusoé à Sylvain Tesson, en passant par Jon Krakauer que vous venez d’évoquer, c’est surtout aux hommes que l’on associe la solitude. Avez-vous identifié des contre-exemples féminins, des « louves solitaires », comme vous le dites dans La forêt barbelée?
G. F.-C. : Oui, il y a Anne LaBastille, une biologiste qui a longtemps habité dans les Adirondacks. Elle a écrit Woodswoman2. J’avais trouvé son livre dans une librairie d’occasion. Elle raconte comment elle a fait pour construire son camp en bois rond. Elle aussi, elle avait une chienne, un berger allemand. Au début, elle était guide de randonnée dans le secteur. Puis, elle s’est mise à écrire des articles à la Thoreau sur la nature, sur l’observation de la faune et de la flore, qu’elle envoyait par la poste. Elle s’était bâti une vie comme ça, autonome. J’avais beaucoup d’admiration pour elle. Dans son livre, il y a des photos de ses randonnées mais aussi des croquis de la construction de sa cabane. C’est un des seuls contre-exemples féminins que j’ai trouvés. Par contre, LaBastille ne parle pas beaucoup de ce qui se passe sur le plan personnel. Cela m’intriguait de savoir comment elle se sentait, comment elle gérait la peur. Les femmes en société, nous sommes censées être protégées par plusieurs hommes : notre père, nos frères, nos amis, notre chum. C’est comme un cocon, même si c’est rarement le cas car il y a beaucoup de violence. La femme se sent instinctivement en danger quand elle est seule.
 P. B. : Vous avez beaucoup lu durant vos années d’ermitage. Quelles ont été les œuvres les plus significatives pour vous ?
P. B. : Vous avez beaucoup lu durant vos années d’ermitage. Quelles ont été les œuvres les plus significatives pour vous ?
G. F.-C. : Ma plus grande influence a été Walden. Thoreau m’a donné envie de rester parce que je savais qu’il était resté deux ans, deux mois, deux jours. C’est sûr qu’il faisait des petits trajets au village, ici et là. Mais c’est une espèce de défi que je me donnais, de résister aussi longtemps qu’un homme. Il y avait aussi les œuvres de Louis Hamelin. J’ai lu La rage et La constellation du Lynx. Comme ce sont de bonnes briques, elles m’ont aidée à traverser plusieurs nuits tout en alimentant mon questionnement politique car, même si j’ai été dans de bonnes écoles, on ne m’avait jamais parlé de la crise d’Octobre. C’est comme un mensonge par omission. Cela a excité ma fibre souverainiste ! J’ai aussi lu Anne LaBastille, beaucoup de poésie et les livres d’Anne Hébert. C’est sûr que Kamouraska est à la base de mon choix du lieu. J’ai relu ses poèmes, Les fous de Bassan aussi. L’œuvre d’Anne Hébert m’interpelle beaucoup.
P. B. : Paru à l’automne 2023, Hexa est votre quatrième roman, mais votre sixième ouvrage. Après Bivouac, vous avez publié en 2022 un volume de poésie, La forêt barbelée, et une nouvelle, Sitka. Il ne vous reste plus qu’à écrire des essais et du théâtre pour avoir tâté de tous les genres littéraires traditionnels. Vous y pensez ?
G. F.-C. : Absolument ! J’aime me réinventer, me mettre en danger. Je suis une autodidacte. Même le roman était quelque chose de nouveau pour moi. J’ai peur de reprendre la même recette qui a été gagnante. J’ai envie d’explorer.
P. B. : Hexa se déroule dans un avenir rapproché où les gens vivent encagés dans des villes, alors que la nature, au-delà des murs, a été dévitalisée, ravagée par de grands feux de forêt. Quelle relation entreteniez-vous avec la science-fiction avant d’en écrire ?
G. F.-C. : J’étais une grande lectrice de dystopies. Dans l’adolescence, mon père m’avait remis 1984 de George Orwell. J’ai lu Brave New World d’Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. J’ai aussi lu Margaret Atwood. Cet univers me plaît. J’aime qu’on puisse se projeter dans un futur proche et effrayant parce que terriblement réel. C’est tout à fait possible qu’on dérape à ce point. On est près d’un gouffre. Je trouve que la science-fiction est utile. Elle est une forme de littérature engagée. Je la vois comme le prolongement de mon travail, qui était plutôt documentaire au début, très campé dans le réel, avec la question du pipeline d’Énergie Est. Dans Hexa, ce sont les feux de forêt.
P. B. : Hexa se passe au Québec dans les années 2090. Votre intrigue se déroule surtout dans la ville murée de Sainte-Foy et au nord du 51eparallèle. Votre éditeur français vous a demandé de dessiner une carte. À quoi va-t-elle ressembler ?
G. F.-C. : J’adore dessiner des cartes parce que cela me ramène à Thoreau qui dessine son lac, qui le sonde. Les lecteurs français aussi ont besoin d’être situés. Je pense que je vais dessiner un Québec plutôt maritime pour pouvoir illustrer le voyage en bateau entre l’anse au Foulon et Baie des Oies. Il va y avoir le fleuve Saint-Laurent. Puis, bien sûr, je vais situer les monts Uapishka.
P. B. : Hexa se concentre sur un trio de protagonistes : une adolescente, Thalie Rousseau, et ses deux parents, Sandrine et Gabriel. Les autres personnages sont des femmes travaillant au reboisement des brûlis dans le Grand Nord ou des citoyens qui décident de s’enfuir de Sainte-Foy. Il y a aussi Hexa, le personnage éponyme, qui n’est présente que dans de brèves séquences en italique. Alors qu’un régime oppresseur est en place, on ne trouve aucun représentant de l’autorité, aucun personnage antagoniste dans votre histoire, ou à peine. Parlez-nous de ce choix de vous concentrer sur des figures positives.
 G. F.-C. : Très bien vu. C’est drôle, mais cela me fait penser à ce que j’avais fait dans Sauvagines, dans le sens où je n’avais pas donné la parole au braconnier. Je ne lui permettais pas d’exprimer son point de vue. Dans Hexa, c’est comme si l’ennemi était invisible. Je préférais donner la parole à tous ceux qui trouvent des façons d’être libres dans cette oppression. J’ai l’impression que mes personnages forment un ensemble de poupées gigognes où Hexa est la première poupée, l’archétype de la sorcière. Puis on a Sandrine, l’archétype de la mère. Ensuite, on a Thalie, la fille. Elles sont toutes liées d’une manière. C’est important pour moi, dans la vie, de mettre l’accent sur ce qui est positif. Voir le verre d’eau à moitié plein, même si c’est de glace !
G. F.-C. : Très bien vu. C’est drôle, mais cela me fait penser à ce que j’avais fait dans Sauvagines, dans le sens où je n’avais pas donné la parole au braconnier. Je ne lui permettais pas d’exprimer son point de vue. Dans Hexa, c’est comme si l’ennemi était invisible. Je préférais donner la parole à tous ceux qui trouvent des façons d’être libres dans cette oppression. J’ai l’impression que mes personnages forment un ensemble de poupées gigognes où Hexa est la première poupée, l’archétype de la sorcière. Puis on a Sandrine, l’archétype de la mère. Ensuite, on a Thalie, la fille. Elles sont toutes liées d’une manière. C’est important pour moi, dans la vie, de mettre l’accent sur ce qui est positif. Voir le verre d’eau à moitié plein, même si c’est de glace !
P. B. : Dans votre histoire, les livres ont pratiquement disparu (ils ont été remplacés par des tablettes numériques) et l’acte de lecture est mal perçu parce qu’il incite à la rébellion. C’est pourquoi les livres, découverts dans la clandestinité, jouent un grand rôle dans le développement de Thalie. Une écrivaine la marque particulièrement : Simone de Beauvoir. Est-ce que l’autrice du Deuxième sexe a eu le même impact sur vous ?
G. F.-C. : Oui. J’avais envie de nommer Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, ces femmes qui ont écrit, qui ont réussi à en faire un métier de leur vivant. C’est plutôt rare comme exemple. Puis, je trouve intéressant le concept du livre en tant qu’objet subversif, parce qu’on vit à une époque où le numérique prend tellement de place que cela produit une censure, un contrôle des mots qu’on utilise, un changement radical du langage. Les livres permettent de contrer ce phénomène.
P. B. : Hexa est d’abord narré au je, puis au tu et enfin au il, ce qui vous permet de rapporter successivement les points de vue de Thalie, de Sandrine et de Gabriel. Comment l’idée de cette triade de narrateurs vous est-elle venue ?
G. F.-C. : En suivant une classe de maître avec Margaret Atwood. Elle racontait un blocage qu’elle avait eu avec un de ses manuscrits. Elle disait : « Parfois, on a la bonne histoire, mais on n’a pas le bon narrateur, on n’a pas le bon point de vue. Il faut alors tout recommencer. Il ne faut pas avoir peur de réécrire le livre au complet ». Hexa, je dois l’avoir réécrit six ou sept fois avant de trouver les voix qui allaient porter l’histoire. Au début, c’était je et c’était moi, le je. Dans un premier temps, je l’ai transformé du récit documentaire au récit autofictionnel. Ensuite, c’est devenu quelque chose qui était plutôt dans le futur. Après, j’ai trouvé mes personnages. L’effet que je recherchais était de passer du sol à quelque chose de plus aérien. Le je est très proche de l’enfance, le tu est la mère, la troisième personne est plutôt la posture du protecteur. Un peu comme les arbres qui poussent, on s’éloigne de l’humain, puis on monte, on monte.
P. B. : À la fin d’Hexa, l’histoire n’est visiblement pas terminée. Envisagez-vous un nouveau cycle de romans, une nouvelle trilogie ? Avez-vous une idée précise de ce qui suivra ?
G. F.-C. : Je n’ai pas d’idée précise, mais c’est important pour moi que les fins soient ouvertes. Cela permet aux lecteurs de rêver. Je me laisse une porte ouverte si j’ai envie un jour de continuer l’aventure. Mais c’est surtout l’idée de terminer avec l’espoir et l’ouverture.
1. Entretien mené à Fredericton, le 23 février 2024, avec des fonds provenant du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Centre de la francophonie des Amériques, de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Université Saint-Thomas. La transcription a été assurée par Mega Satish.
2. Les ouvrages d’Anne LaBastille (1933-2011), en particulier les quatre volumes de la série Woodswoman, demeurent à ce jour inédits en français.











