En mars 2018, Serge Patrice Thibodeau1 se rend à Québec dans le cadre d’une résidence d’écriture. C’est là, à l’intérieur des fortifications de la capitale, qu’il rencontre Émilie Turmel2 pour la première fois. Celle-ci est alors adjointe à la programmation de la Maison de la littérature et du festival Québec en toutes lettres.
À l’époque, il ignore que la jeune femme jouera un rôle déterminant dans le plan de succession de Perce-Neige en le remplaçant, cinq ans plus tard, à la direction littéraire.
J’ai rencontré les deux principaux intéressés au début de l’année 2023. Autour de la table qui nous réunissait dans les bureaux de l’éditeur de Moncton, j’ai préféré ne pas insister sur les nombreux événements personnels ou professionnels qui ont mené vers cette transition, vers ce changement de garde. J’ai plutôt invité mes interlocuteurs à discuter de divers enjeux et de différentes préoccupations qui concernent le métier d’éditeur.
Louis-Martin Savard : Serge Patrice, à la lumière de ton expérience comme directeur littéraire, quel conseil essentiel aurais-tu envie de donner à Émilie pour lui faciliter la tâche dans l’exercice de ses nouvelles fonctions ?
Serge Patrice Thibodeau : Juste un ? [Rires] J’aurais aimé simplement lui dire : apprendre à dire non. Mais, en fait, c’est plus compliqué que ça. Je lui répondrai donc : apprendre à se faire confiance. Comme directeur littéraire, il y a beaucoup de moments de doute autour de décisions importantes. Il faut apprendre à s’écouter. Aussi, la direction littéraire est en quelque sorte l’image publique de la maison d’édition. Émilie va devenir « madame Perce-Neige », comme moi, depuis dix-huit ans, je suis « monsieur Perce-Neige ». Et dans un petit milieu, cela peut parfois être lourd à porter. On doit en être conscient et apprendre à s’y habituer.
L.-M. S. : Émilie, si tu n’avais qu’une seule question à poser à Serge Patrice sur le défi qui t’attend, quelle serait-elle ?
Émilie Turmel : On a l’impression que le travail d’un éditeur est de développer des écrivains, d’accompagner l’écriture, mais j’ai de plus en plus l’impression que son travail est également de développer des lecteurs et des habitudes de lecture. Je me demande ce que tu penses de ce défi.
S. P. T. : Je dirais oui, apprendre à développer un lectorat, ou apprendre à l’élargir, si tu préfères. Plus encore, je considère qu’il faut avoir un respect absolu du public, un respect de sa réaction face à un texte. Il m’est déjà arrivé de refuser un manuscrit et, après avoir vu et entendu la personne lire dans une soirée de poésie, après avoir constaté la réaction positive des gens dans la salle, de changer d’idée, de me dire que je m’étais trompé, de m’avouer que j’avais fait une gaffe. C’est important d’être sur le terrain et d’observer la réaction du public. Par exemple, j’ai assisté à une prestation de Mo Bolduc sur scène ; je lui ai écrit à une heure du matin pour lui demander de m’envoyer ses textes.
É. T. : Quel est ton point de vue quant au développement d’une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices ? Et parallèlement, comment peut-on favoriser le « côté familial » d’une maison d’édition ? Après tout, dans « maison d’édition », il y a « maison ».

S. P. T. : Honnêtement, les dix premières années ont été difficiles pour moi. Pour les jeunes, j’étais intimidant en raison de ma notoriété et de mes prix. Mais les choses ont changé quand j’ai publié Gabriel [Robichaud]. Il n’avait que 21 ans et il avait un grand réseau. Gabriel a beaucoup encouragé ses amis à soumettre des manuscrits. C’est comme ça que j’ai commencé à apprivoiser la nouvelle génération. Toi [Émilie], tu es encore jeune, mais tu devras peut-être un jour faire appel à quelqu’un de la génération qui te suit. Et pour répondre à ta question concernant l’esprit familial, je dirai ceci : mes poètes, ils s’aiment, et j’aime qu’on soit nombreux dans les salons du livre ou au Festival de poésie de Caraquet, par exemple. Je débloque toujours des fonds pour ces événements. C’est là, lors de ces événements, que se forme un esprit de collégialité.
L.-M. S. : D’après vous, où commence et où se termine l’emprise d’une direction littéraire sur les œuvres qu’elle choisit de publier ?
É. T. : Il y a deux éléments qui m’accrochent dans ton énoncé. D’abord, le mot emprise, un mot un peu fort. Aussi, la locution direction littéraire, que je n’applique pas uniquement à la relation avec l’auteur. Pour moi, la direction littéraire comprend la publicité, le choix des couvertures, le travail avec tous les gens qui sont dans la ligne de production. Dans le cas du travail avec l’auteur ou avec l’autrice, le mot à retenir, c’est vraiment accompagnement. Je ne me considère pas au-dessus des personnes avec qui je travaille ; je suis à côté, en train de cheminer avec elles. Du moment où on accepte un manuscrit, c’est parce qu’il est bon et qu’on est prêt à le publier presque tel quel. Évidemment, on fait des suggestions et l’auteur doit réfléchir à tout ce qu’on lui propose, mais il n’est pas tenu d’acquiescer à toutes nos demandes. Nous, on lui permet d’être conscient des choix esthétiques qu’il privilégie et d’être mieux outillé pour les défendre. D’abord et avant tout, ça demeure un travail de collaboration et de bienveillance. Le but est de publier le meilleur livre possible. Aussi, il arrive que les questions que je pose permettent à un auteur de trouver lui-même des solutions. Il n’y a donc pas vraiment une emprise qui est exercée.
S. P. T. : Je dirais également qu’il y a une responsabilité. Les Éditions Perce-Neige ont une mission et un mandat. Tout passe par là. Il importe de penser à Perce-Neige avant de penser à ses goûts personnels.
L.-M.S. : Votre travail d’accompagnement littéraire influence-t-il votre propre pratique de l’écriture ?
É. T. : Comme on vient de le souligner, on est là pour conseiller et pour questionner. On ne peut évidemment pas commencer à imprimer notre propre style à tout le catalogue. Cela dit, Serge Patrice et moi aimons beaucoup travailler avec la contrainte. Et je dirais que la contrainte ultime est peut-être de travailler avec le texte d’un autre et de le laisser être autre. Personnellement, ma poésie n’a rien à voir avec l’oralité, mais on édite plusieurs livres qui s’inscrivent dans une dimension plus orale du français. Et j’aime ça, parce que ça m’amène à faire une gymnastique intellectuelle qui m’éloigne de ma propre pratique.
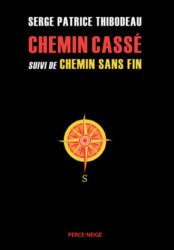
S. P. T. : Comme Émilie, j’ai l’habitude de m’imposer des contraintes lorsque j’écris. Je suis formaliste et structuraliste de formation. Donc, jusqu’où dois-je aller avec la déconstruction dans les conseils que je donne ? Émilie parlait d’oralité ; je ne peux pas non plus tout déconstruire d’un texte qui sera produit sur scène. Moi, j’ai publié des livres que j’aime peu. Mais certains d’entre eux sont devenus de gros succès. Aussi, je l’ai remarqué au fil des ans, et je pense que c’est un peu ce qui m’a bloqué ces dernières années : l’oralité, et tout ce qui se passe sur scène en poésie, a mis un frein à ma propre création, parce que moi, je n’ai pas envie de faire ça. Mais c’est ça qui marche ! J’avoue que ça m’embête. Je me demande : « Qu’est-ce que je vais écrire maintenant ? » Est-ce que je continue à déconstruire jusqu’à l’os, alors que je sais que ça ne fonctionne pas dans une soirée de lectures ? Également, il peut être difficile d’être un créateur et de ne pas se laisser intimider par les projets des autres. Parce que ça peut l’être !
É. T. : Personnellement, comme poète, je suis très rigoureuse sur le plan de la polysémie. Je travaille et retravaille un vers souvent pour qu’il soit accompagné de deux autres vers qui vont en modifier le sens, de sorte que le poème deviendra très pluriel. Mais ce ne sont pas toutes les poésies qui fonctionnent ainsi. Parfois, un texte peut avoir un seul sens, plutôt littéral, et il faut savoir se rendre compte que ça peut être suffisant, que ça marche et que les gens seront touchés quand même. Moi, ça m’a amenée à être en paix avec moi-même et à me dire : « Écoute, si ce poème-là n’a pas quinze sens, ce n’est pas grave. [Rires] Laisse-le tel quel ». Et ce qui a pu me bloquer, c’est que généralement, je travaille un poème jusqu’à tant que je sois satisfaite à cent pour cent mais, pendant ce temps-là, je ne continue pas à écrire mon recueil. Alors, de plus en plus, je me dis : « Écris, ce n’est pas grave si ce n’est pas parfait du premier coup ». Plus j’édite d’autrices et d’auteurs, plus je vois qu’effectivement, c’est rarement parfait du premier coup. Si eux sont capables d’une aussi grande vulnérabilité envers moi comme éditrice, je devrais, moi aussi, être capable d’une plus grande vulnérabilité devant ma propre éditrice. Tout ça m’amène à être plus bienveillante envers moi-même aussi. Vu que je le suis envers les autres, je m’accorde le droit de me tromper. Ajoutons que d’avoir vécu cette expérience, c’est-à-dire déposer un manuscrit et se sentir vulnérable, me rend plus empathique.
S. P. T. : Tout à fait ! Et c’est la raison pour laquelle la direction littéraire doit être occupée par un ou une poète. Ça, c’est essentiel ! Quand j’ai commencé mon plan de succession et que je l’ai présenté au conseil d’administration, j’ai vraiment insisté sur ce point.
L.-M. S. : Quel est votre rapport à l’objet-livre ?
É. T. : À l’été 2015, j’ai participé à une formation sur le livre-objet et sur le livre d’artiste à l’Université Laval. J’ai une pratique en arts visuels qui est émergente, qui a été longtemps cachée mais qui, de plus en plus, est publique. La matérialité du livre puis sa déconstruction comme objet m’intéressaient énormément. Je suis donc allée apprendre plein de techniques, que ce soit le moulage de papier, la sérigraphie ou la photogravure, et même juste apprendre à utiliser les logiciels de montage.
Aussi, je suis présentement des ateliers de perfectionnement chez Imago, à Moncton, dans le but de marier la sérigraphie et la poésie.
S. P. T. : Tout comme Émilie, je m’intéresse à la matérialité du livre depuis longtemps. Avant de publier des livres, j’avais vingt ans et de voulais être relieur. Cela dit, chez Perce-Neige, la dimension matérielle du livre a toujours occupé une place prépondérante. Pendant longtemps, un de nos mandats était de faire connaître les artistes visuels acadiens en utilisant leurs créations sur la couverture de nos livres. Tout ça a changé, vu la facilité avec laquelle il est maintenant possible de diffuser des œuvres sur Internet, mais à l’époque où j’ai accepté de prendre la direction, cet aspect m’a influencé dans ma prise de décision.
L.-M. S. : Perce-Neige constitue un repère incontournable en ce qui a trait à la culture acadienne. Je suis conscient que la question est délicate, mais le fait que sa direction littéraire passe entre les mains d’une personne d’origine québécoise pourrait-il causer un impact négatif sur la perception que la communauté locale aura de « son » principal éditeur ?
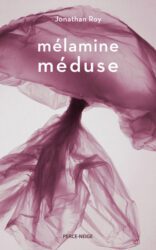
É. T. : À mon avis, ta question pose une question plus large, qui est celle de l’identité acadienne, et je pense qu’il est possible d’être acadien de plusieurs manières. Moi, je n’ai pas les racines. Mon chum est acadien, mon enfant est acadien. Donc, je suis là pour rester. Surtout, je pense qu’on est ce que l’on fait. On est nos actions. Et moi, en ce moment, je m’implique dans ma communauté. Comme citoyenne, comme femme, comme travailleuse culturelle, comme autrice, je m’inscris maintenant dans le projet acadien. Mon passé est québécois, mais mon futur est acadien. C’est certain que je dois être prudente, dans le sens où mes origines ne sont pas acadiennes et que j’ai encore des choses à apprendre au sujet de l’histoire de l’Acadie, de la littérature, des différents parlers. Mais je pense avoir la sensibilité et l’écoute pour le faire. Aussi, j’ai le désir d’apprendre. Il y a malheureusement beaucoup de Québécois qui arrivent en Acadie avec des préjugés, et avec une idée de calquer une manière de faire québécoise. Il faut être prudent. Ici, c’est différent.
S. P. T. : Évidemment, par mon simple patronyme, je suis un Acadien « généalogique ». Cela dit, le Québec fait également partie de mon patrimoine. J’ai étudié au Québec, j’ai vécu au Québec. D’ailleurs, je pense que l’arrivée d’Émilie va offrir un regard frais, un regard à distance de tous les affects typiquement acadiens. Aussi, il faut dire qu’elle prend un train en marche. Quand je suis arrivé, en mars 2005, on m’a demandé quels étaient mes plans. J’ai répondu que je n’étais pas là pour faire la révolution.
É. T. : En effet, il faudrait faire la révolution si c’était une maison qui était dans une mauvaise posture mais, au contraire, c’est une maison qui s’est taillé une bonne réputation avec un bassin d’auteurs et d’autrices incroyables. Tout ce qu’il faut, c’est nourrir l’organisme pour qu’il continue à fleurir.
1. Serge Patrice Thibodeau compte parmi les écrivains majeurs de l’Acadie contemporaine. Auteur de livres de poésie, de récits de voyage et d’essais, il a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix Émile-Nelligan (1992) et le Prix littéraire du Gouverneur général, catégorie Poésie (1996 et 2007).
2. Émilie Turmel a publié deux recueils chez Poètes de brousse, Casse-gueules et Vanités, qui lui ont respectivement valu les prix René-Laynaud et Louise-Labé. La parution de son troisième recueil est prévue à l’automne 2023 chez le même éditeur.











