L’univers sauvage et poétique d’Audrée Wilhelmy est nourri de contes traditionnels et de nordicité. Nous en avons discuté avec l’auteure lors de cet entretien cet entretien1, réalisé dans le cadre de la programmation virtuelle du Festival Frye de Moncton en avril 2020.
Patrick Bergeron : Vous êtes essentiellement une auteure de fiction. Vous avez écrit des romans et des nouvelles. Êtes-vous tentée par d’autres formes littéraires ?
Audrée Wilhelmy : J’ai publié dans Estuaire2 à l’automne dernier un poème plutôt narratif sur la Corriveau. C’était une commande. Je n’aurais jamais pensé envoyer un poème à une revue de poésie. Le thème était la magie, c’était donc très tentant comme sujet ! Ça m’a fait du bien d’écrire ça. Aussi, dans Blanc résine, la voix de Daã tire souvent du côté de la poésie.
P. B. : Blanc résine fait entendre la voix de Daã en alternance avec celle de Laure. Les passages narrés par Daã sont plus poétiques, ils ont un caractère très intérieur.
A. W. : C’est ça, c’est plus lyrique, plus travaillé, comme un poème. La sonorité est beaucoup plus forte, plus importante, la rythmique aussi. La poésie arrive donc progressivement dans ma pratique.
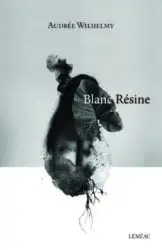 P. B. : Vos romans s’insèrent dans un univers en grande partie inspiré de l’imaginaire des contes. Qu’est-ce qui vous attire dans cette approche ?
P. B. : Vos romans s’insèrent dans un univers en grande partie inspiré de l’imaginaire des contes. Qu’est-ce qui vous attire dans cette approche ?
A. W. : Un univers réaliste est régi par des lois, des systèmes… La question qui m’intéresse, c’est beaucoup celle des tabous. Voir comment les perceptions qu’on a et qui sont construites socialement – sur l’inceste, sur les morts des femmes, sur la violence érotique, etc. – voir, donc, comment les a priori peuvent être renversés. Dans un monde social ou politique, ces codes prendraient le dessus. Ça implique un système narratif qui ne permet pas d’aborder la pulsion elle-même à l’extérieur de toutes ces contraintes. Le conte le permet. Ensuite, il y a une dimension qui s’adresse à l’inconscient du lecteur. Quand on parle d’un loup, d’une sorcière, d’un ogre, le référent est partagé ; il n’a pas besoin d’être expliqué, d’être décrit très longtemps.
P. B. : Le titre de votre premier roman, Oss, publié en 2011, désigne un village fictif. C’est le premier d’une série de toponymes qui s’incorporent à votre géographie imaginaire : Fort-Bouteille, Brume, Seiche, Sitjaq, Kangok, parmi d’autres. Dans quel monde se situent vos histoires ?
A. W. : C’est la temporalité du « il était une fois » qui est probablement le meilleur exemple à donner. Quand on dit « il était une fois », tout le monde sait quand ça se passe, même si ça ne se passe jamais et nulle part. C’est un peu ce que j’essaie de recréer avec ces lieux. Quand je parle d’un phare dans Le corps des bêtes, ce phare peut être littéralement n’importe où. Ce n’est pas important et il peut prendre une apparence très différente d’un lecteur à l’autre. Toute cette nomenclature et cette espèce de flou sur les noms – même les noms des personnages – j’y fais extrêmement attention. Ce sont souvent des noms dont les genres sont inversés : Noé est une femme, Laure est un homme. Il y a des noms qui sont très proches de l’imaginaire. « Daã », par exemple, ne fait référence à rien qu’on puisse connaître directement. Tout ce travail de nomenclature sert justement à générer un monde qui ne sera pas aussi incarné que si je parlais de Montréal en 2020. Le situer n’est donc pas vraiment possible ; c’est au lecteur de le situer où il veut, finalement. C’est sûr qu’une certaine nordicité s’est installée au fil de mes romans. Je me rends compte, depuis que je publie en France, que nous avons une façon de vivre la forêt qui est vraiment très nord-américaine et très québécoise.
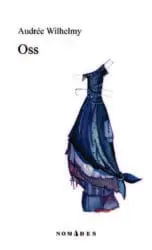 P. B. : C’est dans le roman Oss qu’apparaît pour la première fois Noé, un personnage que l’on va ensuite retrouver dans Le corps des bêtes et dans Blanc résine. Noé est une jeune femme qui parle peu mais qui chante souvent et qui n’oppose pas de résistance, ou très peu, quand elle se fait prendre de force. Pourtant, ce n’est pas une victime que vous avez voulu décrire, puisqu’elle éprouve une certaine jouissance dans la douleur qui lui est infligée. Pourriez-vous nous parler de ce personnage ambigu et de ce qu’il représente pour vous ?
P. B. : C’est dans le roman Oss qu’apparaît pour la première fois Noé, un personnage que l’on va ensuite retrouver dans Le corps des bêtes et dans Blanc résine. Noé est une jeune femme qui parle peu mais qui chante souvent et qui n’oppose pas de résistance, ou très peu, quand elle se fait prendre de force. Pourtant, ce n’est pas une victime que vous avez voulu décrire, puisqu’elle éprouve une certaine jouissance dans la douleur qui lui est infligée. Pourriez-vous nous parler de ce personnage ambigu et de ce qu’il représente pour vous ?
A. W. : Vous l’avez très bien synthétisé au départ : je ne voulais vraiment pas faire un personnage de victime. En fait, aucun de mes personnages féminins n’est une victime, dans aucun de mes livres. Je dirais que c’est probablement l’élément le plus important pour moi.
P. B. : Les épouses de Féléor, dans Les sangs, se font quand même assassiner.
A. W. : Oui, mais encore une fois, elles ne sont pas victimes, elles sont agissantes dans cette dynamique. Pour moi, c’était vraiment l’enjeu principal, et ça continue d’être extrêmement important dans ce que j’écris. Les femmes de Féléor sont assassinées, mais elles ont une vraie action par rapport à cette mort, alors que Noé, de fois en fois, subit beaucoup les autres, sur son corps principalement. C’est un personnage qui est très détaché dans son rapport au corps, un personnage qui, même à l’intérieur d’un univers non codé, reste hors norme.
P. B. : Noé ne semble entrer en effet dans aucune grille.
A. W. : Elle est insaisissable. Au fond, si l’on pense à la construction narrative, Noé n’est jamais sujet de son histoire. Elle est toujours objet de l’histoire des autres. Elle est toujours la quête des autres personnages. C’est un personnage qui me permet d’entrer dans plein d’histoires différentes, un personnage non évolutif. Oss est le récit initiatique de Rameau, ce n’est pas son récit initiatique à elle. Elle part, il lui arrive un tas de choses, mais elle ne change pas. Au début du roman et à la fin, elle est exactement la même personne, alors que ceux qui sont entrés en contact avec elle ont changé, ont été transformés. Noé est un personnage qui est plus un moteur d’action pour les autres que pour elle-même.
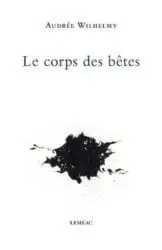 P. B. : Vos romans reprennent les codes du conte de fées, mais aussi ceux du récit érotique. Qu’est-ce que ces deux inspirations vous permettent de développer en tant que romancière ?
P. B. : Vos romans reprennent les codes du conte de fées, mais aussi ceux du récit érotique. Qu’est-ce que ces deux inspirations vous permettent de développer en tant que romancière ?
A. W. : Un rapport aux pulsions, aux tabous du lecteur, à ce qui est inconscient, à ce qui est très primitif dans l’humain. La sexualité reste extrêmement primaire au départ, donc toutes ces questions m’intéressent. À partir du moment où l’on interroge l’humain, c’est assez difficile de faire abstraction de la partie érotique ou pulsionnelle. La question de l’animalité et la question des tabous sont centrales. Le conte est souvent, de toute façon, une sorte de métaphore liée à l’érotisme, qui est comme trafiquée et tirée vers autre chose, mais il reste qu’il joue sur les mécanismes de l’érotisme de l’enfant. Mes lectures de psychanalyse, pendant ma formation, m’ont amenée à beaucoup réfléchir à la forme du conte comme accès direct à l’imaginaire – et à l’imaginaire érotique – du lecteur. Ces morceaux sont imbriqués les uns dans les autres. C’est central dans ma pratique.
P. B. : Votre troisième roman, Le corps des bêtes, publié en 2017, raconte l’histoire des Borya, une famille qui vit isolée sur une plage. Osip garde le phare ; son frère aîné, Sevastian-Benedikt, parcourt la forêt ; sa femme Noé, qu’on connaît depuis Oss, habite une cabane à côté du phare. Leur fille Mie, douze ans, possède le don de se projeter en esprit dans le corps des bêtes. Elle voudrait que son oncle Osip l’initie à la sexualité. Encore une fois, la dimension érotique est très importante, mais en même temps amorale. Est-ce une façon de laisser votre lecteur libre d’en comprendre ce qu’il veut ?
A. W. : Les émotions des lecteurs sont extrêmement variables, peu importe le roman concerné. C’est ça qui m’intéresse. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise lecture dans ces interprétations. C’est aussi pour ça que je mets en scène un univers non politisé, parce que je ne pourrais pas aborder ces questions pour ce qu’elles sont à l’extérieur de tout filtre social. Une des choses qui m’intéressait beaucoup dans Le corps des bêtes,c’est que Mie n’a jamais rien connu d’autre que son clan immédiat : son père, son oncle, sa mère, sa grand-mère et ses frères. Du fait qu’elle observe beaucoup les animaux, la question de l’inceste ne se pose même pas. Mie n’a de savoir que ce savoir observé dans la nature. Pour elle, demander à son oncle, c’est naturel, ça ne pose pas de problème par rapport à son apprentissage des codes qu’elle a fait d’elle-même. Osip, lui, est parti d’un village avant de s’installer au phare. Il a donc conscience de la transgression. Une grande partie du roman tourne autour de son interrogation sur ce qu’il va faire. On parcourt toute son histoire personnelle pour que le lecteur puisse faire le chemin à sa place et voir quelle sera sa décision. Parce que le roman lui-même ne donne pas de réponse très claire sur ce qui va se passer.
P. B. : Le dénouement reste ambigu. La fin est ouverte.
 A. W. : C’est ce qui m’importait. Au fond, le lecteur peut en faire la lecture qu’il veut. C’est l’endroit pour moi où la littérature est la plus amusante. J’ai l’impression de jouer à un jeu avec le lecteur. En même temps, ça ouvre à toutes sortes d’interprétations. Par exemple, Mie qui emprunte les corps des bêtes, est-ce qu’elle le fait pour vrai ou est-ce qu’elle s’ennuie, qu’elle regarde les animaux, qu’elle est particulièrement apathique et qu’elle est juste capable de s’imaginer être un oiseau ? Les deux sont possibles. Les gens m’ont demandé : mais c’est quoi, entre les deux ? Je n’ai pas de réponse à donner à ce genre de questions, parce que mon but, c’est que ce soit le lecteur qui y réponde. Moi, il faut que j’envisage tout quand j’écris.
A. W. : C’est ce qui m’importait. Au fond, le lecteur peut en faire la lecture qu’il veut. C’est l’endroit pour moi où la littérature est la plus amusante. J’ai l’impression de jouer à un jeu avec le lecteur. En même temps, ça ouvre à toutes sortes d’interprétations. Par exemple, Mie qui emprunte les corps des bêtes, est-ce qu’elle le fait pour vrai ou est-ce qu’elle s’ennuie, qu’elle regarde les animaux, qu’elle est particulièrement apathique et qu’elle est juste capable de s’imaginer être un oiseau ? Les deux sont possibles. Les gens m’ont demandé : mais c’est quoi, entre les deux ? Je n’ai pas de réponse à donner à ce genre de questions, parce que mon but, c’est que ce soit le lecteur qui y réponde. Moi, il faut que j’envisage tout quand j’écris.
P. B. : Blanc résine, votre quatrième roman publié en 2019, s’insère dans le même univers que Oss et Le corps des bêtes, mais raconte une histoire survenue antérieurement, puisque Daã et Laure sont les parents de Noé. Auriez-vous écrit autrement vos romans si vous les aviez écrits après Blanc résine?
W. : C’est sûr que oui. Dans Le corps des bêtes, Noé revient, mais au départ elle n’était pas censée revenir, elle n’était pas censée être ce personnage. Il y avait la mère, mais ce n’était pas elle. Elle avait des comportements – ce personnage qui s’appelait Daã d’ailleurs – tellement proches de ceux de Noé, que je me disais : ça n’a aucun sens. Les gens vont se dire : « Arrête de créer toujours les mêmes personnages ! » Il valait donc mieux que je la fasse revenir. À partir de là, j’ai réalisé que cet univers pouvait prendre beaucoup d’expansion. Au lieu de créer de nouveaux romans chaque fois, je pouvais étendre de différentes façons cet univers. Donc avant Le corps des bêtes, je n’avais jamais pensé faire revenir des personnages. Si j’avais écrit Blanc résine avant les autres romans, ils n’auraient pas été écrits de la même façon. Mais Blanc résine n’aurait pas pu voir le jour si je n’avais pas d’abord écrit les autres romans.
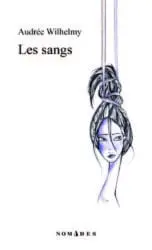 P. B. : Vous accordez beaucoup d’attention à la relation des femmes et de la nature, que vous présentez comme des forces en train de s’éveiller. Quel rapport entretenez-vous avec ces deux forces ?
P. B. : Vous accordez beaucoup d’attention à la relation des femmes et de la nature, que vous présentez comme des forces en train de s’éveiller. Quel rapport entretenez-vous avec ces deux forces ?
A. W. : J’ai fait beaucoup de lectures en préparant l’écriture de Blanc résine, sur l’écoféminisme, sur les différents rapports au sacré, le paganisme, la culture wicca, les traditions amérindiennes… Je me suis renseignée sur différents rapports au sacré, aux mythes fondateurs… Encore une fois, c’est un univers que je construis, donc je ne veux pas qu’il réponde à des codes précis. Dans Oss, il y a un curé, mais il parle de poissons pour parler de Dieu. Le rapport des femmes à la nature n’est pas vraiment original en soi. Mais il était très important pour moi à ce moment-là, d’autant plus qu’il fallait que j’explique d’où venaient les personnages de Noé et de Mie du Corps des bêtes, par les parents de Noé et les grands-parents de Mie. Il y avait une dimension où les femmes, en particulier, entretiennent un rapport singulier à leur environnement. Je voulais amplifier ce phénomène. Un autre enjeu avec ce livre, c’est que je ne voulais pas remonter plus loin après. Je voulais qu’avec Daã et Laure, ce soit le commencement de tout. Dans l’espèce de mythologie que je suis en train de construire, je n’avais pas envie de remonter très loin. La grand-mère, c’est la nature, le grand-père, c’est le ciel ; il n’y a plus de possibilité d’aller plus loin. Donc pour moi, ça met un début à l’univers que je construis. Ces aspects étaient très importants et se lient nécessairement au sacré, puisque c’est comme un récit de fondation.
Audrée Wilhelmy a publié : Oss, Leméac, 2011, collection « Nomades », 2019 ; Les sangs, Leméac, 2014, Grasset, 2015, collection « Nomades », 2017 ; Le corps des bêtes, Leméac, 2017, Grasset, 2018 ; Blanc résine, Leméac, 2019.
1. Recherche et transcription : Caroline Hogue. Pour visionner l’entretien dans son intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=iVAKgPoEumo.
2. Estuaire, no 177, automne 2019 : « Magie ».











