si je me présentais
tu ne me croirais pas
La scoliose des pommiers, p. 13.
Valérie Forgues : Ton dernier livre, La scoliose des pommiers1, commence sur ces vers : une promesse d’étonnement annoncé. Nous nous sommes croisés autour de la littérature, avec le poème « C’est trop facile de tenir ses promesses », finaliste au prix Geneviève-Amyot en 2017, puis j’ai découvert ta maison d’édition, Fond’tonne. Pourrais-tu faire les présentations, me parler de la manière dont la poésie est entrée dans ta vie ?
Anthony Lacroix : Je suis heureux d’avoir ce moment pour te parler et échanger sur la littérature. Je crois que nous avons une façon similaire d’aborder ce qui dépasse des livres. La poésie est arrivée tard dans ma vie. Mon premier contact fut au primaire, avec Nelligan : aucune épiphanie. Cependant, l’enseignante qui nous lisait Nelligan et nous faisait faire la prière m’a mis mon premier appareil photo dans les mains. Je lui en suis encore reconnaissant. Je remonte loin, mais c’est que, jusqu’à tard, j’ai eu un esprit rationnel. Le seul métier que je voulais exercer était prof de math. J’aime encore résoudre des problèmes d’algèbre. Tout ce qui est énigme me détend. La photographie a pris plus de place à ma puberté ; elle a aiguisé mon œil aux petites choses qui m’entourent. J’ai même gagné quelques concours, mais c’est un art qui coûte cher. Je ne sors plus vraiment mes objectifs, préférant mon cellulaire et Instagram qui sont moins encombrants. Durant mon secondaire, à Windsor, sont arrivés, dans le désordre : un prof qui nous récitait les vers de l’« Hymne à la beauté » pour remplir les trous entre deux exercices de grammaire ; les ami(e)s – enfin ! – avec lesquel(le)s on se prenait pour des personnages de roman ; la séparation de mes parents ; les premières amours ; l’écriture d’un roman fantastique raté ainsi que le slam et, avec lui, Frank Poule, Sophie Jeukens, Catherine Cormier-Larose, Queen Ka, Marjolaine Beauchamp. On a 17-18 ans et on voit Catherine Cormier-Larose sur scène… Comment tourner autrement que poète ?
si je pouvais casser le silence
je referais tout à l’endroit
La scoliose des pommiers, p. 65.
V. F. : Tu parles de ce qui dépasse des livres. Je l’entends comme une construction faite de notre histoire, de notre vision, de nos souvenirs concrets, ceux que transforme l’imagination, ce qui contribue à forger notre démarche d’écriture. Dans La scoliose des pommiers, ce qui dépasse, pour moi, c’est tendresse, mélancolie, histoires de famille, d’amour, de quotidien, de maladie. J’ai l’impression que tu utilises la poésie comme tu l’aurais fait jadis avec ta caméra : tu la braques sur ces éléments pour en faire ressortir l’essence. On tient souvent pour acquis que la poésie est biographique, comme si tout ce qui était dans le recueil était la pure vérité, alors que la fiction est aussi possible en poésie, non ? Elle y est même bienvenue. On peut jouer avec la réalité en poésie ?
A. L. : C’est une question complexe, la fiction en poésie. Je ne peux m’empêcher d’y réfléchir autrement qu’en candidat au doctorat et chercheur en théorie de la fiction, un autre de mes chapeaux. Je vais prendre un chemin détourné avant de répondre. Je pense que les fictions sont partout – ainsi que les sujets de création – et que, s’il y a une « frontière » entre la réalité et la fiction, elle est poreuse. En atelier, je parle souvent du discours This is water, de David Foster Wallace (disponible sur YouTube), qui a pour sujet la capacité des gens de lettres à se réfugier dans leur tête pour échapper au réel. C’est un peu ce que j’ai fait avec La scoliose des pommiers. Ce n’est pas vraiment ma vie, mais un voile de fiction apposé sur ma réalité. L’avantage de la poésie, à mes yeux, est que je n’ai pas besoin de triturer mes histoires personnelles pour les rendre intéressantes. Dans ma démarche, en poésie, le choix des mots suffit pour dépasser ma vie de malade couché dans son lit à regarder le plafond d’une chambre d’hôpital. Il y a aussi, dans ce livre, des mots empruntés, découverts au fil de mes lectures de convalescence. On pourrait dire qu’il y a dans mon recueil le « moi » du quotidien, celui – triste – qui aime le baseball, et le « moi » lecteur, qui parle avec la multitude d’avenues que lui apporte la littérature. J’ai essayé par certains vers de rendre à la fiction tout ce qu’elle m’a donné, mais je crois que cela va me prendre plus d’un livre pour y arriver.
alors
j’ouvre les failles
attends que le vent reprenne
sa place dans la dioxine
de l’après-midi
La scoliose des pommiers, p. 95.
V. F. : L’idée que les écrivains puissent se réfugier dans leur tête pour écrire m’interpelle. Ce n’est pas une fuite, mais un refuge où l’on peut transformer la réalité, la rejouer, remodeler les événements. Tu parles du choix des mots ; ça m’a frappée à la lecture de La scoliose des pommiers. Alors que l’ambiance des poèmes est douce, claire, parsemée de passages plus douloureux, soudain surgissent des mots très cliniques, froids par comparaison à la chaleur qui se dégage de l’ensemble du livre. Quelles possibilités poétiques t’apporte ce vocabulaire ?
Par ailleurs, j’ai découvert ton amour pour le baseball à un souper chez Camille Deslauriers, en 2018, où les invités proposaient un plat tiré d’un livre. Tu t’étais inspiré du roman Le projet Syracuse et tu avais apporté des hot-dogs, différentes moutardes. Ça représente quoi, le baseball, pour toi ?
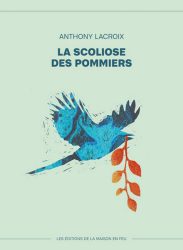 L. : L’écriture autour de mots rares est arrivée par la lecture. À chaque année qui commence, je me donne des objectifs de lecture. Je me permets d’en dévier, mais ça donne le ton à mon année, me permet de fouiller en bibliothèque. Cette année, je lis, et écris en écho avec François Blais, la grit lit. et la littérature issue des peuples autochtones. L’an dernier, je cherchais à connaître la littérature italienne et, par la bande, la culture de ma grand-mère. J’ai trouvé dans les livres de De Filippo, De Luca, Sapienza, et d’autres, de merveilleuses façons d’écrire la violence, la mer, la chaleur. Bien sûr, les livres que je lisais étaient des traductions ; donc, la recherche du mot juste était d’autant plus importante dans chaque ouvrage. Ma façon d’écrire est liée à mes lectures et si, avant, j’étais plus proche d’un style à la Raymond Carver ou à la Patrice Desbiens, mes recherches stylistiques sont maintenant ailleurs. Je pourrais passer plusieurs jours sans écrire, mais c’est impensable pour moi que je ne me réfugie pas au moins vingt minutes par jour dans la lecture.
L. : L’écriture autour de mots rares est arrivée par la lecture. À chaque année qui commence, je me donne des objectifs de lecture. Je me permets d’en dévier, mais ça donne le ton à mon année, me permet de fouiller en bibliothèque. Cette année, je lis, et écris en écho avec François Blais, la grit lit. et la littérature issue des peuples autochtones. L’an dernier, je cherchais à connaître la littérature italienne et, par la bande, la culture de ma grand-mère. J’ai trouvé dans les livres de De Filippo, De Luca, Sapienza, et d’autres, de merveilleuses façons d’écrire la violence, la mer, la chaleur. Bien sûr, les livres que je lisais étaient des traductions ; donc, la recherche du mot juste était d’autant plus importante dans chaque ouvrage. Ma façon d’écrire est liée à mes lectures et si, avant, j’étais plus proche d’un style à la Raymond Carver ou à la Patrice Desbiens, mes recherches stylistiques sont maintenant ailleurs. Je pourrais passer plusieurs jours sans écrire, mais c’est impensable pour moi que je ne me réfugie pas au moins vingt minutes par jour dans la lecture.
Ma relation au baseball est un peu la même. J’ai un trouble de l’attention avec hyperactivité assez sévère. Si je ne bouge pas dans ma journée, j’ai trop d’énergie pour rester en place et travailler ou pour dormir la nuit ; je deviens irritable. Le baseball a la particularité d’être un sport très lent. Il y a des moments de fulgurance – une course, une frappe, etc. – mais, généralement, cela se passe dans l’attente. Tant d’auteurs que j’admire traitent du baseball dans leurs livres comme si on parlait du poème parfait. Holden Caulfield, le personnage principal de The Catcher in the Rye, décrit le gant de baseball que lui a légué son frère, dans lequel celui-ci avait écrit des poèmes pour avoir quelque chose à quoi réfléchir dans le champ gauche. Le baseball est pour moi la parfaite illustration de l’écriture du poème : on attend qu’il se passe quelque chose et, parfois, tout se met en branle d’un coup sec. Si l’on est trop loin dans notre tête, il se peut que l’on rate le moment.
Je te souhaite un bon début d’hiver, est-ce qu’il s’est rendu à toi ? Ici, il tarde.
à ce point-ci
je ne sais pas ce qui peut survenir
dans la crevasse de mon gant
mais
je garde secrète
une passion pour les terrains de baseball la nuit
La scoliose des pommiers, p. 86.
V. F. : Je suis toujours curieuse et étonnée quand je lis que des gens se fixent des objectifs de lecture, moi qui me laisse porter au gré de beaucoup trop de choses : les critiques ou les lectures qui me conduisent vers d’autres lectures, mes ami(e)s qui publient, mes visites dans les librairies, mon travail en bibliothèque. Cela dit, je comprends ce dont tu parles, l’influence tangible des lectures sur l’écriture, comme si, parfois, certain(e)s auteur(-trice)s pavaient le chemin pour nous. Et ta quête du mot juste, je la sens dans La scoliose des pommiers. Il me semble qu’aucun mot, particulièrement ceux qui sont issus du vocabulaire médical, ne pourrait être changé ou, alors, c’est l’essence, la structure de tes poèmes qui s’en trouveraient différentes.
La description que tu fais du lien entre baseball et poésie me semble juste, belle aussi. Elle ouvre quelque chose de nouveau pour moi ; je pense que je ne regarderai plus un match de la même façon. Ces parallèles que tu dresses entre attente, attention, lenteur, je les reconnais et ils sont, eux aussi, très présents dans ton livre. Les images, même les plus tristes, les plus douloureuses, se déploient doucement, et cela m’oblige, en tant que lectrice, à ralentir, à être patiente, à faire des arrêts sur les poèmes pour les accueillir pleinement.
Nous partageons cela, toi et moi : l’édition, la direction littéraire. Pourrais-tu me parler de Fond’tonne, de sa naissance, de sa direction ?
A. L. : Cette question sur Fond’tonne et l’édition arrive à un drôle de moment dans ma vie. Je viens d’apprendre que j’enseignerai la pratique éditoriale à l’Université du Québec à Rimouski l’hiver prochain, si le nombre d’inscriptions est suffisant. Je suis très heureux de cette chance que l’on m’offre de partager ma passion, mais cela m’incite à l’introspection, comme l’ensemble de notre correspondance.
Fond’tonne est née de l’idée de faire un recueil de poésie autoédité, qui deviendra Carcasse d’Occident, avec Delphie Côté-Lacroix. Je dois beaucoup à Delphie : le logo de Fond’tonne vient d’elle, et je devais le mentionner. Mon travail de direction littéraire remonte, quant à lui, à la revue Tintamarque que nous avions créée, des ami(e)s et moi, dans le but très assumé de « brasser la cage » au Cégep de Sherbrooke. Durant ces années comme directeur de revue, je me suis fait plusieurs ami(e)s à l’esprit frondeur comme le mien. Comme la grève leur avait laissé beaucoup de choses à dire et du temps pour les écrire, nombre d’entre eux (elles) avaient des manuscrits dans leurs tiroirs.
L’édition de poésie, entre 2012 et 2014, était un vaste paysage désert. L’Écrou commençait et publiait surtout des voix montréalaises, L’Oie de Cravan n’était pas encore distribuée et La Peuplade venait de fermer sa collection de poésie. Ça paraît incroyable aujourd’hui.
J’ai d’abord publié des zines avec des textes qui nécessitaient peu de direction littéraire. Je pense à Marianne V, qui voulait un support pour des textes qu’elle allait présenter à un festival de poésie. J’ai commencé à « penser livre » avec Olivier Lussier, une voix qui allait donner le ton à Fond’tonne. Le livre d’Audrey-Anne Marchand fut notre premier projet de livre-objet. Il est important de nommer ici Nicholas Giguère, qui offrit à Fond’tonne son magnifique premier recueil, Marques déposées, entièrement monté par des finissants en graphisme du Cégep de Sherbrooke et avec qui j’ai travaillé sur Queues, qui a été publié chez Septentrion, dans sa collection « Hamac ».
Je dois aussi nommer Amélie Aubé Lanctôt qui revient cette année, après huit ans, avec son deuxième recueil chez Fond’tonne. C’est bon signe quand un auteur ou une autrice revient après plusieurs années de silence. Par contre, on a échappé des beaux projets et la route est aussi parsemée de regrets. Il y a encore de nombreux aspects à travailler chez Fond’tonne : être distribué, travailler la communication, mais on compte bien s’améliorer pour nos dix ans. Mon incroyable et surchargée codirectrice, Frédérique Dubé, et moi y travaillons.
Ma force, c’est le travail, la lecture que je mets dans les manuscrits. Je suis intarissable et vais travailler les images aussi longtemps qu’il le faudra. Je veux que l’auteur ou l’autrice soient fiers de leur livre dans dix ans. C’est pour cette raison que j’aime travailler sur des premiers livres. Au fond, j’espère que la direction dans laquelle j’ai amené chaque projet était la meilleure. C’est sur quoi je vais réfléchir la nuit avant de donner mon cours, je le sens.
Fond’tonne, c’est une histoire de parole à contre-courant, de vaste équipe et de quelque chose de punk qui m’habite encore. Par contre, ne me demande pas d’où vient le nom ; je ne m’en souviens plus.
et si
ça m’a pris trois taxis
pour étancher l’orage
j’ai fini par trouver le bon angle
pour remplir ma chambre de lampadaires
La scoliose des pommiers, p. 129.
V. F. : Je jalousais les images de neige que je voyais sur les réseaux sociaux québécois, depuis quelques jours, et voilà qu’elle est arrivée ici, en Bavière. Félicitations pour ce cours que tu donneras à l’hiver. L’enseignement, le contact avec les étudiants te pousseront encore plus, oui, dans cette introspection dont tu parles, au sujet de ta pratique poétique et éditoriale.
L’histoire de Fond’tonne est passionnante. Merci d’en avoir retracé les grandes lignes. Je remarque à quel point tu as été entouré tout au long de la route qui t’a mené à fonder cette maison d’édition. On écrit seul, c’est tellement cliché de le dire, mais force est de constater que nos parcours littéraires, ce qui nous construit, comme écrivain(e), comme éditeur(-trice), c’est vraiment les rencontres, les gens avec qui on connecte, avec qui on avance, avec qui on grandit.
Mon cher, notre correspondance tire à sa fin. Je te souhaite quoi, pour la suite ?
A. L. : Ici, la neige est bien installée et je viens tout juste de m’acheter des bottes avec mon cachet de deux ateliers et la vente de mes livres au Salon du livre de Rimouski. Tu le sais, comme écrivain, on ne gagne pas beaucoup avec notre création, mais c’est un plaisir quand cela arrive. Même si, bien sûr, je ne crée pas pour l’argent, je trouvais ça important d’en parler un peu.
Souhaite-moi de garder ma passion et d’avoir tout l’espace possible pour m’épanouir, ça et des bonnes lectures pendant les fêtes.
1. La scoliose des pommiers, La maison en feu, Montréal, 2022, 144 p.











