Propice à l’introspection, la marche compte de nombreux adeptes parmi les écrivains – ces « écrivains randonneurs », comme les appelait Antoine de Baecque dans une éclairante anthologie1. Mais qu’en est-il de la course ? Avec la nouvellière, poète et romancière montréalaise Annie Perreault se dessine la figure de l’écrivain-coureur.
Le motif de la course, souvent présent dans sa fiction, intéresse Annie Perreault au point qu’elle en a fait le sujet de sa thèse de doctorat2. En fait, la native de Saint-Hubert voyait déjà des liens entre l’écriture et la course lorsqu’elle préparait son premier ouvrage, L’occupation des jours : « J’ai commencé l’écriture de ce livre en même temps que je me suis mise à courir, sans trop savoir jusqu’où cela me mènerait ni comment le livre allait tenir. De jour en jour, comptant les kilomètres, je rêvassais à cette idée du terrain vague, des lieux se mettaient en place, des mots avançaient un à un. Il y a eu pour moi un lien très fort entre la pratique de la course à pied et le geste d’écrire. Quelque chose de l’ordre de la patience et de l’acharnement, avec un souci du rythme toujours3. » Ainsi naissait un art de la rêverie en mouvement.
L’attrait des lieux désolés
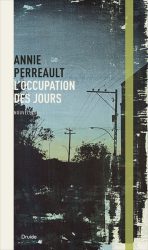 Lorsque paraît L’occupation des jours en 2015, Annie Perreault est déjà une nouvellière expérimentée. Quinze ans plus tôt, « Le petit orteil4 » – conte cruel aux accents kafkaïens – lui avait valu le Prix de la nouvelle Radio-Canada. L’année suivante, Nuit blanche publiait une nouvelle inédite : « Le rideau orange5 », dans laquelle un narrateur est intrigué par une nouvelle voisine qu’il épie à travers un rideau à demi transparent. De 2008 à 2013, d’autres nouvelles paraissent dans des revues (Biscuit chinois, Virages, XYZ. La revue de la nouvelle). Trois d’entre elles sont intégrées au recueil L’occupation des jours, qui surprend non seulement par sa longueur – « Rares sont les recueils de nouvelles qui font dans les presque 400 pages6 », observe à ce propos Michel Lord – mais aussi par sa structure. L’auteure a en effet disposé ses nouvelles (plus d’une soixantaine) en grappes, correspondant à dix terrains vagues, et en fragments, disposition qui dénote un goût pour les listes et les énumérations. Entre la ville, la banlieue et la campagne, entre les endroits précis (le Moyen-Orient, Amsterdam, New York) et les lieux anonymes, Perreault retrace des bribes de destinées qu’elle met en relation avec des espaces vacants. On découvre ainsi les pensées d’une femme de ménage sur la vie. Un enfant repère un cadavre féminin sur Google Earth. Un spéculateur financier doit demander des secours pour aider une femme blessée aperçue durant son jogging matinal. Une fillette, partie chercher du pain, perd toute sa famille lors d’un séisme. On la retrouve par la suite émigrant au Canada, où un cinéaste de renom devient son père adoptif.
Lorsque paraît L’occupation des jours en 2015, Annie Perreault est déjà une nouvellière expérimentée. Quinze ans plus tôt, « Le petit orteil4 » – conte cruel aux accents kafkaïens – lui avait valu le Prix de la nouvelle Radio-Canada. L’année suivante, Nuit blanche publiait une nouvelle inédite : « Le rideau orange5 », dans laquelle un narrateur est intrigué par une nouvelle voisine qu’il épie à travers un rideau à demi transparent. De 2008 à 2013, d’autres nouvelles paraissent dans des revues (Biscuit chinois, Virages, XYZ. La revue de la nouvelle). Trois d’entre elles sont intégrées au recueil L’occupation des jours, qui surprend non seulement par sa longueur – « Rares sont les recueils de nouvelles qui font dans les presque 400 pages6 », observe à ce propos Michel Lord – mais aussi par sa structure. L’auteure a en effet disposé ses nouvelles (plus d’une soixantaine) en grappes, correspondant à dix terrains vagues, et en fragments, disposition qui dénote un goût pour les listes et les énumérations. Entre la ville, la banlieue et la campagne, entre les endroits précis (le Moyen-Orient, Amsterdam, New York) et les lieux anonymes, Perreault retrace des bribes de destinées qu’elle met en relation avec des espaces vacants. On découvre ainsi les pensées d’une femme de ménage sur la vie. Un enfant repère un cadavre féminin sur Google Earth. Un spéculateur financier doit demander des secours pour aider une femme blessée aperçue durant son jogging matinal. Une fillette, partie chercher du pain, perd toute sa famille lors d’un séisme. On la retrouve par la suite émigrant au Canada, où un cinéaste de renom devient son père adoptif.
La chute
Pour son deuxième ouvrage, La femme de Valence, publié en 2018, Annie Perreault s’est tournée vers la forme du roman. La brièveté des chapitres et l’insertion de nombreux intertitres viennent cependant rappeler son travail de nouvellière. L’œuvre raconte l’histoire d’une Québécoise, Claire Halde, qui voit ses vacances familiales de 2009 en Espagne bouleversées par l’irruption d’une femme en détresse sur le toit-terrasse du Valencia Palace. Après avoir confié son sac à Claire en la sommant de le garder, l’inconnue s’est jetée dans le vide. Le reste du roman décrit les conséquences physiques et psychologiques qu’auront eues sur Claire ce suicide et, en 2025, le voyage de sa fille partie courir le marathon de Valence. Inspiré d’un fait vécu que l’auteure avait d’abord transposé sous forme de poème7, La femme de Valence se distingue par sa composition et son rythme très maîtrisés, de même que par sa délicate analyse de l’anxiété. En 2020, l’œuvre a paru en France sous un nouveau titre : Hôtel Valencia Palace. Le texte a lui aussi subi quelques modifications. Selon Le nouvel Attila, « l’éditeur qui met du sang dans son vin », l’œuvre de Perreault se situe « entre Duras et Lynch8 ».
Grands froids
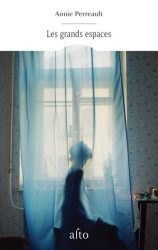 Un nouvel intervalle de trois ans a précédé la publication du second roman d’Annie Perreault, Les grands espaces9, en 2021. Récit polyphonique et sibérien, l’œuvre est divisée en points cardinaux et en courts chapitres aux titres se référant aux personnages dont on suit, à tour de rôle, le point de vue. Il s’agit notamment de « L’ours », un homme installé en Sibérie pour la construction d’un télescope sous-marin, ou d’Anna, une femme déterminée à traverser le lac Baïkal gelé. On retrouvera plus loin dans le roman cette même Anna des années plus tôt lorsque, pendant un voyage à bord du Transsibérien, elle avait fait la rencontre de Gaby, une photographe qui se consolait d’un chagrin d’amitié (pire, selon elle, qu’un chagrin d’amour) en colligeant les récits de grands froids vécus par les gens. Les personnages les plus importants du roman sont des femmes qui, souvent, ont des liens entre elles. Ainsi, le personnage d’Eleonore Greenberg est la tante de Gaby. Surfeuse obsédée par Youri Gagarine, Eleonore s’était vu infliger une lobotomie pour la guérir de ses excentricités. Certains chapitres, très brefs, font entendre la voix du lac Baïkal, alors que d’autres sont consacrés à « Celle qu’on ne voit pas », c’est-à-dire la romancière en train d’écrire son livre. Si Les grands espaces présente une forme légèrement plus complexe que L’occupation des jours et La femme de Valence, on y retrouve cependant la même écriture ouvragée et la même fascination pour la géographie, le fragment et le motif de la course. Pendant qu’elle écrivait Les grands espaces, Perreault s’est rendue en Sibérie afin de participer au marathon du lac Baïkal. Courir sur un désert de glace : l’écrivaine-coureuse a décidément le don de choisir ses décors.
Un nouvel intervalle de trois ans a précédé la publication du second roman d’Annie Perreault, Les grands espaces9, en 2021. Récit polyphonique et sibérien, l’œuvre est divisée en points cardinaux et en courts chapitres aux titres se référant aux personnages dont on suit, à tour de rôle, le point de vue. Il s’agit notamment de « L’ours », un homme installé en Sibérie pour la construction d’un télescope sous-marin, ou d’Anna, une femme déterminée à traverser le lac Baïkal gelé. On retrouvera plus loin dans le roman cette même Anna des années plus tôt lorsque, pendant un voyage à bord du Transsibérien, elle avait fait la rencontre de Gaby, une photographe qui se consolait d’un chagrin d’amitié (pire, selon elle, qu’un chagrin d’amour) en colligeant les récits de grands froids vécus par les gens. Les personnages les plus importants du roman sont des femmes qui, souvent, ont des liens entre elles. Ainsi, le personnage d’Eleonore Greenberg est la tante de Gaby. Surfeuse obsédée par Youri Gagarine, Eleonore s’était vu infliger une lobotomie pour la guérir de ses excentricités. Certains chapitres, très brefs, font entendre la voix du lac Baïkal, alors que d’autres sont consacrés à « Celle qu’on ne voit pas », c’est-à-dire la romancière en train d’écrire son livre. Si Les grands espaces présente une forme légèrement plus complexe que L’occupation des jours et La femme de Valence, on y retrouve cependant la même écriture ouvragée et la même fascination pour la géographie, le fragment et le motif de la course. Pendant qu’elle écrivait Les grands espaces, Perreault s’est rendue en Sibérie afin de participer au marathon du lac Baïkal. Courir sur un désert de glace : l’écrivaine-coureuse a décidément le don de choisir ses décors.
1. Écrivains randonneurs, anthologie présentée par Antoine de Baecque, Omnibus, Paris, 2013, 992 p.
2. « Courir, écrire. Les grands espaces », thèse de doctorat en études et pratiques des arts, profil recherche-création, en préparation à l’UQAM. Voir https://nord.uqam.ca/personne/annie-perreault.
3. Annie Perreault, L’occupation des jours, Druide, Montréal, 2015, p. 363.
4. Annie Perreault, « Le petit orteil », XYZ. La revue de la nouvelle, no 65, printemps 2001, p. 47-55.
5. Annie Perreault, « Le rideau orange », Nuit blanche, no 84, automne 2001, p. 24.
6. Michel Lord, « Lettres canadiennes 2015 : Nouvelle », University of Toronto Quarterly, vol. 86, no 3, été 2017, p. 327.
7. On peut lire ce poème, « Le ciel de Valence », en lice pour le Prix de poésie Radio-Canada 2015, sur le site de la société d’État : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/750224/annie-perreault-finaliste-prix-de-poesie-radio-canada-2015.
8. Voir le site de l’éditeur : http://www.lenouvelattila.fr/hotel-valencia-palace/.
9. Annie Perreault, Les grands espaces, Alto, Québec, 2021.
EXTRAITS
Ça commence par une fissure large comme un cheveu. Une petite ligne sombre sur un mur blanchi. En temps normal, on l’apercevrait d’abord comme ça, alors qu’elle est toute fine, qu’elle n’inquiète pas encore. Mais il s’agit d’un temps où les choses s’entrechoquent, où les gens se précipitent, où les fissures s’élargissent, deviennent des lézardes, des déchirures irréparables, des matériaux qui vous tombent sur la tête, vous tuent peut-être sur le coup.
« Terrain 2 – Tremblement », L’occupation des jours, p. 79.
C’est tout simple : pied au sol, pied en l’air, impact et suspension, pied au sol, pied en l’air et ainsi de suite, avec rotation d’épaules, et tout naturellement, en lançant devant le bras qui s’oppose à la jambe qui propulse, mais sans serrer les poings, ce n’est pas un match de boxe. C’est un autre combat, où l’on est délicieusement seul. Nul autre adversaire que soi-même.
« Terrain 10 – Bords de route », L’occupation des jours, p. 347.
Elle voulait sa chute vertigineuse, assez d’espace vertical pour se tuer, assez de ciel pour s’imaginer en avion de papier, pour planer, planer, planer, se croire en apesanteur, quelques secondes, quelques mètres de liberté avant le béton, comme une échappée, ce sentiment exaltant de fendre l’air.
La femme de Valence, p. 39.
Elle porterait ce secret comme une lacération qui cicatrise vilainement, et cette rencontre de Valence se graverait dans sa tête. Une craquelure dans un vernis jusqu’alors lisse, une tare, un poids, un dégoût d’elle-même, son plus grand échec à vie. La mort de cette femme lui imposerait un silence ou une pudeur, quelque chose s’articulant autour de la culpabilité. Elle n’avait pourtant pas tué cette femme.
La femme de Valence, p. 61.
Seules les jeunes filles qui ont connu l’appel de Dieu peuvent comprendre l’exaltation qu’elle ressent à sa vue. Sa propre existence ne lui importe plus, toutes ses pensées sont pour son héros de l’espace. Elle mène deux destinées en même temps et rien ne surpasse celle qui illumine son cerveau : sa vie avec Youri, son amour pour Youri, la voix joyeuse de Youri, les beaux yeux rieurs de Youri, les mains de Youri qui touchent les siennes, ses doigts qui se glissent dans sa chevelure, qui tracent un chemin sur sa joue, partent de la tempe, à la naissance des cheveux, jusqu’à aller caresser ses lèvres. Dans sa trame parallèle, elle parcourt avec ses doigts les contours du sourire tendre que le cosmonaute lui adresserait un jour. Elle nourrit des scénarios fleur bleue sans croire une seule seconde qu’ils pourraient faire patate.
Les grands espaces, p. 108-109.
Je regarde le lac par la fenêtre. Chaque printemps, j’espère être sur les lieux pour assister à la rupture du couvert de glace, un suspense d’une beauté angoissante. Cette année, on se croirait dans un paysage vaporeux de lande aquatique, un homme manque à l’appel et la réalité rattrape ma fiction sibérienne. J’ai abandonné Anna en pleine nuit sur le lac Baïkal qui menace de l’avaler et je n’arrive pas à écrire la scène finale.
Les grands espaces, p. 191.











