La liberté, ma jolie, la liberté de choisir ma vie.
Et sa mort.
Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux
« Le ciel est si grand et si bleu, l’été, un ciel de Provence1. » Quand Louise Desjardins parle des ciels d’Abitibi, elle ajoute avec émotion : « [C’]est grand, c’est immense, je suis dans ma respiration, je suis comblée ». Toute son œuvre en sera imprégnée.
L’écrivaine est née à Rouyn-Noranda en 1943. Elle a étudié la littérature en France, à Sherbrooke puis à Montréal, où elle demeure aujourd’hui, « près de mes deux fils et de mes petites-filles, car nous habitons tous le même quartier », raconte-t-elle en entrevue sur Zoom. Les petits cafés de Villeray, propices aux rencontres personnelles et chaleureuses, demeurent en effet une zone interdite pendant cette interminable pandémie.
La bibliographie de Louise Desjardins est imposante : près d’une trentaine d’ouvrages y sont déclinés, dont des recueils de poésie et des romans2, auxquels s’ajoutent des traductions, des essais… Et un ovni, seul de son espèce, la biographie de Pauline Julien, publiée peu après sa mort en 1998, où l’on retrouve des confidences recueillies auprès de l’artiste, de sa famille et de ses proches.
La passion de l’écriture
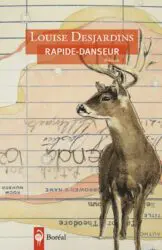 Desjardins« S’il fallait choisir un terme qui me définisse, entre poétesse, romancière, traductrice et essayiste, ou encore professeure, je préfèrerais celui d’autrice, un mot que j’aime, car par l’écriture je suis dans la création et j’ai besoin de ce type d’engagement », précise-t-elle. Pendant les trente et quelques années durant lesquelles elle a enseigné la littérature au niveau collégial, elle a étonnamment toujours trouvé le temps d’écrire « une ou deux heures par jour ». Aujourd’hui retraitée, Louise Desjardins consacre tout son temps à sa passion.
Desjardins« S’il fallait choisir un terme qui me définisse, entre poétesse, romancière, traductrice et essayiste, ou encore professeure, je préfèrerais celui d’autrice, un mot que j’aime, car par l’écriture je suis dans la création et j’ai besoin de ce type d’engagement », précise-t-elle. Pendant les trente et quelques années durant lesquelles elle a enseigné la littérature au niveau collégial, elle a étonnamment toujours trouvé le temps d’écrire « une ou deux heures par jour ». Aujourd’hui retraitée, Louise Desjardins consacre tout son temps à sa passion.
Ce n’est qu’en 1983, à l’aube de la quarantaine et à la suite d’un voyage initiatique de trekking dans l’Himalaya, que l’écrivaine publie un premier ouvrage, Rouges chaudes, suivi de Journal du Népal, et elle n’a jamais cessé d’écrire depuis. Pendant dix ans, elle ne publiera que de la poésie ; il faudra attendre 1993 pour qu’elle donne libre cours à ses talents de narratrice et que soit publié son premier roman, La love, bien reçu par la critique3.
Avec les années, elle développe son style littéraire, issu de la comparaison entre deux histoires parallèles ou de l’alternance entre deux propositions complémentaires. L’autrice commente : « Cette façon de structurer mes livres vient sans doute de mes études de maîtrise en littérature comparée ; c’est devenu ma signature ». On le remarque dans ses premiers romans et encore plus dans La fille de la famille, son dernier opus de facture autobiographique où l’écrivaine entremêle deux passés, enchâssant l’intrigue dans un astucieux monologue en deux temps, livré par le même personnage à des moments différents de sa vie.
L’écriture de Louise Desjardins est fluide, claire, directe, très factuelle. Exigeante aussi, car l’autrice n’ajoute jamais de notes explicatives à ses propos ; comprenne qui doit comprendre. Ses dialogues s’intègrent parfaitement à une narration où les actions, pensées et paroles des protagonistes forment un tout exempt de ces longues descriptions « qui peuvent parfois ennuyer ». À titre d’exemple, un extrait de La fille de la famille : « Ma mère ne dit pas un mot pendant plusieurs minutes, c’est surprenant. […] Bon, lève-toi donc que je regarde tes draps. Non, m’man, j’ai trop mal au ventre. Parle pas si fort, tes frères vont t’entendre ».
Faut-il s’étonner que son écrivaine fétiche soit la Française Annie Ernaux, dont l’œuvre littéraire, elle aussi fortement autobiographique, a été maintes fois récompensée
Incessantes quêtes
Roman après roman, Louise Desjardins explore des thèmes forts et fondamentaux tels que la famille, la maternité, la dépendance affective ou intergénérationnelle ainsi que la liberté. Ses protagonistes, souvent issus d’une même famille, se détestent, s’aiment ou cherchent maladroitement à s’apprivoiser, avec ou sans succès. L’autrice explique ses choix : « [L]a famille est le point d’ancrage de tous les humains ; nous sommes tous en lien avec notre famille, que ce soit positif ou pas. Ce sont des liens qu’on ne peut pas ignorer, ils ont fait de nous ce que nous sommes ».
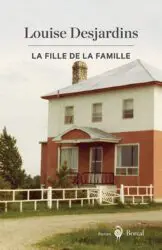 Les relations amoureuses sont aussi au cœur de son œuvre, où les couples se font et se défont. Dans La fille de la famille, une jeune femme quitte l’Abitibi pour s’exiler et se marier à Montréal, puis abandonne un jour mari et enfants afin de trouver des réponses à son mal-être. « Je te quitte. Je l’ai dit, je pleure et je pleure. Je suis délivrée, fébrile et triste en même temps. »
Les relations amoureuses sont aussi au cœur de son œuvre, où les couples se font et se défont. Dans La fille de la famille, une jeune femme quitte l’Abitibi pour s’exiler et se marier à Montréal, puis abandonne un jour mari et enfants afin de trouver des réponses à son mal-être. « Je te quitte. Je l’ai dit, je pleure et je pleure. Je suis délivrée, fébrile et triste en même temps. »
Est-ce les mères qui sont dénaturées et renient leur enfant ? Ou l’enfant qui ne peut plus supporter l’étouffant amour maternel ? Dans un couple qui bat de l’aile, qui décide le premier de couper les ponts ? Et pourquoi ? Doit-on fuir à l’autre bout du monde pour retrouver un peu de sérénité ? Au Népal ? Ou en Argentine, par exemple, comme dans L’idole ? « J’ai mis un point d’orgue sur ma vie. Comment tout ça va-t-il finir ? Je l’ignore, mais je n’attends plus rien de personne et c’est bien ainsi. »
Un autre thème récurrent chez Louise Desjardins est la dénonciation des injustices faites aux femmes. Partout sur la planète, les années 1960-1970 ont vu se multiplier les revendications féministes, et l’écrivaine en était ; elle ne se prive pas aujourd’hui de souligner les absurdités sociales qu’elle aura elle-même connues dans le Québec de l’époque. Épouse pourvoyeuse dans les premières années de son mariage ou mère de substitution au sein de sa fratrie, elle aura joué tous les rôles dans lesquels on tentait alors de cantonner les femmes. Elle en établit le constat avec tendresse et humour dans La fille de la famille, sans pour autant porter de jugement : « C’est dimanche soir, mes parents sont à la messe. Je garde le fort, comme toujours. […] Le benjamin a réussi à s’endormir. Les plus grands construisent un camion et se chamaillent ».
Les quêtes de l’écrivaine ne sont en fait que des variations sur un thème éternel qu’elle connaît bien, pour l’avoir traqué toute sa vie. Elle explique : « Il y a inévitablement et invariablement une quête d’identité. Quand j’aborde une thématique quelconque dans un de mes livres, que ce soit l’abandon, le rejet ou la fuite, ce n’est pas que je connaisse la réponse à la question soulevée, mais bien parce que je la cherche. Je n’ai pas la solution, mais en écrivant, j’apprends quelque chose sur moi ».
Fidèle à ses racines
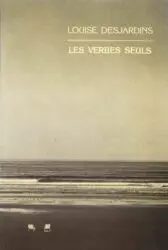 Lorsque Louise Desjardins est née, la mine et la fonderie de cuivre étaient bien vivantes au cœur de la ville de Noranda4. L’industrie minière exigeait alors une abondante main-d’œuvre et les néo-Québécois ont répondu massivement à l’appel. Cohabitaient ainsi un grand nombre de nationalités, de langues et de religions dans cette région de l’ouest du Québec, à quelques kilomètres de la frontière ontarienne. Côtoyant Autochtones, anglophones et nouveaux arrivants, l’autrice a rapidement été exposée à la différence et aux cultures autres que celle de sa famille de classe moyenne, québécoise de souche, blanche, catholique et francophone.
Lorsque Louise Desjardins est née, la mine et la fonderie de cuivre étaient bien vivantes au cœur de la ville de Noranda4. L’industrie minière exigeait alors une abondante main-d’œuvre et les néo-Québécois ont répondu massivement à l’appel. Cohabitaient ainsi un grand nombre de nationalités, de langues et de religions dans cette région de l’ouest du Québec, à quelques kilomètres de la frontière ontarienne. Côtoyant Autochtones, anglophones et nouveaux arrivants, l’autrice a rapidement été exposée à la différence et aux cultures autres que celle de sa famille de classe moyenne, québécoise de souche, blanche, catholique et francophone.
Desjardins ayant grandi dans une petite ville du bout du monde, les notions de métissage et de curiosité envers l’autre teintent son œuvre tout entière et témoignent de son attachement profond à sa région natale, creuset de ses apprentissages. Elle partage ce trait avec son célèbre frère Richard, dont la poésie et la musique ont célébré ou condamné, mais toujours reconnu et souligné, les particularités de l’Abitibi.
Entre fidélité et tendresse pour son territoire d’origine et soif de découvertes, Louise Desjardins vit bien ses ambivalences et sa dualité. Elle précise : « Tous les étés, je retourne au chalet du lac Vaudray que mon père a bâti dans les années 1950 dans une réserve de biodiversité située près de Rouyn-Noranda et mes yeux ne se lassent pas de regarder le ciel immense. J’en ai besoin ». L’appel du large est tout aussi puissant chez elle et l’écrivaine aura souvent eu l’occasion de voyager dans de nombreux pays et villes, pour des raisons tant professionnelles que personnelles.
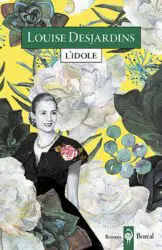 Louise Desjardins n’aime pas lire des guides de voyage, ni visiter un endroit « en touriste » ; elle préfère découvrir la diversité des lieux en allant à la rencontre des gens qui y vivent. Dans ses souvenirs de pays lointains pointe une préférence pour l’Argentine, où elle a eu le loisir de passer deux mois pour écrire L’idole, livre dans lequel elle confesse le plaisir qu’elle y a connu : « Et je suis terriblement vivante sous le ciel de Buenos Aires, aussi limpide que celui d’Abitibi ».
Louise Desjardins n’aime pas lire des guides de voyage, ni visiter un endroit « en touriste » ; elle préfère découvrir la diversité des lieux en allant à la rencontre des gens qui y vivent. Dans ses souvenirs de pays lointains pointe une préférence pour l’Argentine, où elle a eu le loisir de passer deux mois pour écrire L’idole, livre dans lequel elle confesse le plaisir qu’elle y a connu : « Et je suis terriblement vivante sous le ciel de Buenos Aires, aussi limpide que celui d’Abitibi ».
Et demain ?
Comme plusieurs, Louise Desjardins demeure sans voix devant la cruelle pandémie du début des années 2020, face au monde inconnu où devront vivre et grandir les plus jeunes générations. La lecture et relecture du poème de Roland Giguère « La main du bourreau finit toujours par pourrir » (1951) l’apaise et lui insuffle l’espoir nécessaire pour continuer sa route.
Grande main qui pèse sur nous
grande main qui nous aplatit contre terre
grande main qui nous brise les ailes
grande main de plomb chaud
grande main de fer rouge
grands ongles qui nous scient les os
grands ongles qui nous ouvrent les yeux
comme des huîtres
grands ongles qui nous cousent les lèvres
grands ongles d’étain rouillé
grands ongles d’émail brûlé
mais viendront les panaris
panaris
panaris
la grande main qui nous cloue au sol
finira par pourrir
les jointures éclateront comme des verres de cristal
les ongles tomberont
la grande main pourrira
et nous pourrons nous lever pour aller ailleurs.
1. Louise Desjardins, Rapide-Danseur, Boréal, Montréal, 2012.
2. La fille de la famille (2020) ; L’idole (2017) ; Ciels métissés (2014) ; Rapide-Danseur (2012), Nos saisons (collectif, 2011), Le fils du Che (2008), Les silences (2008), La nouvelle catastrophe (2007), So long (2005), Momo et Loulou (2004), Silencieux lassos (2004), Ni vu ni connu (2002), Cœurs braisés(2001), Pauline Julien. La vie à mort (1999), Darling (1998), Le marché de l’amour (1995), La love (1993), Margaret Atwood, Politique de pouvoir (traduction, 1995), Poèmes faxés (collectif, 1994), Le désert des mots (1991), Le buisson ardent (1991), La 2e Avenue (1990), La minutie de l’araignée (1987), La catastrophe (1985), Les verbes seuls (1985), Petite sensation (1985), Rouges chaudes suivi de Journal du Népal (1983).
3. La love a reçu le Grand prix du Journal de Montréal et le Prix des Arcades de Bologne.
4. Rouyn et Noranda ont fusionné en 1986 pour former la ville de Rouyn-Noranda.
EXTRAITS
Des petites guerres, des moments d’horreur. Tu sais, j’aime d’une tendresse banale. Mais les armes sont toutes les mêmes, de chair ou de métal. Les mots, d’acier inoxydable. Le cercle éclate de tout bord. N’existe plus que ce qui ne se dit pas.
Les verbes seuls, p. 54.
Mais pour toi, ma petite fille, c’est pas vraiment nécessaire que t’aies des lunettes, tu vas t’habituer. J’ai même lu que c’est mieux de faire des exercices avec les yeux. Si tu portais des lunettes, tes yeux viendraient paresseux.
Je retorque que mes frères ont pourtant des lunettes depuis longtemps.
Sois pas si négative, me dit-elle. Et elle enchaîne en m’expliquant que les gars, c’est pas pareil. Ils ont l’air plus sérieux avec des lunettes. Les filles, c’est mieux pas de lunettes. Tu sauras plus tard, c’est moins pratique pour les filles. C’est vraiment pas joli avec des bijoux, avec des boucles d’oreilles surtout. Ça fait trop.
La fille de la famille, p. 85.











