Né à Montréal en 1954, Jean-Marc Lefebvre est un artisan relieur et un poète. Il a fait paraître tous ses livres aux Éditions du Noroît.
Rencontre avec un poète sensible à la lumière discrète du quotidien et pour qui le langage est une habitation du monde, un lieu de présence à soi et aux autres.
Michel Pleau : Qu’est-ce qui est à l’origine de votre désir d’écrire ? Et pourquoi de la poésie ?
Jean-Marc Lefebvre : Écrire a d’abord été un jeu. Je m’assoyais sur les marches de bois menant au sous-sol de la maison familiale avec un crayon à mine et un cahier, et je commençais à écrire, c’est-à-dire que je couvrais de signes que moi seul pouvais lire et comprendre chaque page, un jeu qui répondait sans doute au besoin d’exprimer ce que je portais en silence. Que je ne pouvais dire à mes parents. Petites jalousies, sentiment d’injustice, petites blessures mais ressenties profondément, etc. Cette notion de blessure. Déjà. Même enfant, je parle ici de trois ans, puisque j’ai commencé l’école à quatre ans ; je me sentais seul, j’avais pourtant déjà une sœur aînée et un jeune frère. Écrire voulait dire quelque chose pour moi.
 Je regarde cela avec tendresse aujourd’hui. Je jouais aussi au cowboy, à embêter ma sœur et à me chicaner avec mon frère. Puis j’ai eu deux autres frères et une petite sœur et, curieusement, le sentiment de solitude s’est accru.
Je regarde cela avec tendresse aujourd’hui. Je jouais aussi au cowboy, à embêter ma sœur et à me chicaner avec mon frère. Puis j’ai eu deux autres frères et une petite sœur et, curieusement, le sentiment de solitude s’est accru.
Mon premier contact avec la poésie s’est fait au secondaire, au cours classique. Un de nos professeurs, l’abbé Tougas, nous a mis en contact avec la poésie de nos chansonniers avant d’enchaîner avec Nelligan, Baudelaire, Rimbaud, Villon, etc.
Cela a installé quelque chose d’un peu ténébreux en moi, qui s’exprimait par des périodes de silence qui ne m’effrayaient pas mais créaient une forme de distance avec mes camarades. J’écrivais alors un poème, pour moi, comme une façon de cristalliser un moment.
Beaucoup plus tard – j’avais alors 28 ans, un jeune fils à accompagner et une vie amoureuse tourmentée –, j’ai perdu tous mes repères et me suis engagé dans une thérapie. Jean, mon thérapeute, m’a reconduit à la poésie à travers cette urgence brûlante de vivre qu’il a nommée sensibilité. La poésie a alors incarné cette sensibilité, lui donnant un lieu, le poème, un lieu possible de réalisation de soi.
M. P. : Vous êtes un artisan relieur. J’imagine que le livre est une présence importante dans votre vie ?
J.-M. L. : Je suis devenu artisan relieur à la suite d’un accident de travail, blessure au dos. J’avais travaillé quelques années en construction, dans des usines également. Je savais que j’aimais le travail manuel, entre autres pour le repos de l’esprit qu’il induit ; à la fin de la journée, on peut mesurer d’un coup d’œil le travail accompli. M’appuyant sur le protocole de retour au travail établi par la CSST, j’ai pu bénéficier d’un an de cours et avoir accès à une formation en reliure artisanale dans un atelier privé. Par un de ces bonheurs qui arrivent quand on ne les attend pas, j’y ai rencontré celle qui allait devenir mon amoureuse et qui partage ma vie depuis. Pour répondre plus précisément à la question, le livre est une présence essentielle dans ma vie. Une journée sans lire est quelque chose d’impensable. Et apprendre comment est fait un livre, pouvoir le défaire, le réparer, lui faire une nouvelle couverture, lui donner une nouvelle vie est quelque chose de profondément satisfaisant.
M. P. : Dans Les ombres lasses, vous dites : « une autre forme / donnée au quotidien // un poème », et dans Illuminer les cendres, vous écrivez : « écrire chaque jour sa vie entière ». La vie au quotidien occupe une place centrale dans vos poèmes, n’est-ce pas ?
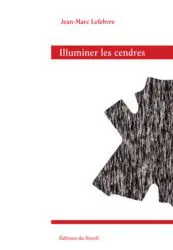 J.-M. L. : Cette correspondance entre la vie intérieure et le quotidien, par une espèce de saisissement de ce qui nous semble banal tellement c’est juste là, sous nos yeux, s’est affirmée au fil d’années d’écriture. « Voir autrement », écrivait le poète Michel van Schendel. Je n’aime rien tant qu’arriver à identifier, grâce à l’écriture, puis à exprimer ce qui m’habite en passant par le réel, traverser le paysage, suivre une émotion. Le paysage, c’est ce qui nous entoure et nous contient, c’est là où on est, où on passe, et c’est aussi le souvenir, un monde intérieur, tout cela nous constitue.
J.-M. L. : Cette correspondance entre la vie intérieure et le quotidien, par une espèce de saisissement de ce qui nous semble banal tellement c’est juste là, sous nos yeux, s’est affirmée au fil d’années d’écriture. « Voir autrement », écrivait le poète Michel van Schendel. Je n’aime rien tant qu’arriver à identifier, grâce à l’écriture, puis à exprimer ce qui m’habite en passant par le réel, traverser le paysage, suivre une émotion. Le paysage, c’est ce qui nous entoure et nous contient, c’est là où on est, où on passe, et c’est aussi le souvenir, un monde intérieur, tout cela nous constitue.
Et puis, écrire chaque jour, ou du moins y penser, car lire chaque jour est une forme d’écriture. Quand je lis un poème, j’entre en relation avec le texte et le fais mien ; c’est alors toute ma vie qui est portée par l’écriture. J’ai constamment cette présence, cet élan, ce désir : écrire. Chaque poème devient alors une vie entière.
M. P. : Dans Les ombres lasses, on retrouve ces vers : « Ce que j’écris / est cette quête d’un homme / qu’aucun oiseau ne peut porter ». Quelle est cette quête ?
J.-M. L. : Cette quête, je l’ai cernée lors d’un travail de mise à jour qui a duré une dizaine d’années, qui correspond grosso modo au passage des automatismes de l’enfance à une version assumée, consciente, de ce que je voulais être dans le monde. Il me fallait trouver puis donner un sens non pas à la vie, mais à ce que je vivais, qui ressemblait à un certain moment à l’idée qu’on peut se faire d’un désastre. J’ai alors fait un travail sur les valeurs, qui m’a mené à me fixer un but qui vaille la peine qu’on y consacre une vie. Ce but est devenu l’objet de ma quête et l’écriture, un des outils nécessaires à la poursuite de cette quête. L’écriture a pris la forme du poème, qui me permettait et me permet toujours le vacillement, dans une approche intuitive et sensible du réel.
M. P. : Vous publiez très régulièrement des poèmes inédits sur votre page Facebook. Est-ce que cela a changé un peu votre écriture ?
 J.-M. L. : Quand j’ai commencé à publier mes textes sur Facebook, c’était dans une certaine mesure le même sentiment que lorsque j’envoyais un recueil à un éditeur. Joie et appréhension. Ce que je ressentais alors : une forme de libération de la structure du recueil, la possibilité de partager tout en mettant à distance ce que je vivais, un certain retour sur le texte, sachant que d’autres yeux, d’autres sensibilités s’y posent. Publier sur Facebook, ne pas suivre le long processus qui mène à la publication d’un recueil, c’est faire de chaque jour, de chaque poème, un tout qui se tient et se prolonge. C’est encore le cas aujourd’hui, le même sentiment, la même satisfaction sans le rendez-vous du livre. Très rapidement, je me suis rendu compte que des gens de tout horizon, souvent que je ne connaissais pas, venaient lire, laissaient une trace et même commentaient le texte. Donnaient une appréciation. Il y a là quelque chose de direct. Quand une personne laisse un poème sur Facebook, je ressens une gratitude. Quelque chose se passe. Autre chose que la publication d’un recueil, un tout achevé, mais un rendez-vous quand même, comme un accompagnement dans l’écriture qui trouve sa place, son rythme dans la traversée des jours et du silence.
J.-M. L. : Quand j’ai commencé à publier mes textes sur Facebook, c’était dans une certaine mesure le même sentiment que lorsque j’envoyais un recueil à un éditeur. Joie et appréhension. Ce que je ressentais alors : une forme de libération de la structure du recueil, la possibilité de partager tout en mettant à distance ce que je vivais, un certain retour sur le texte, sachant que d’autres yeux, d’autres sensibilités s’y posent. Publier sur Facebook, ne pas suivre le long processus qui mène à la publication d’un recueil, c’est faire de chaque jour, de chaque poème, un tout qui se tient et se prolonge. C’est encore le cas aujourd’hui, le même sentiment, la même satisfaction sans le rendez-vous du livre. Très rapidement, je me suis rendu compte que des gens de tout horizon, souvent que je ne connaissais pas, venaient lire, laissaient une trace et même commentaient le texte. Donnaient une appréciation. Il y a là quelque chose de direct. Quand une personne laisse un poème sur Facebook, je ressens une gratitude. Quelque chose se passe. Autre chose que la publication d’un recueil, un tout achevé, mais un rendez-vous quand même, comme un accompagnement dans l’écriture qui trouve sa place, son rythme dans la traversée des jours et du silence.
M. P. : Parlez-nous des poètes que vous aimez. Votre bibliothèque intérieure.
J.-M. L. : J’aurais tendance à fuir cette question, mais pour dire simplement, et maintenant que j’ai vieilli, je me rends compte que me touchent particulièrement les poèmes discrets, qui témoignent d’un silence et d’une solitude assumés, à la fois paisibles et forts, humbles, foisonnants ou épurés, foudroyants parfois.
J’ai donc commencé plus ou moins à lire par moi-même les poètes vers la fin des années 1980, et, pour n’oublier personne en chemin, disons que toutes mes lectures et tous ces poèmes ont fini par former un choral assez bien équilibré de voix d’hommes et de femmes, qui m’accompagnent et avec lesquelles je suis en relation quand je marche, quand j’écris, quand j’entre dans le silence. Il y a des poèmes qui me donnent envie d’écrire. Écrire cela d’un poème est le plus bel hommage que je puisse lui rendre.
M. P. : Et si vous aviez à définir la poésie ?
J.-M. L. : Ma réponse à cette question ne pourra être que personnelle. Pour moi, la poésie est un lieu. Un lieu où je m’exerce à être.
M. P. : Dans notre monde où l’actualité nous fait entendre la fin de tout, comment entrevoir l’avenir de la poésie ?
J.-M. L. : Elle est et sera toujours un art du quotidien, qui cherche à s’affranchir de ce qu’elle connaît pour s’aventurer, aller vers ce qui n’est pas encore nommé. Elle est une espérance et, comme toute espérance, bien que vacillante, elle ne peut que produire une lumière sur la nuit, rendre les ombres un peu plus lumineuses. Je n’aime rien tant que découvrir un auteur, une autrice qui ont échappé aux projecteurs, cela me rassure sur la force du poème à survivre à l’oubli.
Jean-Marc Lefebvre a publié au Noroît les recueils suivants :
Le chemin des vocables, 1997, 71 p.
La tentation des armures, 2001, 77 p.
Les ombres lasses, 2005, 72 p.
Illuminer les cendres, 2012, 77 p.
EXTRAITS
L’ombre rassurée
n’interroge plus le monde
Je laisse au souvenir
le désir de la fuite
Ne me traverse plus
que ce que j’abandonne
Quand chaque parole
aura bu son image
serons-nous
cette lumière tant cherchée
Les ombres lasses, p. 35.
j’écoute ce que je tais
une écriture de veille
j’aborde les images
comme si je les quittais
Illuminer les cendres, p. 45.
j’implore la lumière
des choses sans importance
La tentation des armures, p. 11.











