En dix ans à peine, Judy Quinn a publié sept ouvrages, tant de poésie que de fiction narrative, pour lesquels elle a reçu des prix importants. Avec la constance de la marcheuse de fond, celle qui est aussi une collaboratrice de longue date de Nuit blanche construit une œuvre aussi forte que sensible dont les nombreuses ramifications s’entrecroisent et forment une trame riche, à la fois introspective et ouverte sur le monde.
Pour cette entrevue, j’ai proposé à Judy une rencontre virtuelle à travers un échange de courriels. L’idée vient de L’écriture comme un couteau, un livre d’entretiens entre Annie Ernaux et Frédéric-Yves Jeannet paru en 2003. Ernaux y écrit avoir apprécié « prendre le temps d’apprivoiser cet espace, de faire surgir du vide ce [qu’elle]pense, cherche, éprouve quand [elle] écri[t]– ou tente d’écrire – mais qui est absent quand [elle]n’écri[t]pas1».
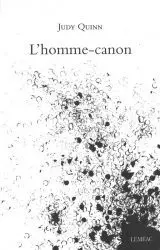 Cette démarche a porté fruit, malgré son aspect à première vue paradoxal : nous ne nous étions jamais rencontrés, jamais parlé et, pourtant, j’avais l’impression de connaître Judy déjà en partie, de reconnaître à travers ses romans et sa poésie certains motifs, certaines préoccupations, des enjeux humains récurrents. Le « matériau biographique » dont se nourrit son œuvre, pour reprendre les propos du communiqué qui accompagne L’homme-canon2, son plus récent roman, contribue sans aucun doute à cet effet, mais il n’y a pas que cela. Les aspects de sa propre vie que le lecteur peut projeter ou retrouver sur l’écran du cyclorama que façonne l’auteure à travers son cycle poétique et ses œuvres narratives y sont pour beaucoup dans cette impression : les lieux et l’époque sont reconnaissables, les marques de la quotidienneté sont les mêmes, les aspirations et les doutes, en partage.
Cette démarche a porté fruit, malgré son aspect à première vue paradoxal : nous ne nous étions jamais rencontrés, jamais parlé et, pourtant, j’avais l’impression de connaître Judy déjà en partie, de reconnaître à travers ses romans et sa poésie certains motifs, certaines préoccupations, des enjeux humains récurrents. Le « matériau biographique » dont se nourrit son œuvre, pour reprendre les propos du communiqué qui accompagne L’homme-canon2, son plus récent roman, contribue sans aucun doute à cet effet, mais il n’y a pas que cela. Les aspects de sa propre vie que le lecteur peut projeter ou retrouver sur l’écran du cyclorama que façonne l’auteure à travers son cycle poétique et ses œuvres narratives y sont pour beaucoup dans cette impression : les lieux et l’époque sont reconnaissables, les marques de la quotidienneté sont les mêmes, les aspirations et les doutes, en partage.
Le souvenir comme moteur de création
On le constate à la lecture, des éléments tirés de ta vie ou de celle de tes proches servent de point de départ ou de points d’ancrage à la plupart de tes ouvrages ; après Hunter s’est laissé couler qui reprenait des pans de la vie de ton grand-père, L’homme-canon emprunte sa trame à la fin de la vie de ton père, laquelle fut marquée par un gain important à la loterie et par la maladie qui aura finalement raison de son étonnante capacité de résilience. Selon toi, qu’est-ce que le fait de s’appuyer ainsi sur des faits véritables apporte à l’écriture de fiction ?
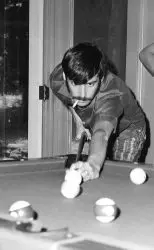
Dans une entrevue, peut-être dans L’écriture comme un couteau justement, Annie Ernaux affirmait que s’il était possible à un témoin de retourner dans le passé, il verrait à quel point ses récits (La place, Une femme, etc.) relatent fidèlement ce qui a eu lieu. Je comprends cette fidélité aux faits. D’ailleurs, dans L’homme-canon, j’ai cherché à reproduire avec exactitude la dernière année de vie de mon père. Même après l’écriture de la première version, je ne savais pas encore s’il s’agissait d’un récit ou d’un roman. Si j’ai opté pour l’étiquette « roman », ce n’est pas pour vendre plus, mais parce que, contrairement à Annie Ernaux, je ne pense pas qu’on puisse être fidèle aux faits. D’abord, ces faits n’existent plus. Il n’y a que le présent. Et c’est toujours avec le « moi » présent qu’on lit le passé.
Il est vrai que vous partagez Ernaux et toi, chacune à sa manière, cette expérience, cette volonté de la restitution du réel ; Ernaux parle d’ailleurs de son travail d’inscription de l’intime dans le récit d’une époque comme d’une « auto-socio-biographie ». Reconnais-tu là un peu ta démarche ?
De façon spontanée, je répondrais non. Mais peut-être un peu. Cela se manifesterait surtout dans Pas de tombeau pour les lieux, où j’ai cherché à voir comment la banlieue a pu influencer mon rapport au monde. Mais ce n’est pas tout à fait une biographie au sens strict, puisque je me suis défendue d’écrire au « je ». L’homme-canon est le premier livre où je prends vraiment la parole. Je ne crois cependant pas en être le personnage principal. On pourrait parler d’une biographie en creux.
Que permet alors la fiction dans la relecture de ces faits biographiques… et comment éviter de « trahi[r] la vraie histoire », comme le reproche le père à sa fille dans le livre ?
Dans ce cas-ci, le travail du deuil, entre autres, a teinté mon souvenir. Et puis, en faisant de ces faits une histoire (chose, peut-être, qu’Annie Ernaux ne se permet pas), j’allais mythifier certains moments, en taire d’autres, en transformer. À cause de la maladie de mon père, qui a été amputé d’une partie de son cerveau, je me suis intéressée aux processus de la mémoire.
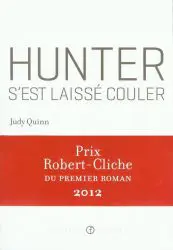 Dans le film d’animation Valse avec Bachird’Ari Folman, que j’ai vu à l’époque, un personnage relate une expérience. On présente à différentes personnes une photo d’elles enfants où on les voit chacune au milieu d’un parc d’attractions. Ces photos sont truquées ; elles n’y sont jamais allées. « Vous souvenez-vous de cette journée ? », leur demande-t-on. Certaines personnes répondent qu’elles ne se rappellent plus, mais que si, peut-être. D’autres sont catégoriques : non, elles n’en ont aucun souvenir. Quelques-unes reviennent au bout d’une semaine : oui, je me souviens très bien, c’était une journée ensoleillée, papa avait gagné au tir un ourson en peluche et me l’avait donné…
Dans le film d’animation Valse avec Bachird’Ari Folman, que j’ai vu à l’époque, un personnage relate une expérience. On présente à différentes personnes une photo d’elles enfants où on les voit chacune au milieu d’un parc d’attractions. Ces photos sont truquées ; elles n’y sont jamais allées. « Vous souvenez-vous de cette journée ? », leur demande-t-on. Certaines personnes répondent qu’elles ne se rappellent plus, mais que si, peut-être. D’autres sont catégoriques : non, elles n’en ont aucun souvenir. Quelques-unes reviennent au bout d’une semaine : oui, je me souviens très bien, c’était une journée ensoleillée, papa avait gagné au tir un ourson en peluche et me l’avait donné…

Mais il y a quand même des histoires plus vraies que d’autres. Si elles le sont ou du moins le paraissent, c’est plutôt à cause de leur accent de vérité. Cela a moins à voir avec les faits réels qu’avec le désir de l’auteur d’être le plus authentique possible. Par exemple, je considère Hunter s’est laissé couler comme un livre sur mon grand-père. Mais dans les faits, il n’y a rien de vrai. La fiction me semblait plus appropriée pour aborder la vie intime de cet homme qui s’en est toujours tenu devant les autres à une sorte d’impénétrabilité. Au fond, le but de l’écriture, ce serait de réchapper de l’oubli ce que ces êtres ont représenté, à défaut de les sauver.
Entre écriture narrative et poésie
Ton écriture poétique, d’une certaine manière, rend aussi compte du réel intime ou observable : Six heures vingt évoque la venue au monde de ta fille et explore le thème de la naissance, alors que Pas de tombeau pour les lieux prend racine dans un quartier de la grande banlieue de Québec qu’il est possible de reconnaître… Comment tes différents projets d’écriture adviennent-ils ? Comment trouves-tu la forme ou le genre qui convient à ce que tu veux dire ? Que permet la poésie que ne permet pas l’écriture narrative et vice versa ?
C’est une bonne question. Je crois que l’écriture répond à deux besoins : celui de raconter et celui de trouver un sens. Idéalement, j’aimerais que ces deux besoins se fondent dans un seul livre, hybride, mais pour l’instant ils prennent deux voies différentes. Bien sûr, dans les faits, ce n’est pas aussi tranché… Dans le cas de Pas de tombeau pour les lieux, il s’est passé quelque chose d’inhabituel. Après avoir lu le manuscrit, mon éditeur m’a dit qu’il semblait en manquer une partie. Je travaillais en parallèle sur L’homme-canon. J’avais écrit quelques poèmes sur la mort de mon père, mais je ne voulais pas les intégrer au recueil. J’avais des scrupules. Il n’y a rien de pire qu’un auteur qui se répète. Mais il y avait cet intense désir d’entrer dans cette disparition, ce que le roman ne permettait pas, parce qu’il était surtout, selon moi, un hommage à la vie. Et aussi parce qu’il s’en tenait à la ligne des événements, alors que j’aurais voulu, à un certain moment, la briser et creuser. Finalement, je suis entrée dans cette blessure, et en quelques semaines sont nés une vingtaine de poèmes que j’ai intégrés au recueil.
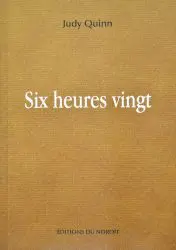
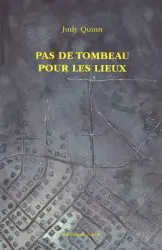 J’aime beaucoup cette expression que tu formules, « cet intense désir d’entrer dans la disparition »… peut-être en somme que la différence serait de cet ordre : le roman emprunterait une voix narrative, davantage architecturale, alors que la poésie, se faisant l’écho des enjeux plus intérieurs, se mettrait au service d’une seule et simple voix… qu’en penses-tu ?
J’aime beaucoup cette expression que tu formules, « cet intense désir d’entrer dans la disparition »… peut-être en somme que la différence serait de cet ordre : le roman emprunterait une voix narrative, davantage architecturale, alors que la poésie, se faisant l’écho des enjeux plus intérieurs, se mettrait au service d’une seule et simple voix… qu’en penses-tu ?
Ça me semble très juste. La voix narrative est déjà qualifiée, formatée avant même les premiers mots. Elle répond à des codes et le plus souvent se concrétise au fil de l’écriture. La voix en poésie est plus fondamentale. Au lieu de construire, elle déconstruit. Elle cherche ce qui la fonde, remet en question ses assises. Je trouve personnellement un équilibre dans le fait de revenir de temps en temps à l’histoire.
Le compagnonnage des arbres et des oiseaux
Qu’il s’agisse d’histoires racontées ou de poésie, des figures reviennent d’un ouvrage à l’autre, incontournables même lorsque leur présence est discrète ; on pense aux oiseaux, aux arbres surtout. L’émondé, ton premier livre, articule tout son propos autour de l’arbre – me reste en mémoire ce très beau poème : « certains deviennent des arbres / seulement pour nous / dire / nous faire et nous / sommes pour eux / comme des miroirs de bois ». Cet arbre, ou cet oiseau, que l’on retrouve ensuite dans tous tes livres, est-il là comme un fétiche, un témoin, un compagnon ? Que symbolise-t-il ? Quelle est son rôle dans ta démarche d’écriture ?
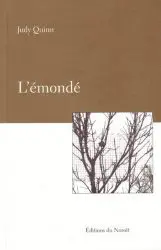 Je savais pour l’arbre. Mais pour l’oiseau, je ne m’en étais pas rendu compte! Il semble difficile d’être poète sans parler des oiseaux… En fait, cela a sans doute à voir avec ma façon d’écrire de la poésie. Au début du processus, j’ai l’habitude de m’asseoir devant une fenêtre et de regarder. Il y a toujours un arbre. Où que j’aie pu habiter, en ville, à la campagne, il y avait toujours au moins un arbre. Souvent des oiseaux. C’est toujours le même arbre que je regarde de jour en jour, mais aussi jamais le même. L’arbre, et l’oiseau, sont en quelque sorte des réceptacles où prennent forme mes questionnements sur le visible, l’intériorité, la mort, ce genre de choses. Après L’émondé, je croyais avoir tout dit sur les arbres, mais non. Ma perception de la réalité se transforme. Évidemment, l’arbre et l’oiseau ne sont pas que des réceptacles. J’ai une sorte d’amour pour ces êtres, qui représentent l’ultime altérité.
Je savais pour l’arbre. Mais pour l’oiseau, je ne m’en étais pas rendu compte! Il semble difficile d’être poète sans parler des oiseaux… En fait, cela a sans doute à voir avec ma façon d’écrire de la poésie. Au début du processus, j’ai l’habitude de m’asseoir devant une fenêtre et de regarder. Il y a toujours un arbre. Où que j’aie pu habiter, en ville, à la campagne, il y avait toujours au moins un arbre. Souvent des oiseaux. C’est toujours le même arbre que je regarde de jour en jour, mais aussi jamais le même. L’arbre, et l’oiseau, sont en quelque sorte des réceptacles où prennent forme mes questionnements sur le visible, l’intériorité, la mort, ce genre de choses. Après L’émondé, je croyais avoir tout dit sur les arbres, mais non. Ma perception de la réalité se transforme. Évidemment, l’arbre et l’oiseau ne sont pas que des réceptacles. J’ai une sorte d’amour pour ces êtres, qui représentent l’ultime altérité.
L’arbre et l’oiseau coexistent de tout temps ; l’oiseau fait son nid dans l’arbre et s’y pose, s’y repose; l’arbre élève ses branches vers le ciel, incapable pourtant de se détacher du sol… arbre-famille-enracinement versus oiseau-individu-liberté… cela a-t-il du sens ?

 L’arbre est une sorte de compagnon dans le présent, tandis que l’oiseau représente l’impossible et l’avenir. Il y a sans doute dans chacun de nous un tiraillement entre l’attrait du réel, qui se manifeste par la jouissance, l’amour, la famille, et une quête insensée d’absolu. Comme tu le dis, ils ne sont pas nécessairement séparés, ils se côtoient et essaient de coexister. J’aime à penser qu’un jour je ne dirai plus n’importe quoi sur eux, que je cesserai de m’attacher à mon petit monde intérieur pour entrer dans une véritable relation. Mais pour cela, il faudra peut-être que j’abandonne le langage.
L’arbre est une sorte de compagnon dans le présent, tandis que l’oiseau représente l’impossible et l’avenir. Il y a sans doute dans chacun de nous un tiraillement entre l’attrait du réel, qui se manifeste par la jouissance, l’amour, la famille, et une quête insensée d’absolu. Comme tu le dis, ils ne sont pas nécessairement séparés, ils se côtoient et essaient de coexister. J’aime à penser qu’un jour je ne dirai plus n’importe quoi sur eux, que je cesserai de m’attacher à mon petit monde intérieur pour entrer dans une véritable relation. Mais pour cela, il faudra peut-être que j’abandonne le langage.
1. Annie Ernaux et Frédéric-Yves Jeannet, L’écriture comme un couteau, coll. « Folio », no5304, Gallimard, 2011, p. 14.
2. Judy Quinn, L’homme-canon, Leméac, Montréal, 2018, 224 p. ; 24,95 $.
Judy Quinn a publié :
Poésie
L’émondé, Le Noroît, coll. « Initiale », 2008.
Six heures vingt, Le Noroît, 2010 – Prix littéraire Radio-Canada, catégorie poésie 2008.
Les damnés inflationnistes, Le Noroît, 2012 – Finaliste au Prix de poésie Estuaire – Bistro Leméac 2013.
Pas de tombeau pour les lieux, Le Noroît, 2017 – Finaliste au Prix du Gouverneur général, catégorie poésie 2017.
Romans
Hunter s’est laissé couler, l’Hexagone, 2012 – Prix Robert-Cliche 2012.
Les mains noires, Leméac, 2015.
L’homme-canon, Leméac, 2018.
EXTRAITS
Toutes ces histoires, c’est mon père qui me les a racontées. Voilà que je me retrouve seule avec elles. J’ai l’impression que mon unique nécessité est de les dire.
L’homme-canon, p. 221.
Les arbres se touchent
réagissent aux mouvements des autres
les mouvements récents sont encore invisibles
ou flous tandis que les premiers créent la forme
d’un arbre il en est de même
pour les ombres
sur le versant Nord des maisons
les enfants s’y balancent
allant du noir à la lumière
sans comprendre un seul maudit mot
pourtant ils ont peur
quand leur corps redescend.
Pas de tombeau pour les lieux, p. 15.











