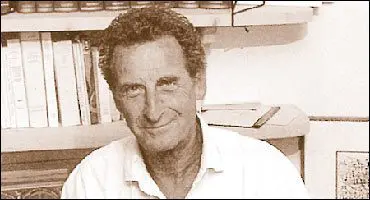Avant la biographie de Mitterrand, il y eut Jacques Rivière et la NRF que suivit de près Montaigne à cheval.
Jean Lacouture a rarement tracé le portrait de moins illustre que lui. Après de Gaulle, Mauriac, Malraux, Nasser, Mendès France, Blum, Hô Chi Minh, après les Jésuites, voilà qu’il consacrait en 1994 un livre à Jacques Rivière, celui que la mémoire culturelle a retenu souvent comme « le beau-frère de l’auteur du Grand Meaulnes ».
Nuit blanche : vous parlez dans votre livre des erreurs de jeunesse de Jacques Rivière. Vivait-il à une époque où il était plus facile de se les faire pardonner ?
Jean Lacouture : Nous vivons encore dans une ère de pardon. Quand on a beaucoup de talent, on se fait tout pardonner. Dans la littérature française, j’allais dire parisienne, on a, si on peut dire, « plusieurs chances à son arc ». Des gens ont fait, politiquement, intellectuellement, esthétiquement, des erreurs, et puis ils se rattrapent. Je ne crois pas que notre époque soit plus impitoyable que celle de Jacques Rivière. Tout simplement, nous vivons d’une façon un peu plus dangereuse à cause des micros, des caméras Les médias nous guettent plus qu’il y a soixante-dix ans.
Moi, on aurait pu me reprocher telle erreur politique par rapport au Vietnam, au Cambodge ou à l’Algérie. J’ai en tête plusieurs noms de personnes qui ont été plus ou moins compagnons de route du communisme, certains même du fascisme, et auxquels on a pardonné. Pensez à Céline qui a collaboré avec les Allemands, qui a été antisémite. On a fini par lui pardonner en raison de son génie littéraire. Il est respecté comme un des très grands écrivains français du siècle. Si Rivière avait vécu très vieux ou s’il avait vécu à une autre époque, il aurait eu droit à la parole malgré ses quelques erreurs.
Votre récit montre que Jacques Rivière a connu une évolution rapide. Il a des ferveurs imprévisibles, juvéniles, par exemple à l’égard de Claudel, puis, presque sans transition, il affiche un jugement si sûr que vous parlez de lui comme de la « rose des vents » littéraire.
J. L. : Rivière est un jeune homme au jugement très fin, mais qu’il pouvait modifier. Il était un admirateur intense de Maurice Barrès, puis il s’est détaché de Barrès. Le propre de l’intelligence, c’est d’être mobile. Il est tout à fait normal que les hommes n’aient pas compris le surréalisme à ses débuts. De même pour le cubisme. De même en politique. Quand Jules Romains parlait de la « grande lueur à l’est », il était normal que Gide voit dans le communisme un grand espoir de l’humanité. Puis Gide va voir en Union soviétique et change son opinion. Il a montré son intelligence et disons aussi au passage son courage.
Jacques Rivière est un homme mobile. D’une extraordinaire pénétration et d’une extraordinaire mobilité.
Ce qui vous a attiré chez Jacques Rivière, vous qui avez toujours étudié les « puissants », est-ce son pouvoir comme directeur de la Nouvelle Revue française (NRF) ?
J. L. : Je m’intéresse en effet au phénomène du pouvoir. Votre observation est donc juste. Mais, en me consacrant à Rivière, je n’ai guère pensé à ce phénomène. De fait, il a exercé un pouvoir, mais un pouvoir très démocratique, en ce sens qu’il est un jeune homme de 30 ans qui dirige un orchestre composé de grands solistes. S’il refuse un texte de Gide, s’il veut organiser un numéro de la revue sur tel sujet, il doit convaincre. Son pouvoir est équilibré par la gloire de ses partenaires. Je n’ai pas écrit mon livre dans la perspective du pouvoir, car, quand Jacques Rivière parle à Gide, à Claudel, à Proust, à Valéry, à Martin du Gard, d’une certaine façon il est le plus faible. Mais il a une telle sûreté de jugement, une telle puissance critique que sa faiblesse reprend par moments et assez souvent le dessus.
La vie de Jacques Rivière fut courte. Qu’aurait-il été à 50 ans ?
J. L. : Je n’arrive pas à le voir. Je crois qu’il se dirigeait vers ce qu’on pourrait appeler une sagesse classique. Son projet fondamental du moment était d’écrire un grand livre sur Racine qui est l’archétype du classicisme français, l’archétype d’une certaine attitude qui, à partir de la passion la plus profonde, va vers un contrôle esthétique de cette passion. Jacques Rivière, qui était lui-même mêlé à un certain nombre de passions quand il est mort, était en train d’inventer un contrôle esthétique sur elles. La domestication de son volcan.
Le proverbe dit : « On naît poète et on devient orateur ». Diriez-vous, en pensant à Rivière, qu’il est né critique et qu’il devint romancier ?
J. L. : Il n’est pas né romancier et il ne l’est pas devenu même si j’admire personnellement son petit récit autobiographique Aimée qui est à peine un vrai roman. D’ailleurs, la chose étonnante chez Rivière, c’est qu’il a écrit la théorie du roman d’aventures, qu’il prend pour modèles le roman anglais de Fielding ou le roman russe de Dostoïevski, c’est-à-dire des romans où on ne raisonne pas, où les êtres et les passions s’entrechoquent et où, comme dans le roman proustien, tout est imprévisible, et qu’il écrit lui-même un roman très sec, très classique et très prévisible. Il y a là une inconséquence que, personnellement, j’aime beaucoup : faire la théorie et réaliser le contraire !
Mais je dirais que Rivière est né critique. Dès les premières lettres à son cher Alain Fournier, il y a déjà un grand critique qui se manifeste. Il commet des erreurs, il rate James Joyce par exemple, mais dans l’ensemble ses choix sont heureux. Il a ce qui fait le grand critique, la capacité de s’immerger dans l’œuvre de l’autre et de prendre la distance photographique par rapport au sujet. Si Rivière avait vécu, je pense que son Racine aurait dépassé le Racine de Mauriac qui est pour moi la plus belle biographie que je connaisse.
Votre prochaine biographie, dit-on, va concerner un autre des grands « M » de Bordeaux Après Mauriac, Montaigne.
J. L. : Il y aurait aussi Montesquieu qui n’est pas non plus n’importe qui ! Mais Montaigne est quand même pour nous la référence fondamentale. Je voudrais écrire une très rapide vie de Montaigne et tracer son parcours public, hors de la tour où il a écrit ses Essais. Je voudrais le montrer en voyage, raconter ses activités politiques, diplomatiques, ses rapports avec Henri de Navarre, avec les catholiques et les protestants. Je voudrais écrire le portrait vivant et actif d’un maître de la tolérance à une période où le fanatisme était au moins aussi grand qu’aujourd’hui. Je n’inventerai rien sur Montaigne, mais on peut trouver un éclairage tel que tout à coup on révèle un aspect nouveau en reliant deux ou trois choses connues. Par exemple, la relation entre l’esprit méridional de Montaigne et le protestantisme français qui est essentiellement un phénomène méridional.
Qu’éprouvez-vous, après avoir rédigé une monumentale biographie de De Gaulle, en voyant Alain Peyrefitte en publier une nouvelle ?
J. L. : Il était normal que Peyrefitte le fasse. C’est un excellent écrivain et il a été très proche de De Gaulle. Je trouve élégant de sa part qu’il ait attendu trente ans avant de publier. Il m’a appris deux choses. D’une part, le grand intérêt du général pour les questions économiques. Cela je ne l’avais pas assez souligné. D’autre part, la tension qui a très tôt existé entre de Gaulle et Pompidou. Cela aussi est intéressant.
Vous avez débuté comme journaliste. En quel état est le journalisme actuel ? Est-il devenu une histoire trop immédiate ?
J. L. : Le journalisme d’aujourd’hui me paraît souffrir du syndrome du Watergate. On part d’un chef-d’œuvre d’enquête journalistique, mais on confond ensuite le journalisme et le travail policier. Je n’ai pas de mépris pour le travail policier, mais ce n’est pas la même chose. Dans mon cas, je dois avoir un dossier assez lourd à la préfecture de police de Paris en raison de mes rencontres de toutes natures, mais tout cela est discret. Les journalistes, eux, travaillent pour la publication. Sinon, pourquoi travaillent-ils ? Moi, ma doctrine est que toute vérité n’est pas bonne à dire. Quand Israéliens et Palestiniens se rencontraient secrètement à Oslo, il y avait là des vérités, mais les révéler aurait déclenché de part et d’autre des actions terroristes.
Je trouve donc répugnant que, pour faire de l’argent, un journal sorte l’histoire de la maîtresse de Mitterrand et de sa fille. Tout le monde savait cela. Je trouvais d’ailleurs assez élégant, assez conforme à une certaine tradition de notre presse, qui par ailleurs a beaucoup de défauts, qu’elle n’ait jamais traité de ces choses-là. Je suis également choqué de tout le déballage d’histoires autour de la famille royale anglaise. La famille de Monaco, c’est autre chose. Ça fait partie du standing de la principauté. C’est la vie privée, si l’on peut dire, qui est leur génie national ! Pas en Angleterre ni en France.
Quand ça touche à la conduite des affaires publiques, c’est autre chose. Quand Mitterrand aide un ami à obtenir un contrat, il y a quelque chose qui doit être révélé. S’il entretient des relations personnelles avec un homme qui était un criminel de guerre, c’est une erreur qui doit être sue. Mais étaler ses affaires sentimentales, sexuelles, paternelles, cela ne se fait, comme disent les Anglais, que dans une « presse à caniveau » et je regrette que nous ayons versé dans ce caniveau.
Est-ce à dire que vous n’auriez pas parlé de ces choses si vous aviez écrit une biographie de François Mitterrand ?
J. L. : Je ne sais pas. Les journalistes ont essentiellement affaire à un homme public ; un biographe, un essayiste, pour faire le portrait complet de quelqu’un, doit parler aussi du privé. J’ai eu des problèmes de cet ordre avec des hommes dont j’ai traité. Par exemple, à une certaine époque, le double ménage de Mendès France. Par exemple, le problème des tendances homosexuelles de François Mauriac ; je me suis longuement expliqué avec son fils et il m’a dit : « Non, vous ne pouvez pas ne pas traiter de cela. Si vous voulez expliquer mon père, vous ne pouvez pas ne pas dire qu’il a aimé les hommes. » Sa grandeur est peut-être de ne pas avoir passé à l’acte. S’il était passé à l’acte, après tout, moi, ça ne me gêne pas outre mesure, mais enfin c’est difficile à dire par rapport aux familles. Madame Mauriac était encore vivante. Si on me demande de refaire une nouvelle édition de mon livre sur Mauriac, peut-être que j’irai un peu plus loin dans le domaine. Mais nous sommes ici dans la biographie, non dans le journalisme.
Encore que même la politique est quelquefois conditionnée par tel ou tel rapport avec telle ou telle personne. Un homme, grand intellectuel français que je ne nommerai pas, a été l’un des premiers Français à s’intéresser vraiment au problème québécois parce qu’il avait une petite amie québécoise. Si j’écrivais un livre sur cette personne, je pense qu’il serait impossible de ne pas évoquer cette aventure ou cet amour.
Que lisez-vous pour le plaisir ?
J. L. : De tout. J’aime beaucoup les romans. J’aime beaucoup les biographies, les livres politiques. Je viens de lire le magnifique livre de Semprun, L’écriture et la vie, qui est un très beau récit autobiographique. J’aime beaucoup les correspondances, les journaux
Et quand lisez-vous ?
J. L. : Cela, c’est le problème. Beaucoup dans les transports en commun. Une fois la semaine, je fais en train l’aller retour entre Paris et la région d’Avignon. Quatre heures aller, quatre heures retour, on lit un livre, quelquefois deux. Je lis, mais j’écoute beaucoup la télévision. Je travaille aux heures très banales, comme un bureaucrate. Je m’y mets à 8 h 30 – 9 h 00, puis je m’arrête à midi et demi et je reprends à 3 – 4 h 00 jusqu’à 7 – 8 h 00. Quand j’ai travaillé beaucoup une journée, 8 ou 9 heures d’écriture, j’ai tendance à appuyer sur le bouton, à zapper. Je regarde trop la télévision, beaucoup le sport. Ça prend du temps. Par ailleurs, comme la télévision me déçoit pas mal actuellement, je lis davantage depuis six mois à peu près.
Vous devez avoir toujours deux ou trois ouvrages en chantier.
J. L. : Oui. Je termine des trucs que j’avais promis de faire : les textes d’un film sur Hô Chi Minh, un petit livre sur le Grand Théâtre de Bordeaux Je vais pouvoir bientôt me consacrer à Montaigne.
À propos de Rivière et de Proust
L’exemple le plus souvent cité du flair merveilleux grâce auquel Jacques Rivière dépistait talents et tendances, c’est celui de Marcel Proust. Sans Rivière, dit la légende, Proust n’aurait jamais abouti à la NRF, peut-être même n’aurait-il jamais été publié.
La vérité, qui n’enlève rien à Jacques Rivière, diffère de la légende. Dans sa biographie de Rivière1, Jean Lacouture fait voir que l’éditeur Gaston Gallimard, après avoir reçu une lettre bizarroïde de Proust (7 ou 8 novembre 1912), accepta quand même de le publier. Sans avoir lu le manuscrit et probablement parce que Proust s’offrait à tout payer. Jean Lacouture écrit : « On dit bien ‘Gaston’, et pas encore la NRF : car dans cette phase, l’éditeur semble avoir été seul ‘en piste’ – en avance sur les messieurs de la revue, directeur ou secrétaire ». Proust, imprévisible, se fait éditer par Grasset à compte d’auteur. Donc, il est faux que Gaston Gallimard ait refusé d’éditer Proust et il est vrai que Proust était assez riche (et têtu ) pour se faire éditer à ses frais.
À la NRF, rattachée à Gallimard, mais distincte de la maison d’édition, les choses se passent autrement. Pour des motifs que Jean Lacouture ne parvient pas à identifier, la décision de rejeter Proust est prise par le directeur de la NRF, Jacques Copeau, et par les membres du comité éditorial, sans que le secrétaire de la revue, Jacques Rivière, participe au débat. Pire encore, alors que Proust a envoyé son livre à Copeau, Suarès, Claudel, Gide, Thibaudet, Gallimard , c’est Ghéon, à qui il ne l’a pas expédié, « qui en rend compte […] dans La Nouvelle Revue, sans empressement et sans enthousiasme2 ». Proust est donc refroidi à l’égard de la NRF lorsque Gide, qui n’a pas encore lu le livre édité par Grasset, mais qui en voit le succès, offre à Proust de présenter ses prochains livres à la NRF. C’est là, explique Roger Duchêne, qu’entre en scène celui dont la NRF n’avait pas sollicité l’avis, son propre secrétaire Jacques Rivière. « On en serait resté à cet échange poli [entre Gide et Proust] si Jacques Rivière, secrétaire de la NRF depuis un an, n’avait acheté et lu le livre de Proust. Il l’a dévoré dans le train d’Angoulême à Paris au tout début de janvier, – sans pouvoir s’en arracher –. Il l’écrivit à sa femme, et à Proust dans une lettre perdue, qui le combla : – Enfin, lui répondit [Proust], je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction – […] Toute la lettre est une belle et précise profession de foi devant le lecteur idéal que Proust trouve enfin dans Rivière, désormais défenseur et serviteur inconditionnel de son œuvre. »
La reconstitution des faits est maintenant un peu plus assurée grâce au nombre et à la qualité des ouvrages qui éclairent cette période, les gens qui s’y fréquentaient, les idées qui s’y débattaient. Le volume de Jean Lacouture fait d’emblée partie de ces ouvrages éclairants. Celui de Roger Duchêne dont il vient d’être question tout autant. Il s’agit là, très probablement et même si le futur demeure imprévisible, de la biographie définitive de Proust. Tout y est, l’homme comme l’œuvre, la correspondance, le bilan financier, la comparaison critique des différents témoignages. Roger Duchêne liquide même par brassées les méchancetés proférées au sujet de Proust qui avait déjà assez de problèmes réels sans qu’on lui en invente.
D’autres ouvrages ajoutent un supplément de clarté. Ainsi, la Correspondance entre Jacques Rivière et Gaston Gallimard3. Un autre ouvrage, Alain-Fournier, Les chemins d’une vie4, reconstitue en beauté, grâce à une mise en page élaborée et à une iconographie sans rivale, le climat culturel et physique de l’époque.
1. Une adolescence du siècle, Jacques Rivière et la NRF, par Jean Lacouture, Seuil, Paris, 1994, 609 p. ; 49,95 $.
2. L’impossible Marcel Proust, par Roger Duchêne, Robert Laffont, Paris, 1994, 845 p. ; 59,95 $.
3. Correspondance, 1911-1924, par Jacques Rivière et Gaston Gallimard, Gallimard, Paris, 1994, 262 p. ; 49,95 $.
4. Alain-Fournier, Les chemins d’une vie, par Alain Rivière, Le Cherche midi, Paris, 1994, 127 p. ; 44,95 $.