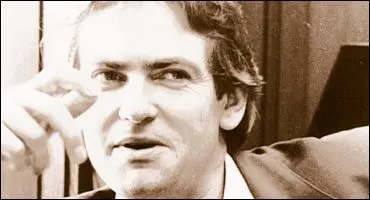À tout réussir du premier coup ou presque, Didier van Cauwelaert ne va-t-il pas bientôt manquer de défis ? Que pourra-t-il bien viser, et évidemment obtenir, après le Goncourt ?
La question, bête à souhait, vient quand même à l’esprit dès le premier regard sur le curriculum ou sur la photographie de l’auteur. Tout, en effet, sourit à ce monsieur. S’il touche au roman, les prix pleuvent. S’il tâte du théâtre, les planches, d’emblée, brûlent sous les pieds de ses interprètes. Comme si les difficultés ne pouvaient entamer une telle sérénité. Car Didier van Cauwelaert traverse l’existence en manifestant et en propageant à la ronde un humour qui ressemble agréablement au plaisir de vivre.
« Le sérieux affadit tout. Il fait de la mauvaise littérature. Je me vois plutôt dans la veine de Marcel Aymé ou d’Émile Ajar. »
Ces références sont éclairantes, car l’humour de van Cauwelaert, semblable à cet égard à celui de ces illustres prédécesseurs, désarme, attendrit, émeut. Loin de ridiculiser méchamment un personnage, cet humour crée des liens, presque de l’amitié, entre l’objet du sourire et celui qui sourit.
L’humour de Didier van Cauwelaert a-t-il en plus, conformément au « castigat ridendo mores » ou à la classique catharsis, un effet décapant ? Véhicule-t-il, discrètement, une critique sociale ?
– « J’écris des romans. Un aller simple1 n’est pas une analyse politique sur le thème de l’immigration. »
On prend acte. Qu’il soit cependant permis d’envisager que cette réponse, que van Cauwelaert répète d’entrevue en entrevue, – on le comprend puisque les questions sont toujours les mêmes – soit un anachronisme. Elle était juste ; elle l’est moins. Heureusement.
À ses débuts, en effet, Didier van Cauwelaert redoutait tant le dérapage de ses romans en direction des théories abstraites et ennuyeuses qu’il les faisait pirouetter au moindre indice de sérieux. Il en résultait des romans fantaisistes, désinvoltes, d’une légèreté parfois forcée et presque crispante. Vingt ans et des poussières2 racontait, avec une indéniable verve et beaucoup de tendresse, des destins aussi attachants qu’invraisemblables. Le style, déjà, était au rendez-vous, mais pas encore, du moins pas tout à fait, le projet sans lequel il n’est pas de grande œuvre. Autre exemple, Les vacances du fantôme3 constituait, lui aussi, un exercice de haute voltige. On demeurait dans un monde sympathique, entre les mains d’un maître de la désinvolture, de la formule ingénieuse, de l’esquive verbale. Jamais d’insistance, jamais d’appesantissement sur un sentiment. Tous et toutes traversaient la vie en dansant avec, à peine, à l’occasion, une crispation dans le sourire ou un ralenti dans la pirouette. Un objet en souffrance4 manifestait les mêmes qualités, mais dissimulait de plus en plus mal le côté futile de l’exercice. Était-on déjà au sommet atteint par Marcel Aymé, par Queneau, par Gary, par Pagnol ? On l’a beaucoup dit, mais, me semble-t-il, trop tôt.
Avec Cheyenne5, Didier van Cauwelaert, au lieu d’opposer farouchement humour et profondeur, légèreté et sentiment, tendresse et cohérence, roman et réflexion, accède à un amalgame. Style et projet se rejoignent. Il se montre toujours aussi vif à éviter les traquenards de la prose guindée et du style amidonné, mais il accepte désormais que s’expriment, à travers son humour et sa merveilleuse tendresse, des attachements définitifs et de grandes douleurs.
Un aller simple confirme que l’humour de Didier van Cauwelaert, qui lui servit peut-être d’alibi, est désormais compatible avec la profondeur. La fantaisie n’interdit plus l’incarnation. On se rapproche de Pagnol.
Mais si l’on enjambe
Sautons quatre ans et les ouvrages intermédiaires. À quel point de sa trajectoire retrouve-t-on Cauwelaert en 1998 ? Disons-le crûment, ces années, qui ont confirmé son art du « mot » et sa fidélité au thème des personnalités successives ou multiples, ont surtout profité aux manies de l’auteur. Corps étranger6 ramène le vertige schizophrénique qu’éprouvent depuis toujours les personnages de Cauwelaert : avoir deux vies, deux identités, se servir de la vie après la vie pour regarder la vie, examiner son propre dos, insérer vingt ans entre deux regards sur l’autre ou sur soi… Toutes formes de dissociation dont la récurrence ne choque pas, à condition que l’auteur se renouvelle et y investisse autre chose que son humour de collégien ou de théâtre d’été. Dans l’œuvre de Cauwelaert, le médiocre alterne avec l’excellent.
Corps étranger a ceci de particulier, et de particulièrement agaçant, qu’il abuse du clin d’œil artificiel et snobinard à la confrérie littéraire. Et que je fais une fleur à Bernard-Henri Lévy. Et que je salue Geneviève Dormann. Oh ! J’allais oublier Yves Berger. Et ce cher Philippe Labro… Non, vraiment non. Si l’humour est à ce point pesant, vite qu’on rameute le sérieux.
1. Un aller simple, Albin Michel, 1994, 208 p.
2. Vingt ans et des poussières, « Points », Seuil, 1985, 224 p.
3. Les vacances du fantôme, « Points », Seuil, 1988, 390 p.
4. Un objet en souffrance, Albin Michel, 1991, 272 p.
5. Cheyenne, Albin Michel, 1993, 201 p.
6. Corps étranger, Albin Michel, 1998, 428 p. ; 34,95 $.
Didier van Cauwelaert a publié, entre autres :
Vingt ans et des poussières, Prix de la Fondation del Duca, Seuil, 1982 et « Points Roman », Seuil, 1985 ; Poisson d’amour, Prix Roger-Nimier, Seuil, 1984 et « Points Roman », Seuil, 1986 ; Madame et ses flics, avec Richard Caron, Albin Michel, 1985 ; Les vacances du fantôme, Prix Gutenberg du Livre 1987, Seuil, 1986 et « Points Roman », Seuil, 1988 ; Le nègre, « Papiers », Actes Sud, 1986 ; L’astronome, Prix du jeune théâtre de l’Académie française, « Papiers », Actes Sud, 1986 ; L’orange amère, Seuil, 1988 ; Un objet en souffrance, Albin Michel, 1991 ; Cheyenne, Albin Michel, 1993 ; Un aller simple, Prix Goncourt 1994, Albin Michel, 1994 ; La vie interdite, Albin Michel, 1997 ; Corps étranger, Albin Michel, 1998.