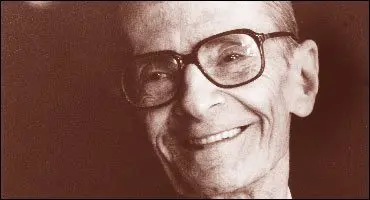La poésie est le seul genre littéraire authentiquement arabe. Elle fut naturellement un vecteur original d’expression de la culture libanaise et régna sans partage sur toute sa production littéraire pendant des décennies.
La plupart, sinon tous les romanciers, dramaturges et essayistes libanais furent « avant toute chose » des poètes.
Des précurseurs…
Les gens de lettres libanais qui s’installent à Paris pour échapper aux persécutions ottomanes et défendre la cause libanaise, s’assurent du même coup une plus large audience. « Cette littérature appelle d’emblée une triple remarque. D’abord, à aucun moment, les écrivains francophones de la première génération ne versent dans le discours idéologique proprement dit, c’est-à-dire n’utilisent leur talent pour occulter consciemment une partie de la réalité et manipuler délibérément les sentiments du public. Qu’elle soit critique ou poétique, leur écriture est scrupuleusement honnête. Ensuite les impératifs de la lutte les poussent à adopter, à côté des genres proprement littéraires – théâtre, poésie, roman – d’autres formes d’écriture d’une efficacité plus immédiate, comme la chronique journalistique, l’étude historique ou l’analyse politique1. »
La France est comme une patrie de substitution, restée dans la réalité et les mémoires la protectrice traditionnelle des chrétiens orientaux. Dans les collèges religieux, les élèves bénéficient d’une solide formation littéraire. Initiés aux chefs-d’œuvre classiques, rompus aux exigences de la rhétorique, les poètes en herbe taquinent la muse en français.
Les critiques s’accordent à penser que Chucri Ghanem est le pionnier de la littérature libanaise d’expression française. Avant de se consacrer au théâtre lyrique, Ghanem choisit la poésie. En 1890, il publie un recueil, Ronces et fleurs2, conçu selon les normes du classicisme. Les trois parties, « Ronces et fleurs », « Fleurs barbares » et « Fleurs fanées » abordent tour à tour des thèmes universels : l’amour, la fuite du temps, la nostalgie du passé Un Orient de carte postale, comme dans ce vers de Jean Béchara Dagher, « Là, tout invite au rêve, éveille un souvenir », scelle les œuvres de cette période.
Les critiques français sont élogieux ; les poètes libanais sont investis d’une mission : favoriser le dialogue avec l’Occident, lui révéler l’Orient, tout en initiant les Libanais à d’autres modes de vie et de pensée. Dans Rires et sanglots (1907) et Poèmes divers (1925) de Jacques Tabet, ce sont encore des envolées lyriques : « Ô mon idole sainte ! en prêtre fanatique / J’attendrai jusqu’au soir, sous ton sacré portique, / Dans l’extase, un bonheur qui ne viendra jamais ». Et puis, dans la seconde partie intitulée « Poèmes patriotiques », revient le leitmotiv de la fierté nationale, également cher à tous les auteurs : « Dans les souks populeux, d’Alep jusqu’au Hauran, / Où le limonadier choque ses bols et chante, / Des montagnes de fruits s’étalent et vous tentent / Par leur parfum et leur coloris éclatant ».
Une femme, May Ziadé, surtout connue pour son œuvre en langue arabe, annonce une plus grande liberté stylistique et fait figure de précurseur en publiant, sous le pseudonyme d’Isis Copia, un recueil en français intitulé Fleurs de rêve (1911) : « Liban, je rêve à tes cités, / À tes jardins peuplés de roses, / Aux appels de cœurs entêtés, / Murmurés par tes fleurs écloses3 ».
Si, à bien des égards, cette poésie semble désuète, elle impose des thèmes inédits dans la poésie arabe et révèle qu’il est possible d’exprimer dans une autre langue que l’arabe des faits culturels ; orientation dont se réclameront les poètes de la deuxième génération.
… aux chantres du « libanisme phénicien »
Avec la période du Mandat apparaît une thématique libano-phénicienne, liée à la réfutation d’une idéologie en vogue qui prône l’agrégation de tous les pays arabes en une seule et même nation. Nombreux sont les Libanais lettrés qui se réclament alors d’une origine distincte, phénicienne. Fondateurs de ports prospères, comme Arados (Rouad), Byblos (Jbail), Béryte (Beyrouth), Sidon (Saïda), Tyr et Ougarit, les Phéniciens avaient poussé leurs trirèmes jusqu’aux rivages de l’Espagne et de l’Afrique du Nord où ils avaient fondé au VIIIe s. av. J.-C. l’une des plus grandes cités de l’histoire, Carthage. Ils ont laissé dans la Békaa le site enchanteur de Baalbeck, admirablement préservé. On attribue à ce peuple ingénieux l’invention du premier alphabet connu, la fabrication du verre et de la pourpre, le développement de l’orfèvrerie et de la métallurgie. On se plaît aussi à rappeler leur faste, leur astuce et leur esprit marchand. Les chantres du libanisme phénicien en appellent à cet héritage prodigieux et flatteur, peu séduits d’être associés aux Arabes nationalistes de la région.
En 1920, Charles Corm fonde la Revue phénicienne qui réunit les plumes les plus prestigieuses de l’époque et a pour vocation de publier les œuvres des auteurs libanais d’expression française.
Charles Corm, Elie Tyane, Hector Klat, Michel Chiha vont exalter la gloire du Liban, rappelant les périodes fastes de son passé, soulignant les dangers encourus par la nation, exprimant l’inquiétude générale sur le sort de la patrie. Charles Corm publie La montagne inspirée4 (1934), au sous-titre évocateur « Chansons de geste », qui soulève l’enthousiasme de ses contemporains. Le premier cycle, Le dit de l’enthousiasme, est composé en 1920 à la suite de la proclamation du Grand-Liban, qui fait naître un grand espoir d’émancipation. À cet événement magnifié par la perspective de lendemains heureux, répond une fresque apocalyptique, Le dit de l’agonie (1932), qui montre un pays sombrant bientôt dans la corruption, les compromis et les vicissitudes politiques. Si l’on peste aussi contre la France qui rechigne à remplir ses engagements sur l’indépendance du pays, la grande Histoire est pourtant là pour témoigner de la vitalité d’un peuple dont l’auteur se plaît à énumérer les qualités dans la troisième partie, Le dit du souvenir : « Si je rappelle aux miens nos aïeux phéniciens / C’est qu’alors nous n’étions au fronton de l’histoire, / Avant de devenir musulmans ou chrétiens, / Qu’un même peuple uni dans une même gloire ».
On reprocha plus tard à Charles Corm un lyrisme quelque peu mièvre, la puérilité d’un récit qui accommode mal l’histoire à la légende. Mais le « chevalier du verbe » fit école. Il souleva par ailleurs dans La montagne inspirée le problème essentiel du langage qui convient le mieux à l’expression d’une identité culturelle : « Je sais pourtant qu’à Londres, à Paris et à Rome / Jamais nos écrivains n’auront droit de cité / Et qu’ils seront partout, d’autant plus qu’ils sont hommes, / Hors de l’humanité ».
Charles Corm est l’un des premiers à s’interroger sur le choix malaisé d’une langue d’« adoption » mais souligne ce qu’il croit être une dissension rédhibitoire entre l’âme libanaise et la langue arabe. Il est de ceux qui préfèrent, en dépit des écueils et d’une certaine frustration, se livrer « aux douceurs tyranniques du langage français ». « Or ces mots étrangers que nos enfants apprennent / Ne sont jamais pour nous tout à fait étrangers ».
Dans Le château merveilleux (1934), Elie Tyane esquisse le paysage libanais. On en voit les maisons ou les rochers : « Cependant on devine que c’est elle, / Ce cube posé là, comme un dé du destin5 ». « Sans doute ils sont les corps d’archanges écorchés, / De titans foudroyés, de griffons, de chimères / Et d’autres revenants d’un étrange bestiaire, / Ou, tombé de la lune, un escadron d’archers. »
Chez Hector Klat, l’évocation des lieux est plus éthérée : « Ehden, vous possédez les jours blonds, les soirs fauves / Et des nuits dont la lune argente le velours / Et ces aubes de nacre ineffablement mauves / Par qui s’agrafe aux nuits la tunique des jours6 ». L’amour de la patrie est indissociable de la sympathie pour la France, ainsi que l’exprime le titre symbolique choisi par Klat, Le cèdre et les lys (1935) : « Ah ! Que la douceur libanaise / S’allie à la grâce française / En un accord harmonieux ! »
Des générations de petits Libanais ont déclamé ces vers : « Mots français, mots du clair parler de doulce France ; / Mots que je n’appris tard que pour vous aimer mieux ».
Mais comment concilier deux héritages – l’arabe et l’occidental – si dissemblables ?
La spécification d’une identité culturelle se révèle problématique et Hector Klat, sensible à cette sensation d’écartèlement, lâche : « Ô mon cœur d’Orient, mon cœur de nostalgie ».
Michel Chiha, plus enclin à la pondération, distingue davantage les apports et les faiblesses des deux civilisations, égratignant au besoin la France : « Et sceptiques devant votre étonnante Histoire, / Que vous oubliez vite, ô Français inconstants !7 »
Rien que du très « classique », en somme, dans cette littérature : l’écriture reste conventionnelle et demeure étrangère aux bouleversements qui agitent la littérature française à la même époque. Pour justifier peut-être cette absence de prise de risque stylistique et estomper préventivement le doute, Hector Klat indique à propos de son poème « Les mots français » : « Peut-être n’est-il pas tout à fait inutile de préciser que ces vers sont de 1913. À cette date, les noms de Mallarmé, de la comtesse de Noailles, de Claudel étaient peu familiers à ces bords de la Méditerranée, et Valéry n’était pas encore Valéry ». Jean Cocteau, préfacier de son recueil, écrit comme pour le cautionner : « Je préfère n’importe quel poème en vers réguliers au désordre poétique, car la forme régulière oblige à une discipline qui s’approche de la méthode royale ».
Sans doute l’intérêt de ce mouvement ne réside-t-il pas dans son originalité formelle. Mais à vouloir que l’écriture devînt le moyen idéal de transmettre des messages à caractère politique, il initia une poésie cette fois réellement émancipée.
… jusqu’à l’avènement d’une nouvelle génération
La poésie, en rupture avec la prosodie traditionnelle, innove enfin dans la forme et dans la thématique. La seconde moitié du XXe siècle marque l’avènement d’une nouvelle ère et la naissance d’une poésie où il ne s’agit plus de versifier et d’imiter mais de parvenir à une expression originale. C’est surtout à travers un changement fondamental de la thématique que se dessinent les grandes lignes d’une nouvelle phase poétique proche du surréalisme, qu’il est cependant difficile de dater avec exactitude.
Georges Schéhadé
Chronologiquement, Georges Schéhadé appartient il est vrai à la même génération que Charles Corm, Élie Tyane ou Hector Klat. Poésies I est publié en 1938, Poésies II en 1948 et Poésies III en 1949. Mais là s’arrête la comparaison.
Les contraintes qui entravaient la création sont abolies : toutes les ressources du langage peuvent être éprouvées. Remarqué par Gabriel Bounnoure, fondateur de l’École des Lettres de Beyrouth qui l’encourage à se faire connaître en France, Georges Schéhadé envoie ses premiers poèmes à Saint-John Perse, qui les publie dans sa revue Commerce. Aussitôt arrivé en France, le jeune poète se lie à André Breton, à Paul Éluard, à René Char et à « l’ami Jules » Supervielle.
Les Poésies de Georges Schéhadé recèlent une certaine image de l’Orient. Mais débarrassée de tout folklore, l’évocation s’appuie sur une « rumeur, un parfum ». L’inclassable Saint-John Perse, à qui il fut souvent comparé, écrit de Schéhadé en 1953 : « Poète, qui l’est plus ? Qui l’est mieux ? […] De par cette grâce, ou cet ‘état de grâce’, dont il est fait mention dans le langage de toutes sectes. Poète jusqu’à se perdre lui-même dans le poème qui l’engendre. […] Il vous dira pourtant l’insurrection des roses, et l’invasion des astres méconnus. La ‘clairvoyance’ est son état, l’insoumission sa révérence. […] Écoutez Schéhadé vous parler du réel8 ».
Georges Schéhadé est un « découvreur de monde, enfoui au fond du souvenir et de l’imagination et qui ne demande pour renaître que la chance d’un cœur pur et le bonheur d’une chanson », selon les mots de Michel Corvin9. Si le poème relate un drame, celui-ci est exprimé avec douceur : « Si tu es belle comme les Mages de mon pays / Ô mon amour tu n’iras pas pleurer / Les soldats tués et leur ombre qui fuit la mort / – Pour nous la mort est une fleur de la pensée / Il faut rêver aux oiseaux qui voyagent / Entre le jour et la nuit comme une trace / Lorsque le soleil s’éloigne dans les arbres / Et fait de leurs feuillages une autre prairie / Ô mon amour / Nous avons les yeux bleus des prisonniers ».
André Breton rapporte que Schéhadé, présentant son premier livre Rodogune Sinne10, lui aurait confié : « J’étais alors pigeonnier de mots, de tourterelles j’étais plein de bourdonnements ». C’est en faisant une étude comparative que Pierre Robin11 a pu écrire : « Schéhadé est l’un des plus grands, des plus authentiques, parmi les poètes de notre temps ; et je suis heureux de me trouver d’accord avec les critiques aussi exigeants et aussi perspicaces qu’André Breton ou Gabriel Bounnoure, avec des poètes tels que Saint-John Perse, René Char ou Jules Supervielle. » En 1986, trois ans avant sa mort, l’Académie française décerna à ce moqueur désabusé le Prix de la francophonie pour l’ensemble de son œuvre.
Fouad Gabriel Naffah
Ceux des poètes qui restent fidèles aux vers traditionnels les manient souvent à la perfection, tel le subtil Fouad Gabriel Naffah qui est à classer parmi les « grands ». Né en 1925, il est l’auteur de cette élégante Description de l’homme, du cadre et de la lyre12. « Les évocations d’abord heureuses et rayonnantes du poème bientôt s’obscurcissent et prennent une ampleur inaccoutumée qui fait parfois ressembler certains textes de Naffah à ceux de son grand aîné Gérard de Nerval13. » Le raffinement de sa langue, la grâce de ses vers non rimés charment irrésistiblement : « Mon âme dépassant l’apparence de l’homme / Flotte un instant mêlée aux atomes de l’air / Avant de se couler dans le tronc du palmier / Avant d’accompagner le vol de l’hirondelle / Et de paître au soleil dans la peau du mouton / Pour déborder enfin sur toute la nature / Laissant ma chair intacte et l’enveloppe pleine / Je me sens devenir le porteur de la laine / Le désespoir vêtu de plumes dans le vent / Et l’arbre sot debout qui ne sait que verdir / Et même je me sens devenir le brin d’herbe / Le brin d’herbe poussé sur le bord du chemin / Et qui prenant mon âme habituée au luxe / L’incline et la présente aux crachats des passants / Alors qu’un dieu marin respire dans son vase / Et non diminué par ses épanchements / Jette sur le rivage un soupir d’abondance ».
Ainsi que l’écrit Georges Vigny14, Fouad Gabriel Naffah « dépasse les cadres libanais, déborde même les cadres habituels d’une poésie qui se réclame française. Le foyer est oriental, l’ambiance est européenne ; l’ensemble se veut universel, absolu ».
Entre le déchirement et l’espoir…
La nouvelle génération, après 1975, s’engage, résiste, témoigne, et évoque avec nostalgie ce qui n’est plus. Le tourment intérieur naît le plus souvent du déchirement entre l’affection et l’indignation qu’elle éprouve pour son pays. Les femmes sont alors les plus nombreuses à réagir.
Andrée Chédid
Andrée Chédid, née au Caire en 1921, établie à Paris depuis 1946, occupe, avec Georges Schéhadé, le premier rang des poètes libanais célèbres. Sa poésie porte en elle une angoisse dominée par des images de souffrance et de mort d’une douloureuse sincérité, même si des échappées joyeuses contribuent à imposer un espoir secret. « Tissée avec patience, cette œuvre est faite de mots simples, quotidiens, – clairsemés comme coquillages sur de larges plages de silence –, qui disent avec une sereine mélancolie les thèmes éternels de l’amour, du bonheur, du songe et de la destruction » (Les écrivains célèbres). Le thème de l’éloignement physique est omniprésent, comme en témoignent Textes pour la terre aimée, Terre et poésie et Terre regardée15. « Mon amertume se noie, si légère est sa trame ; / Si vaste est l’univers où tout s’accomplira. / Oui, je chante ô mort, jusqu’à l’ultime absence, / Gardienne de l’inconnu, douce prairie des errants. / Je chante, car ici-bas l’esprit échappe aux cendres ; / La parole délivre, l’aile trouve sa raison. / Un soir je m’en irai loin des terres chaleureuses ; / Le masque, couleur d’aube, sur ma face de vivant. / Un soir, je m’en irai, ayant pour seule peine, / De quitter tout amour enlacé aux saisons. / Ô mort, tu me viendras, et je le veux ainsi. »
Christiane Saleh et Nelly Gédéon
La poésie de Christiane Saleh est aussi empreinte de nostalgie, d’une mémoire qui ne retient qu’une impression d’ensemble : « Pays lointain / Toi dont j’ai perdu le nom / Parmi celui de toutes les mers16 ». La Méditerranée figure toujours, symboliquement, le lien entre la patrie d’élection et la terre d’origine : « Je reconnais de très loin / Le bruit de la mer / Toi que j’ai perdu / Au large des croisières / De la déraison. […] / Que de mers aveugles pourtant / Se partagent les yeux de la terre ». Dans Au rythme de l’instant, Nelly Gédéon chante dans un style qui oscille entre néoclassicisme et surréalisme un hymne à la beauté de son pays : « Ses sommets altiers te servent de diadème / Et la mer, dont la plainte, à tes pieds, meurt tout bas / En déroulant l’azur d’un onduleux poème, / N’est qu’un manteau royal étendu sous tes pas17 ».
Nadia Tuéni
La druze Nadia Tuéni sait séduire ses lecteurs par la remarquable audace des ruptures qui caractérise sa poésie et la spontanéité des mots qui entoure de mystère et de charme ses vers douloureux. Elle se mit à écrire après la mort de sa fille et dès Les textes blonds (1963), il s’agit bien pour elle d’exorciser la mort, le drame, l’absence : « Dans la paix d’un livre écrit à l’envers, nous cherchions nos racines ; / C’est dans le feu qu’enfin nous les avons trouvées18 ».
Le sentiment d’échec ou d’impuissance, l’amertume, la douleur constituent la trame de sa poésie, sans toutefois jamais atteindre à la désespérance. Quand le Liban commencera d’être ravagé par la guerre en 1975, Nadia Tuéni se fera le chantre de la réconciliation et de la pérennité du Liban. Sur un ton plus âpre que celui d’Andrée Chédid, Nadia Tuéni chante les mêmes thèmes, récurrents dansL’âge d’écume (1966), Juin et les mécréantes (1968), Poèmes pour une histoire (1972), Rêveur de terre (1977), Liban, 20 poèmes pour un amour (1979), les extraordinaires Archives sentimentales d’une guerre au Liban (1982) et La Terre arrêtée (1984) : « L’absence se fracture / en jardin hors, et dans l’espace ; / ton œil de quotidien, / détache son iris, et court, / bientôt rejoint par sa démence, / ouvrant à tous la porte basse des prophètes. / Et puisque l’air porte des mots, / Le cri articulé rebondit sur mes lèvres, / Avant de se noyer quelque part sous la lune. / O mon enfant-rivière, lourde de confluents, / Rafraîchis à rebours les parois de mes songes ».
S’il ne fallait retenir parmi tous ces poètes qu’un seul nom, ce serait celui de la bouleversante Nadia Tuéni, dont la gravité émeut et qui sut mieux que quiconque nous parler de douleur dans un pays qui n’en fut pas sevré : « Tout n’est beau que parce tout va mourir / Dans un instant. » Elle est morte pendant la guerre, à l’âge de quarante-huit ans. La Terre arrêtée, recueil posthume préfacé par Andrée Chédid, ne paraît qu’un an plus tard.
Elmira Chackal, Nohad El-Saad et Claire Gebeyli
La guerre fait rage, le Liban s’effrite. La crainte de la mort s’accompagne pour beaucoup du drame de l’exil : « Ils comprirent / Qu’ils devaient encore mourir plus d’une fois19 », écrit Vénus Khoury-Ghata, également romancière. Dans Terres stagnantes, on retrouve le thème de l’amour exalté, si typique de ses romans : « Tu parlais des portes que l’on rompt d’une seule main / Du lit étroit qu’on jette à la ferraille / Pour être libre, il faut un mot / Et nous les partagerons, sans les compter, sans les voir / Les étoiles ».
Elmira Chackal, d’origine italienne et Libanaise par alliance, trouve des vertus divines au langage poétique et évoque dans Mots en partance et Ciel à contre-jour la perspective heureuse d’une poésie salvatrice : « L’instant d’un poème / Est une éternité étanchée20 ».
Nohad Salameh
Nohad El-Saad, quant à elle, s’en tient à une conception désenchantée du monde : « Qu’attends-tu de l’écho ? / De la nuit ? / Le deuil est installé aux lisières des soirs ».
Claire Gebeyli, d’origine grecque, publie des recueils, Poésies latentes et La mise à jour21, Prix de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) en 1981, et en 1986 un choix de billets savoureux parus dans le quotidien L’Orient-Le jour auquel elle collabore, sous le titre Dialogue avec le feu22 : « Derrière une persienne, deux prunelles sans larmes. Une voix lointaine égrène des prières. Un chat déplace, anxieux, un lambeau de sa proie. Écrire pour Beyrouth ». Elle cherche toujours à comprendre les contradictions d’un pays tourmenté, et, animée d’une vocation de journaliste, à témoigner. « Ils ont mal à la terre quand ils courbent la tête / Les yeux en équilibre nus sur les rumeurs qu’ils cherchent à régir. » Les mots viennent au rythme de l’angoisse qui enfle et qui résume le drame original : « À qui revient cette terre ? »
Nohad Salameh, qui fut responsable du supplément littéraire du quotidien Le Réveil, où elle tint à merveille son rôle de découvreuse et d’évocatrice de talents, a signé L’écho des souffles, Lettres à ma muse et Folie, couleur de mer. Sur le sort du poète : « Je les enlace ces autres pour voir mon visage à la lueur parfumée de leurs regards. Je chois en eux, me ramifie dans le couloir de leurs tempes, et de leur agitation s’élèvera la poussière des lendemains ».
Salah Stétié, poète, critique, essayiste, ambassadeur du Liban auprès de l’Unesco, grand érudit, se démarque en nous offrant une poésie certes très hermétique, nourrie de visions oniriques et métaphysiques souvent difficiles à déchiffrer, où le langage constitue le principal défi lancé au lecteur. Dans une sorte de jeu ésotérique, Salah Stétié tente une création lexicale et sémantique originale, comme dans Porteurs de feu23 et Inversion de l’arbre et du silence24 (Prix Max Jacob). « Mais que d’images et que de métaphores ! La rose seule est plus limpide que ce fond noir ! La rose seule dit mieux l’amour, la farfelue, qui d’odeur nue masque le labyrinthe. De ‘car’ en ‘comme’ se descendent les escaliers de l’anxiété, loin des villages et loin des touffes douces : jusqu’à ce champ de pierres à perte d’âme, et ce croissant de mauve maléfique ».
Fouad El-Etr
Fouad El-Etr fait preuve d’une grande originalité syntaxique. Connu pour avoir fondé et dirigé la revue parisienne de poésie La Délirante, il publie en 1977 le recueil Comme une pieuvre que son encre efface ; la tristesse est là qu’allège parfois l’humour. « Elle avait l’épaisseur d’un zéro / Elle en avait le poids / Elle était sans mesure commune / Et sa bouche arrondie / Se disait une chose étonnante / Elle avait l’épaisseur d’un zéro / O25. » Le poète se distrait dans des jonglages de sonorités : « Nous libellulâmes / Libellulant, libellulée ».
Dès le début du XXe siècle, le Liban a été le théâtre de conflits et de bouleversements, et dans chaque phase critique de son histoire, les gens d’esprit, les poètes en particulier, n’ont jamais manqué à leur rôle d’avant-garde et à leur devoir de témoin. « Ceci fut un vivant, cette chose fut une personne », écrit Andrée Chédid dans Cérémonial de la violence26. Rien d’étonnant donc à ce que la poésie libanaise ait été avant tout une poésie d’engagement. Si le fait de remporter des prix littéraires n’a jamais suffi à garantir la valeur d’un auteur, le nombre étourdissant de poètes libanais consacrés par la meilleure critique donne néanmoins un indice de leur talent.
« *Le silence est la villégiature des mots ». Citation de Georges Schéhadé.
1. Analyse de Sélim Abou, spécialiste du bilinguisme au Liban, ancien doyen de la faculté des Lettres de l’université Saint-Joseph de Beyrouth : André Reboullet et M. Têtu, « Le Liban », Guide culturel, civilisations et littératures d’expression française, Hachette, Paris, 1977.
2. Chucri Ghanem, Écrits littéraires, Poésie, roman et théâtre, Dar An-Nahar, Beyrouth.
3. Isis Copia, Fleurs de rêve, 1911.
4. Charles Corm, La montagne inspirée, La Revue phénicienne, 1987.
5. Elie Tyane, Le château merveilleux.
6. Hector Klat, Le cèdre et les lys, La Revue phénicienne, Beyrouth, 1935.
7. Michel Chiha, La maison des champs, « À des amis français », La Revue phénicienne, Beyrouth, 1934.
8. St-John Perse, Poète Schéhadé, « La Pleiade », Gallimard, Paris, 1987.
9. Michel Corvin, directeur de l’École supérieure des Lettres de Beyrouth, Le théâtre nouveau en France, PUF, Paris, 1980.
10. Georges Schéhadé, Rodogune Sinne, Gallimard, Paris, 1947.
11. Pierre Robin, Poésie et théâtre de G. Schéhadé, Conférence du Cénacle libanais, 1957.
12. Fouad Gabriel Naffah, La description de l’homme, du cadre et de la lyre, Mercure de France, 1963, et Œuvres complètes, Dar An-Nahar, Beyrouth, 1987.
13. Les écrivains célèbres, Mazenod, Paris.
14. La revue du Liban, n°263, 1964.
15. Andrée Chédid, Textes pour la terre aimée, Gallimard, Paris, 1955 ; Terre et poésie, Gallimard, Paris, 1956 ; Terre regardée, Gallimard, Paris, 1957.
16. Christiane Saleh, Nuits parallèles.
17. Nelly Gédéon, Au rythme de l’instant, 1966.
18. Nadia Tuéni, « Poèmes pour une histoire », Les œuvres poétiques complètes, Dar An-Nahar, Beyrouth, 1993.
19. Vénus Khoury-Ghata, « Au Sud du silence », Anthologie personnelle, Actes sud, Arles, 1997.
20. Elmira Chackal, Mots de partance.
21. Claire Gebeyli, La mise à jour, ACCT, Paris, 1982.
22. Claire Gebeyli, Dialogue avec le feu, Du Pavé, Paris, 1986.
23. Salah Stétié, Porteurs de feu, Gallimard, Paris, 1972.
24. Salah Stétié, Inversion de l’arbre et du silence, Gallimard, Paris, 1980.
25. Fouad El-Etr, Comme une pieuvre que son encre efface, La Délirante, Paris, p. 37.
26. Andrée Chédid, Cérémonial de la violence, Flammarion, Paris, 1976.
LE PROPHÈTE GIBRAN
Khalil Gibran n’a jamais écrit en français ; il est pourtant le plus connu des gens de plume libanais. Maronite, né à Bécharé en 1883, il a émigré aux États-Unis avec sa famille en 1895, où il mourut trente-six ans plus tard. Son corps fut ramené au Liban ; il repose dans une crypte du monastère de Mar Sarkis à Bécharé. Personne ne sut évoquer, comme lui, en une harmonieuse narration, la rencontre fascinante de l’Orient et de l’Occident. Son œuvre maîtresse, Le prophète, écrite à l’origine en arabe (trois versions), puis retravaillée de nombreuses fois en anglais, qui fut traduite dans le monde entier et connut un succès planétaire, en est la plus parfaite illustration : « Je voulais être sûr que chaque mot fût vraiment le meilleur que j’eusse à offrir ». Gibran, tel un prophète de l’amour universel, est sans nul doute l’exemple le plus réussi d’un écrivain non pas partagé mais transcendé par son appartenance à deux cultures, qui parvint à acquérir une réputation mondiale en maniant indifféremment, et avec le même bonheur, deux langues aussi différentes que peuvent l’être l’arabe et l’anglais.
ADONIS (Ali Ahmad Saïd Esber)
Né dans un village situé sur les contreforts du djebel alaouite (l’actuel nord de la Syrie) Ali Ahmad Saïd Esber émigre à Beyrouth en 1956 où il demeurera jusqu’en 1985, avant de rejoindre Paris. Le choix du pseudonyme traduit sa volonté d’adopter de concert une tradition gréco-latine et une tradition arabe. Adonis a joué un rôle essentiel dans la modernisation de la poétique arabe. Fondateur de la revue Si‘r (poésie), remplacée par Mawäqif, il a offert une tribune d’expression originale et indépendante à ses contemporains. Considéré par beaucoup comme le plus grand poète arabe vivant, et le plus souvent comme un visionnaire, Adonis est un poète méditatif. Malgré l’immense succès des Chants de Mihyar le Damascène (Sindab, Paris, 1983), toutes ses œuvres ne sont pas encore traduites en français. Adonis le traducteur, lui, s’est pourtant chargé de faire passer en arabe les œuvres complètes de Schéhadé, une grande partie de l’œuvre de Saint-John Perse, l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy, de Mallarmé et de Rimbaud, et par le biais de ses revues, des pans entiers de la poésie française contemporaine. Un seul encore des dix ouvrages d’Adonis, l’éminent théoricien et critique, est disponible en français : Introduction à la poétique arabe (Sindab, Paris, 1985). « Le choix du poète est simple : ou être un agent, ou devenir une cible. À de très rares exceptions près, dans le monde arabe, il n’est pas possible de se tenir à l’écart. Dès que l’on use du langage, on se trouve impliqué, embrigadé ou contraint. Le verbe est encore sacralisé. Cela assure au poète, d’un côté honneur et audience, de l’autre, mise en tutelle. Pour la majorité des Arabes, la poésie s’apparente à une fonction qui a un rôle à jouer dans tous les domaines de la vie sociale, y compris politique »
(« Adonis, l’implacable », propos recueillis par A. Velter, Le Monde des Livres, 20 mai 1994).
LES PRIX LITTÉRAIRES
Les œuvres d’auteurs libanais ont été fréquemment louangées par la critique et récompensées par les académies.
1948 : Farjallah Haïk reçoit le Prix Rivarol pour Abou Nassif.
1966 : Andrée Chédid reçoit le Prix Louise-Labé.
1968 : le Prix de la Société des gens de lettres est attribué à Vénus Khoury-Ghata pour Terres stagnantes.
1972 : l’Aigle d’or est attribué à Andrée Chédid pour l’ensemble de son œuvre.
1980 : Les ombres et leurs cris de Vénus Khoury-Ghata reçoit le Prix Apollinaire. Claire Gebeyli obtient le Prix de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).
1993 : Le rocher de Tanios d’Amin Maalouf est le premier (et le seul à ce jour) Prix Goncourt décerné à un Libanais.
1995 : Salah Stétié reçoit le Grand Prix de la francophonie de l’Académie française dont le premier récipiendaire fut Georges Schéhadé.
Le Phénix de la littérature est le seul prix littéraire attribué au Liban. Il est revenu pour la première fois en 1996 à un essai de Ghassan Salamé, Appels d’empire (Fayard) et en 1999 au talentueux Dominique Eddé, Pourquoi il fait si sombre ?