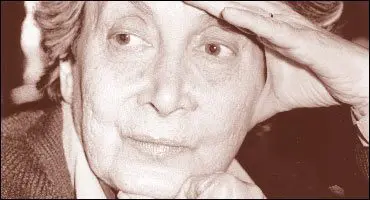Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que de timides tentatives suivent la Nahda, cette fameuse renaissance culturelle des lettres arabes initiée par les chrétiens. Rompant avec une tradition arabe riche en contes et en poèmes, les écrivains expérimentent un genre littéraire d’origine étrangère, le roman. Si la langue est française, l’inspiration, elle, est assurément orientale.
Évelyne Bustros, qui s’est beaucoup investie dans la vie culturelle de son pays, publie en 1926 un roman, La main d’Allah. « Une légende prétend qu’au début du monde, aucune terre n’était stérile. Les jardins fleurissant Damas étendaient leurs ombrages jusqu’à la Mecque. Dès que le monde fut peuplé, un ange déchu, que la miséricorde divine exilait pour cent ans, se fixa dans ces plaines avant d’y purger sa peine. » Il faut néanmoins concéder qu’avant 1940, le roman libanais est presque inexistant ; il ne devient genre usité qu’après la Seconde Guerre mondiale, même si, jusque-là, certains poètes ou dramaturges s’y sont essayés avec plus ou moins de bonheur.
Farjallah Haïk
Quand Abdallah Naaman analyse le cas de la littérature libanaise d’expression française, c’est sans complaisance aucune. « Mis à part les auteurs qui n’ont laissé qu’une ou deux œuvres minces (de valeur inégale), dix écrivains seulement peuvent être considérés réellement francophones. Deux (Schéhadé et Chédid), appartiennent définitivement à la littérature universelle et les deux sont et se veulent égyptiens d’origine syro-libanaise. Il est curieux de remarquer que d’autres ont vécu et produit en France […]. Leur production est donc métropolitaine1. » Le constat serait sévère s’il n’était dit par la suite : « Seul Farjallah Haïk semble avoir trouvé son chemin au Liban. C’est pourquoi il est à nos yeux l’auteur le plus représentatif de la littérature du terroir ». Né en 1909 à Beit Chahab, dans le Mont-Liban, Farjallah Haïk niche la fatalité au cœur de toutes ses œuvres. « Il y a une idée centrale dans tous mes romans. Je suis de ceux qui croient que l’être humain n’est pas libre, qu’une fatalité pèse sur lui Si nous étions libres, nous ne nous révolterions pas. Or, à chaque instant, l’être humain se révolte contre lui-même, contre le ciel, contre la société. La vie humaine est une perpétuelle révolte. C’est cet aspect de mon œuvre qui avait plu à Albert Camus à qui j’avais dédié L’envers de Caïn2, qui est le roman de la révolte, mon roman préféré. Qu’est-ce que la liberté ? On en parle tout le temps parce qu’on ne la connaît pas. Quel est son visage ? Elle est à conquérir Elle existe dans l’atmosphère. Nous nous en faisons peut-être une certaine idée comme celle que nous avons de Dieu ou du paradis. Comment voulez-vous que je devine ce que je peux devenir. Nous sommes esclaves de nos glandes, de nos hormones3. » Dans L’envers de Caïn, deux garçons illégitimes, Basile et Lazare, subissent dans un orphelinat un climat lourd et tendu. Le premier est robuste et agressif, le second est timide et chétif. En s’enfuyant tous les deux, ils scelleront leur destin commun, d’une noirceur inouïe. La violence des situations, la crudité des termes, la critique enfin d’un « système », l’aspect jugé blasphématoire des propos, ont choqué parfois. Mais la vraisemblance s’accompagne ici d’une sagacité qui ne laisse personne indifférent. « Noël est la fête des riches, disais-je à Lazare. Si Dieu existait réellement et veillait sur ses créatures, il devrait faire périr les riches. Tu vois un peu ce qui se passe ? Les uns crèvent la faim, les autres crèvent pour avoir trop mangé. Si Noël devait avoir un sens, ce serait celui de l’égalité de tous. Comme tout ce que je disais, cela choquait Lazare au point de lui faire trembler les narines. ‘Mais l’égalité n’est pas pour ce monde’, faisait-il de sa voix au timbre fêlé. – ‘Alors ? Si c’est pour l’autre monde, braillais-je, elle n’existe pas. Autrement, elle aurait eu le temps de montrer le bout de son nez’. – ‘Tu es un païen’, s’indignait Lazare. – ‘Le païen adorait en silence des dieux dont il ignorait tout. Nous autres chrétiens, notre Dieu, on l’a vu, on l’a palpé, on lui a inventé toute une histoire, tout un drame, et avec tout ça, on prétend qu’il a des desseins impénétrables. Foutaises ! petit Lazare. Imposture que les chefs religieux ont bien soin d’entretenir, de parfumer à la myrrhe et à l’encens’. » Le Liban est omniprésent, dans la description d’une rare acuité des sites mais surtout dans les savoureux proverbes arabes cités par Farjallah Haïk : « La main que tu ne peux mordre, baise-la et souhaite qu’elle se casse », qui se dit à celui qui doit plier devant ce qu’il ne peut affronter ; « Est-ce ton visage ou le clair de lune ? », que l’on adresse à une personne qu’on n’a pas vu depuis longtemps ; « Avoir le sang léger » pour « avoir de l’esprit » ; « Mettre son âme sur sa paume et foncer » pour signifier le courage ; ou encore « Il n’a pas de dos » pour dire qu’il n’a pas de protecteur. Hormis cet ouvrage, considéré comme son chef-d’œuvre, Farjallah Haïk a écrit d’autres romans : Barjoute (1940), Gofril le mage (1947), Al–Ghariba (1947), une trilogie Enfants de la terre (Abou–Nassif, 1948 ; La fille d’Allah, 1949 ; Le poison de la solitude, 1951) et cette dernière œuvre au titre astucieux, La croix et le croissant (1959), qui en appelle à une relation pacifique entre musulmans et chrétiens.
Vahe Katcha
Né en 1928, Vahe Katcha fut journaliste, romancier et cinéaste. Beaucoup de ses romans ont fait l’objet d’adaptations au cinéma, si bien que l’on ne saurait dire quel art, du romanesque ou du septième, a déteint sur l’autre : des chapitres brefs, des changements de ton (de plans ?) rapides, et l’intelligence des dialogues. Ril pour œil (1955) est caractéristique d’une œuvre dominée par l’obsession de la mort, de la vengeance et de la haine. Citons encore Les mégots du dimanche (1935), Pas de pitié pour les aveugles et Les cancéreux, L’hameçon, Le huitième jour du Seigneur4: « Marc vous a précédée dans un monde que nous ignorons. Mais ce monde invisible existe aussi vrai que l’air qui nous entoure, aussi vrai que le premier homme qui s’est couché près de la première femme et dont nous sommes les témoins. Je vous l’ai dit. Un jour nouveau commence pour Marc. Ni un lundi, ni un mardi, ni un dimanche. En quelque sorte, le huitième jour de la semaine. Et ce jour appartient au Seigneur ».
Andrée Chédid
La guerre qui ravage le Liban dès 1975 fait naître une nouvelle manière d’exprimer le dégoût d’un conflit morbide mais aussi la défiance à l’égard d’un peuple tour à tour violenté et galvanisé par la violence. Cette incompréhension se lit dans Cérémonial de la violence (1976) d’Andrée Chédid5 qui, peu de temps avant, psalmodiait encore tous les sortilèges du Liban. Elle a déjà acquis une réputation internationale et bénéficie d’une audience qu’il n’est point besoin de soutenir ici. Bien qu’installée à Paris bien avant le déclenchement de la guerre, elle sonde les infortunes qui ébranlent le pays des cèdres, comme en attestent quelques-uns de ses romans. La maison sans racines (1985) est la saga d’une famille libanaise, qui « incarne » le sentiment de déracinement vécu par l’ensemble de la diaspora. « L’enfant [est] multiple » (1988) quand il naît de l’union d’un musulman et d’une chrétienne. « Le sixième jour »6 est celui de l’espoir pour une vieille femme dont le petit-fils est atteint de choléra. « Ou bien on meurt, ou bien on ressuscite. » La savante maïeutique du livre pousse la vieille laveuse vers les rivages de la renaissance : la mer, thème chédidien omniprésent. Dans L’autre7, un vieil oriental (Simm) assiste un jeune étranger (Jeph) pour l’arracher à la mort, malgré les ironies, les obstacles que sont censés être l’âge, la langue, la culture et qui prohiberaient toute tentative de communication. Si Chédid est reconnue d’emblée comme poète, les critiques ont toutefois eu du mal à l’agréer aussi comme romancière. Il n’y a chez Andrée Chédid, dans son œuvre comme dans son comportement, aucune esbroufe, aucune frivolité mais en revanche une authentique ferveur. Elle s’interroge sur la condition humaine tout en gardant une foi profonde en l’homme. Elle écrit inlassablement, telle une scholiaste, des textes sur l’amour et atteint à la catalyse de ce qu’elle prêche sans renoncement. Si elle évoque la mort, c’est pour dire qu’elle est la certitude commune à tous les hommes ; « et si l’espoir meurt, c’est parce qu’il va renaître ». Elle se fait l’apôtre des êtres en marge, incompris ou qui souffrent, l’enfant et le vieillard, la femme : « Les humains m’absorbent. C’est les aimer que j’aime ». Le sentiment poétique est partout, qu’il faut susciter plus que décrire car l’écriture de Chédid est élégante, décente. Ne s’étant jamais considérée comme une exilée, elle confiera à un journaliste : « Je me sens d’ici autant que de là-bas. Paris est le lieu où j’ai vécu le plus longtemps. J’y suis venue parce que je le souhaitais, je n’ai donc pas la douleur de la nostalgie, le sentiment de l’exil. Et tout ce que j’ai d’Orient en moi n’a jamais été déformé par l’usage de la langue française. Je relève d’un pays sans fanion, sans amarres ».
Vénus Khoury-Ghata
La guerre, la mort, le déracinement imprègnent toutes les œuvres écrites après 1975. Vénus Khoury-Ghata semble vouloir s’en venger en les persiflant. « Pourquoi ce besoin incessant de parler de la mort ? Le mot ‘mort’ constitue la pierre d’angle des titres de mes livres. Vacarme pour une lune morte, Les morts n’ont pas d’ombre, Mortemaison, Monologue du mort Il faut remonter à l’année 1975 quand me parvenaient les images insoutenables d’un Liban noyé dans son sang. Les cadavres placés sur des planches de bois étaient lancés dans des fosses communes du même geste que le boulanger qui enfourne son pain. La mort : pain quotidien des Libanais8. » Le roman est ici « poétique » et se singularise par cette greffe de l’arabe sur le français, en particulier dans les succulents dialogues. À cette contribution linguistique, s’adjoint un « dépaysement » littéraire enrichi de superstitions inconnues en Occident, une sorte de décalage culturel qui fascine. Dans Vacarme pour une lune morte (1983), Khoury-Ghata relate l’horreur d’un conflit qui ravage un pays imaginaire, la Nabilie, mais nul n’ignore qu’il s’agit bien, en réalité, du Liban. Dans un de ses poèmes, elle évoquait déjà la guerre : « Ma mère qui se souvenait d’une mort estompée / Disait la lumière rétive / […] La maison était au bord d’une route comme au bord des larmes / Ses vitres prêtes à éclater en sanglots ». Chez Vénus Khoury-Ghata germe un humour, sardonique, qui semble vouloir tempérer les élans de la passion. Un authentique talent, aussi, car la romancière est douée de la faculté de saisir et de formuler l’irrationnel. Claire Gebeyli Avec Cantates pour un oiseau mort (1996)9, Claire Gebeyli raconte une longue saga familiale qui s’étend sur un siècle et qui revisite les thèmes de la religion et de l’exil. La poésie, selon elle immanente au monde, imprègne encore les romans. Quant à l’écriture, elle serait une veillée d’armes destinée à déchiffrer « la version neuve des signes » ; elle fixe le temps de la tragédie, elle l’absorbe, le transmue en un temps d’espoir.
Amin Maalouf
Amin Maalouf a quitté le Liban en 1976. Grand reporter pendant douze ans, ancien directeur de l’hebdomadaire libanais An-Nahar international puis rédacteur en chef de Jeune Afrique, il s’oriente très tôt en littérature vers des sujets historiques et commence par publier un essai, Les croisades vues par les Arabes10. Puis un roman, Léon l’Africain11, qui devait initialement être un essai, le fait connaître du grand public. Léon, c’est cet ambassadeur maghrébin, Hassan al Wazzan, capturé en 1518 par des pirates siciliens qui l’offrent à Léon X, le grand pape de la Renaissance, et qui deviendra le géographe Jean-Léon de Médicis. Le rocher de Tanios12, qui reçoit le Prix Goncourt en 1993, nous ramène au Liban, celui du XIXe siècle. Impossible de ne pas voir dans cette œuvre une allégorie du Liban moderne. Le rocher est une montagne qui gronde. Le héros du récit n’est pas tant Tanios, bâtard d’un seigneur local, que le pays lui-même. L’écriture-mélopée de Maalouf est apaisante, jusqu’à ce que la fin de chaque chapitre, dans un sursaut brutal, brise le rythme alangui, comme un accord de citharède. L’auteur sait nous offrir sur un plateau les douceurs d’une civilisation exquise, nous décrit et nous sert des pâtisseries au sirop de sucre ou le café agrémenté de cardamome ; là, tout invite à l’évasion. Mais les passions humaines se mêlent aux intérêts stratégiques dans une implacable logique orientale où s’affrontent sens de l’honneur, orgueil de préséance, jeux d’alliances. Faut-il servir la perfide Albion ou rallier les rêves panarabes de l’émir ? Après l’assassinat d’un patriarche maronite, Tanios sera contraint à l’exil et, perché sur un rocher, verra au loin un navire en partance pour Chypre, planche de salut pour nombre de chrétiens libanais. Les personnages d’Amin Maalouf sont tous des enfants de la Méditerranée ; et tous sont victimes d’un écartèlement, fût-il social, culturel ou politique.
Alexandre Najjar
Alexandre Najjar, jeune avocat, conseiller culturel du ministre de la Culture et de l’enseignement supérieur libanais, semble avoir suivi les traces d’Amin Maalouf en choisissant des thèmes historiques dans deux de ses plus récents romans, Les exilés du Caucase13 et L’astronome14 qui furent bien accueillis par la critique et surtout par les lecteurs. Si le style est élégant, il ne sacrifie rien à la rigueur documentaire. Établi à Beyrouth, c’est depuis son pays que l’auteur écrit et témoigne. « Par son stylo, Alexandre Najjar appartient à la légion de ceux qui travaillent à empêcher l’engloutissement spirituel et mental du Liban. Cette lutte mérite attention et respect, comme celle des combattants armés qui s’opposent à la disparition politique, à l »Étatcide’ de la République du cèdre15 ». Aussi, le thème de l’exil n’a pas droit de cité dans son œuvre. Dans La honte du survivant, la ténacité d’un regimbeur – qui n’a pratiquement connu son pays qu’en état de guerre – affleure, non dépourvue d’ailleurs d’une certaine malice :
« – De quel bord tu es ? dis-je tout à coup en m’en voulant de ne pas avoir posé cette question plus tôt. – Pour le Liban, répondit-il sans hésiter. – Quel Liban ? – Le Liban avec un ‘L’ majuscule, murmura-t-il sans sourciller avant de demander : Pourquoi, vous avez combien de Libans, vous autres ? »
Jeunes romanciers et francophonie
On pourrait encore citer, dans ce panorama, Jacqueline Massakbi et ses Mémoires de cèdres (1989), Elie Pierre Sabbag et L’ombre d’une ville (1993), Dominique Eddé avec sa très poignante Lettre posthume (1989), Georges Corm et La mue (1992), le père Mansour Labaky avec L’enfant du Liban (1986, Prix de l’académie des sciences morales et politiques) et Mon pays au passé simple (1992), Gérard Khoury et son Mémoire de l’aube, Désirée Azziz, Nazir Hamad, Sélim Nassib, ou encore Ghassan Fawaz avec Moi, volatiles des guerres perdues (1996). Le roman libanais, jeune, est en pleine croissance. Une constante apparaît néanmoins : les écrivains du Liban ont introduit, au sein de la francophonie, une sensibilité nouvelle et une imagination orientale, souvent inspirées par les déchirures de leur pays. Par leur parfaite maîtrise de la langue française, mise au service de leur attachement charnel et viscéral à leur nation, ils ont su donner chair à un syncrétisme littéraire original.
1. Abdallah Naaman, Le français au Liban, Maison Naaman pour la cuture, Jounieh, 1979.
2. Farjallah Haïk, L’envers de Caïn, Stock, Paris, 1955.
3. Entretien avec É. Massoud, La Revue du Liban, n°181, 1962.
4. Vahe Katcha, Le huitième jour du seigneur, Plon, Paris, 1960.
5. Andrée Chédid, Romans (Le sommeil délivré, Le sixième jour, Le survivant, L’autre, La cité fertile, Nefertiti et le rêve d’Akhnaton, Les marches de sable, La maison sans racines, L’enfant multiple), « Mille et une pages », Flammarion, Paris, 1998.
6. Adapté au cinéma par Youssef Chahine, en 1986, avec Dalida dans le rôle principal.
7. Adapté au cinéma par Bernard Giraudeau en 1990.
8. Vénus Khoury-Ghata, Anthologie personnelle, Actes Sud, Arles, 1997.
9. Claire Gebeyli, Cantate pour un oiseau mort, L’Harmattan, Paris, 1996.
10. Amin Maalouf, Les croisades vues par les Arabes, Lattès, Paris, 1983.
11. Amin Maalouf, Léon l’Africain, Lattès, Paris, 1992.
12. Amin Maalouf, Le rocher de Tanios, Grasset, Paris, 1993.
13. Alexandre Najjar, Les exilés du Caucase, Grasset, Paris, 1995.
14. Alexandre Najjar, L’astronome, Grasset, Paris, 1997.
15. Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Préface de La honte du survivant, Naaman, 1991.
La littérature libanaise francophone : ouvrages de référence :
Selim Abou, Le bilinguisme arabe-français au Liban, Presses Universitaires de France, Paris, 1962.
Ghaleb Ghanem, La poésie libanaise de langue française, Publications de l’Université libanaise, Beyrouth, 1981.
Saher Khalaf, Littérature libanaise de langue française, Naaman, Sherbrooke, 1973.
Georges Labaki, Bibliographie de la littérature libanaise d’expression française, Foyer franco-libanais, Paris, 1983.
Rachid Lahoue, La littérature libanaise de langue française, Imprimerie catholique, Beyrouth, 1945.
Abdallah Naaman, Le français au Liban, Essai socio-linguistique, Maison Naaman pour la Culture, Jounieh, 1979.
Maurice Sacre, Anthologie des auteurs libanais de langue française, Publications de l’UNESCO, Beyrouth, 1948.
Salah Stétié, Les porteurs de feu et autres essais, Gallimard, Paris, 1972.
Trois auteur(e)s d’origine libanaise vivant au Québec
Abla Farhoud a publié : Les filles du 5-10-15 ¢, Lansman, 1993 et 2000. Quand j’étais grande, Le bruit des autres, 1994. Jeux de patience, VLB, 1997. Quand le vautour danse, Lansman, 1997. Le bonheur a la queue glissante, L’Hexagone, 1998. Maudite machine, Trois-Pistoles, 1999. Splendide solitude, L’Hexagone, 2001.
Nadine Ltaif a publié : Les métamorphoses d’Ishtar, Guernica, 1987 et 1991. Entre les fleuves, Guernica, 1991. Elégies du levant, Le Noroît, 1995. Le livre des dunes, Le Noroît, 1999.
Wajdi Mouawad a publié : Alphonse, Leméac, 1996. Les mains d’Edwige au moment de la naissance, Leméac, 1999. Littoral, Actes Sud, 1999. Pacamambo, Actes Sud, 2000. Rêves, Actes Sud, 2002. Visage retrouvé, Actes Sud, 2002.