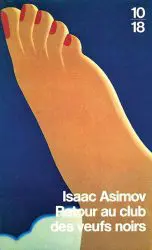Voici Isaac Asimov en territoire policier ou, plus précisément, en territoire d’énigmes. Dans chacune des soixante nouvelles du recueil Les Veufs Noirs1, ils seront six à scruter l’énigme que leur apporte un invité.
Le Club des Veufs Noirs comprend, en effet, six mâles fiers de leur célibat plus ou moins barbelé : 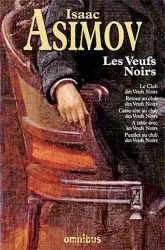 Avalon est avocat spécialiste des brevets, Rubin auteur de polars, Halsted professeur de mathématiques, Trumbull fonctionnaire des Services secrets, Drake spécialiste de la chimie organique, Gonzalo artiste au verbe et aux vêtements exubérants. Soixante fois le sextuor mordra la poussière, soixante fois l’énigme ne se dénouera qu’avec le concours du subtil Henry, serveur de son état, en qui, bien sûr, s’incarne Isaac Asimov.
Avalon est avocat spécialiste des brevets, Rubin auteur de polars, Halsted professeur de mathématiques, Trumbull fonctionnaire des Services secrets, Drake spécialiste de la chimie organique, Gonzalo artiste au verbe et aux vêtements exubérants. Soixante fois le sextuor mordra la poussière, soixante fois l’énigme ne se dénouera qu’avec le concours du subtil Henry, serveur de son état, en qui, bien sûr, s’incarne Isaac Asimov.
Rythme et réalisme
Chez Asimov, les savoirs n’empêchent pas la vie de s’exprimer avec fougue. La rigueur tournerait vite à la sécheresse si les six ego du Club des Veufs Noirs ne s’affrontaient pas avec un naturel incisif. Les repas, dont Henry, alias Asimov, renouvelle d’épisode en épisode le menu raffiné, n’ont rien de guindé ni même de cadastré. On se prend aux cheveux, on y va d’épithètes blessantes, puis on se calme et l’interrogatoire de l’invité prend le relais. Comme en robotique, Asimov édicte pourtant ses lois. Au Club des Veufs Noirs, les membres assument à tour de rôle les tâches de choisir l’invité, d’arbitrer les débats et… de payer la note. Autant de façons de varier le rythme et les références, de bannir les abstractions, d’accorder droit d’éruption aux complexes de chacun. Asimov, qui confère aux conversations de ses textes l’allant de ses conférences, profite ainsi de la vivacité du style oral.
« Simon Levy se tourna vers Avalon et lui dit :
– Y a-t-il des disputes tout le temps ici, Jeff ?
– Il y en a beaucoup, mais en général, on ne va pas jusqu’à parier et vérifier dans une encyclopédie, répondit Avalon. »
Soupçonnons Asimov, excellent conférencier et inimitable conteur d’anecdotes, d’avoir choisi le style le plus propice à l’étalage d’un autre de ses talents… Avec succès.
À peine en sol policier, Asimov tient à se comparer aux meilleurs auteurs de cette littérature. « En écrivant les récits des Veufs Noirs, écrit-
il, j’ai toujours eu l’impression de faire de mon mieux pour retrouver l’esprit d’Agatha Christie, qui est mon idole dans le domaine de la littérature policière. » Lorsqu’il soumet cet ambitieux parallèle à Martin Gardner, chroniqueur du Scientific American et dégustateur d’intrigues policières, celui-ci le contredit : « […] à son avis, j’étais complètement à côté. Ce que j’avais fait en réalité, c’était que j’avais retrouvé le ton des histoires du Père Brown de G. K. Chesterton ». Jugement qui n’a rien d’humiliant pour quiconque a savouré Les enquêtes du Père Brown (Omnibus, 2008). « Vous savez, enchaîne Asimov, il n’avait pas tort. J’étais un passionné de ces histoires, même si je trouvais la philosophie de Chesterton un peu irritante. » Rallions-nous au verdict de Gardner et durcissons-le quelque peu. D’une part, le ton plutôt suranné dont use Agatha Christie dans ses 87 romans policiers se compare difficilement au débit souvent caustique et trépidant d’Asimov ; Agatha Christie écrit d’ailleurs si peu de textes courts qu’il est malaisé de la citer en modèle au nouvelliste. D’autre part, même si, de fait, les récits du Club des Veufs Noirs évoquent les astuces du Père Brown, le reproche d’Asimov à l’adresse de Chesterton est largement immérité ; le journaliste Chesterton, converti depuis peu, tenait à ce que son enquêteur, bien que clerc, trouve toujours une explication strictement rationnelle aux plus opaques mystères criminels. Cela est patent, mais n’empêche pas le Père Brown d’aboutir à de meilleurs résultats que les six Veufs Noirs tout en affrontant des mystères plus courants.
Asimov et le polar
Doit-on s’étonner qu’Asimov, pape de la science-fiction, consacre un certain soin au Club des Veufs Noirs ? Certes pas. Déterminé à 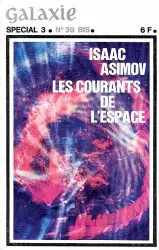 aborder tous les genres littéraires, depuis les gloses sur les récits bibliques jusqu’aux hommages à Gilbert et Sullivan, Asimov n’allait pas négliger le récit policier. Les éditeurs voyaient d’ailleurs intérêt, eux aussi, à ce qu’Asimov multiplie les textes dans ce secteur : leurs revues en étaient friandes et Asimov était si prolifique qu’il pouvait en alimenter une demi-douzaine de front. Très tôt, Asimov montre d’ailleurs son attrait pour le genre. Par exemple, Les courants de l’espace (Librairie des Champs-Élysées, 1974 [1952]) :
aborder tous les genres littéraires, depuis les gloses sur les récits bibliques jusqu’aux hommages à Gilbert et Sullivan, Asimov n’allait pas négliger le récit policier. Les éditeurs voyaient d’ailleurs intérêt, eux aussi, à ce qu’Asimov multiplie les textes dans ce secteur : leurs revues en étaient friandes et Asimov était si prolifique qu’il pouvait en alimenter une demi-douzaine de front. Très tôt, Asimov montre d’ailleurs son attrait pour le genre. Par exemple, Les courants de l’espace (Librairie des Champs-Élysées, 1974 [1952]) :
« Balle ouvrit les yeux et murmura :
– C’est un roman policier que vous êtes en train de nous raconter.
– Oui, répondit Fife avec satisfaction. Un roman policier. Et pour l’instant, c’est moi le détective ».
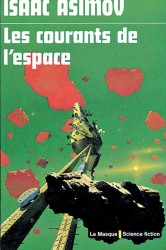 Exemples de plus parmi d’autres, deux enquêtes menées par Lije Baley découlent d’une commande du commissaire principal de police de New York, même si toutes deux forcent le héros à vagabonder dans la galaxie : Les cavernes d’acier (J’ai lu, 1956 [1953]) et Face aux feux du soleil (J’ai lu, 1970 [1956]).
Exemples de plus parmi d’autres, deux enquêtes menées par Lije Baley découlent d’une commande du commissaire principal de police de New York, même si toutes deux forcent le héros à vagabonder dans la galaxie : Les cavernes d’acier (J’ai lu, 1956 [1953]) et Face aux feux du soleil (J’ai lu, 1970 [1956]).
Est-ce à dire qu’Asimov mérite la même admiration quand il s’adonne au polar que lorsqu’il s’en tient à la science-fiction ? Tout en permettant aux inconditionnels d’honorer avec un enthousiasme étale tous les écrits d’Asimov, doutons-en. Asimov lui-même hésiterait. « Certaines nouvelles rassemblées dans les deux premiers recueils des Veufs Noirs n’ont pas été publiées dans EQMM (Ellery Queen’s Mystery Magazine), mais dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction. C’était assez difficile car je ne pouvais pas faire d’un récit des Veufs Noirs une véritable histoire de fantastique ou de science-fiction. Mais, une fois de temps en temps, puisque je suis ainsi fait, je bâtis un récit de telle sorte qu’il puisse, au moins de façon détournée, aborder le fantastique ou la science-fiction, et F & SF en hérite. » Comme quoi, de son propre aveu, le penchant naturel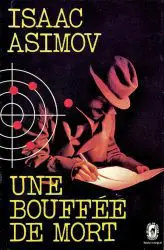 d’Asimov le porte vers la science-fiction, au point de proposer aux Veufs Noirs des énigmes hors de leur registre.
d’Asimov le porte vers la science-fiction, au point de proposer aux Veufs Noirs des énigmes hors de leur registre.
Asimov romancier l’emporte, à mes yeux, sur Asimov nouvelliste et, plus encore, sur Asimov auteur de nouvelles policières. Non que la nouvelle soit par définition inférieure au roman, mais parce qu’Asimov aborde la nouvelle et surtout la nouvelle policière avec une désinvolture qui le prive (et nous avec lui) de ses meilleures ressources. Il suffit, en effet, qu’on lui lance un défi et, au pied levé, il pondra une nouvelle incriminant sa vieille machine à écrire ou le mur d’en face. La performance lui vaudra les applaudissements, les rires, l’admiration, mais la merveilleuse aptitude d’Asimov à créer la logique et l’armature du grand récit de science-fiction demeurera alors sur la touche. Les mérites typiques de la nouvelle comme genre littéraire ne sont pas en cause, mais l’investissement que lui consent (ou lui refuse) Asimov. De grands auteurs ont marqué le monde du roman autant que celui de la nouvelle parce qu’ils n’ont jamais réduit la nouvelle (ni la nouvelle policière) au statut mineur d’un passe-temps ou d’un test. Qu’on pense à Hemingway, à Pirandello, à Tchekhov, à Pouchkine dont les innombrables nouvelles séduisent et émeuvent autant que leurs romans ou leurs pièces de théâtre parce que ces auteurs occupent leurs nouvelles avec la même intensité que leurs œuvres de longue haleine. La dame de pique n’est pas une performance offerte sans véritable émotion.
Mais Le Club des Veufs Noirs ?
« Je me sens parfois légèrement gêné, écrit Asimov, par la minceur de l’argument sur lequel repose la
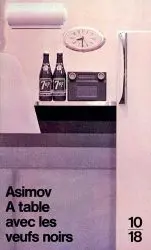 solution d’un récit des Veufs Noirs, mais c’est idiot. Ce sont, à vrai dire, des histoires à énigmes, et que l’énigme soit mince ou non n’a pas d’importance tant que l’esprit y trouve un défi suffisant. » On ne saurait mieux amorcer l’évaluation : l’esprit trouve-t-il ici un défi suffisant ? Par contre, on ne saurait mieux le limiter. Asimov le sait d’ailleurs fort bien puisqu’il enchaîne : « Pour ma part, j’éprouve un double plaisir : celui, tout d’abord, d’imaginer l’énigme, puis celui de cacher la solution derrière les éléments d’un puzzle, en essayant de ne pas être malhonnête vis-à-vis du lecteur ». Il conclut alors : « Je n’ai proposé ‘L’intégrale’ à personne, je l’ai gardée pour ce recueil ». Au lecteur de s’interroger sur le sens exact de ce traitement inattendu.
solution d’un récit des Veufs Noirs, mais c’est idiot. Ce sont, à vrai dire, des histoires à énigmes, et que l’énigme soit mince ou non n’a pas d’importance tant que l’esprit y trouve un défi suffisant. » On ne saurait mieux amorcer l’évaluation : l’esprit trouve-t-il ici un défi suffisant ? Par contre, on ne saurait mieux le limiter. Asimov le sait d’ailleurs fort bien puisqu’il enchaîne : « Pour ma part, j’éprouve un double plaisir : celui, tout d’abord, d’imaginer l’énigme, puis celui de cacher la solution derrière les éléments d’un puzzle, en essayant de ne pas être malhonnête vis-à-vis du lecteur ». Il conclut alors : « Je n’ai proposé ‘L’intégrale’ à personne, je l’ai gardée pour ce recueil ». Au lecteur de s’interroger sur le sens exact de ce traitement inattendu.
Asimov étant un fabuleux conteur, la grande majorité des énigmes proposées aux Veufs Noirs et au public
taquinent agréablement la curiosité. Et le défi est d’autant plus jouissif que le sextuor ne parvient pas mieux que le lecteur à débusquer la solution. Jusque-là, tout va bien et Asimov mérite la reconnaissance des cerveaux dûment défiés. Certaines énigmes n’échappent pourtant pas à la critique : ce sont celles où le génial Henry tire de son chapeau un lapin qu’aucun couvre-chef n’aurait pu loger. Henry, modeste, blindé contre les humeurs des six convives, attentif à ne jamais dérober le tonnerre de ceux qui le traitent en membre honoraire du Club, en fait un peu trop. Tout au plus consent-il, à l’occasion, à consulter une encyclopédie pour « se rappeler » les minuscules détails d’une élection présidentielle du siècle dernier. Il est habile quand il esquive les compliments des membres en les remerciant d’avoir « déblayé le terrain » en éliminant les solutions insatisfaisantes, mais il reprend dès l’occasion suivante son rôle de deus ex machina. Ni Hercule Poirot ni le Père Brown ne trichaient.
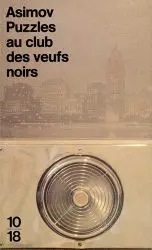
1. Isaac Asimov, Les Veufs Noirs, trad. de l’américain par Michèle Valencia, Omnibus, Paris, 2010, 1104 p. ; 46,95 $.
EXTRAITS
– Est-ce que cela veut dire qu’il faut rédiger un plan, monsieur Rubin ? demanda-t-il avec un léger tremblement dans la voix.
– Non, répondit catégoriquement Rubin. Vous pouvez, si vous en avez envie, mais moi, je ne le fais jamais. Vous n’avez pas besoin de connaître la route exacte que vous allez emprunter.
p. 603
Dans chacun de mes recueils consacrés aux Veufs Noirs, j’ai réussi à inclure des récits qui n’avaient pas été publiés ailleurs. Je considère que c’est une petite gratification pour ceux qui ont la générosité d’acheter ces livres.
p. 952
« Non, vous n’êtes pas capable [d’enseigner ce que vous faites], parce que vous ne pouvez pas décrire le phénomène d’intuition qui entre en jeu, dit Gonzalo. Avoir une bonne dose d’intuition, c’est avoir du talent, c’est avoir du génie, et l’intuition, ça ne s’enseigne pas. »
p. 464
Trumbull dit d’un air sarcastique :
– On n’a pas besoin d’être docteur ès lettres pour lire de la poésie.
Avalon dit d’un air lugubre :
– Il faut être idiot pour lire de la poésie moderne.
– C’est un fait, dit Rubin.
p. 690