La collection « Cahiers Gabrielle Roy » est publiée par les éditions du Boréal depuis maintenant quinze ans et son objectif est de « rassemble[r] des ouvrages consacrés à [l’écrivaine], textes inédits, études, commentaires critiques et autres documents susceptibles de mieux faire connaître et comprendre l’œuvre, l’art et la pensée de la romancière ». Retour sur deux volumes de cette précieuse collection : Heureux les nomades et autres reportages 1940-19451 et Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy 1947-19792.
La présentation et l’annotation des deux publications s’éclairent mutuellement par plusieurs aspects, tout comme celles des huit « Cahiers » antérieurs du reste, et les ensembles respectifs ajoutent des jalons essentiels à la connaissance de la vie et de l’œuvre de la célèbre auteure manitobaine (1909-1983), devenue québécoise d’adoption en 1939.
Heureux les nomades et autres reportages
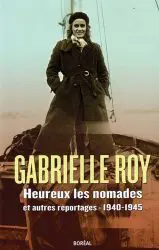 On sait qu’après un premier séjour européen de dix-huit mois Gabrielle Roy est revenue s’installer, non pas dans sa province natale où l’attendait un poste d’institutrice, mais au Québec, à Montréal, « dans la métropole » canadienne : « Je voulais à tout prix demeurer dans le grand centre culturel du pays », précisa-t-elle à Rex Desmarchais en mai 1947. Gabrielle Roy était à ce moment tout orientée vers la « vocation » que la parution de trois textes dans l’important périodique français Je suis partout, en 1938 et 1939, lui avait révélée : « [J]’avais réussi à publier des articles dans un journal de Paris ! Cette publication me fit prendre conscience, je crois bien, de ma vocation d’écrivain […] [C]’était là un puissant encouragement, un merveilleux stimulant ! L’accueil de l’hebdomadaire parisien me donna en moi-même la confiance qu’il me fallait pour continuer d’écrire ». Quelques semaines plus tôt, Dorothy Duncan avait ainsi résumé et commenté cette aventure parisienne : « Ces succès déterminèrent le cours de sa vie. L’écriture lui donnait une satisfaction qu’aucune de ses occupations antérieures ne lui avait fournie jusqu’alors » ; il s’agit ici des articles et des nouvelles que Gabrielle Roy avait déjà fait paraître dans les périodiques The Free Press (de Winnipeg), The Toronto Star Weekly, Le Samedi (de Montréal) et La Liberté et le Patriote (de Saint-Boniface)3.
On sait qu’après un premier séjour européen de dix-huit mois Gabrielle Roy est revenue s’installer, non pas dans sa province natale où l’attendait un poste d’institutrice, mais au Québec, à Montréal, « dans la métropole » canadienne : « Je voulais à tout prix demeurer dans le grand centre culturel du pays », précisa-t-elle à Rex Desmarchais en mai 1947. Gabrielle Roy était à ce moment tout orientée vers la « vocation » que la parution de trois textes dans l’important périodique français Je suis partout, en 1938 et 1939, lui avait révélée : « [J]’avais réussi à publier des articles dans un journal de Paris ! Cette publication me fit prendre conscience, je crois bien, de ma vocation d’écrivain […] [C]’était là un puissant encouragement, un merveilleux stimulant ! L’accueil de l’hebdomadaire parisien me donna en moi-même la confiance qu’il me fallait pour continuer d’écrire ». Quelques semaines plus tôt, Dorothy Duncan avait ainsi résumé et commenté cette aventure parisienne : « Ces succès déterminèrent le cours de sa vie. L’écriture lui donnait une satisfaction qu’aucune de ses occupations antérieures ne lui avait fournie jusqu’alors » ; il s’agit ici des articles et des nouvelles que Gabrielle Roy avait déjà fait paraître dans les périodiques The Free Press (de Winnipeg), The Toronto Star Weekly, Le Samedi (de Montréal) et La Liberté et le Patriote (de Saint-Boniface)3.
Peu après son arrivée à Montréal, au printemps 1939, survint un autre événement déterminant dans la poursuite de la carrière littéraire de Gabrielle Roy, soit sa collaboration de plus de cinq ans au Bulletin des agriculteurs dont René Soulard était à ce moment le rédacteur en chef. L’auteure avait bien aussi publié des articles, billets et nouvelles dans des revues et journaux montréalais (La Revue moderne, La Revue populaire, Paysana, Le Jour), mais sa contribution au Bulletin prit une importance tout à fait particulière : « [V]ers la fin de 1940 […] je signai à ce magazine un contrat qui lui assurait l’exclusivité de mes reportages, de mes contes et de mes nouvelles ». Du printemps 1940 à l’hiver 1945, Gabrielle Roy fournit ainsi au périodique montréalais quarante reportages, auxquels s’ajoutèrent également neuf nouvelles. Durant la même période quelques autres reportages parurent aussi ailleurs : six dans le quotidien Le Canada et un dans La Revue moderne. Heureux les nomades regroupe aujourd’hui 28 de ces 47 reportages et les présentateurs en soulignent d’entrée de jeu l’importance : « Plus qu’un simple gagne-pain, la collaboration au Bulletin peut être envisagée comme le point de départ du parcours littéraire de Gabrielle Roy, c’est-à-dire à la fois comme un apprentissage décisif et comme une ‘première consécration […] qui l’oriente définitivement vers l’écriture’4 ». Ces 28 reportages, continuent les mêmes, ont été « choisis pour leurs qualités littéraires, pour leur intérêt historique et documentaire et pour l’éclairage qu’ils jettent sur l’art et la pensée de Gabrielle Roy au moment où elle préparait Bonheur d’occasion ».
La lecture d’Heureux les nomades confirme la justesse de ces propos et permet de subodorer la spécificité scripturale de la future romancière. « Tout Montréal », la première des cinq séries sous lesquelles les reportages ont été réunis, révèle dès le début les dons d’observation d’une auteure attentive aux moindres détails. Les quatre textes qui composent cette section sont particulièrement évocateurs et colorés, et teintés de surcroît d’un humour discret de bon ton, notamment dans les nombreuses énumérations dont ils sont émaillés. « Selon la mode américaine, on trouve dans ces pharmacies [de la rue Sainte-Catherine], et rien qu’en faisant le tour d’un comptoir, ce qu’on ne dénicherait pas en une journée dans un magasin bien organisé. » Suit alors un inventaire de produits hétéroclites autant qu’hétérogènes, allant des « boules contre les mites » aux « horloges à coucou » en passant par le « papier à lettre », des « bouillottes », de la « cire à plancher » et des « tablettes de chocolat », « et même certaines choses que l’on peut en droit s’attendre à découvrir dans une pharmacie […]. Mais il faut être doué d’une assez bonne vue pour les reconnaître ».
Plus accrocheur encore est l’anthropomorphisme généralisé qui remplace fort avantageusement les habituelles descriptions linéaires et statiques. Voici le boulevard Saint-Laurent, « méridien » qui tranche Montréal « en deux sections, est et ouest », et qui « [part] des bas quartiers » pour « monte[r] jusqu’aux abords de la montagne » ; il « regarde les signes de conquête qu’on a dressés aux deux pôles de la ville » ; « [â]me vagabonde, il connaît la senteur du blé, du cambouis, du poisson […]. Il connaît le roulement de lourds camions […]. Il connaît les cotonnades fleuries, les calicots, le tabac canadien […]. Il voit des visages turcs, grecs, annamites […]. C’est encore à lui, grand voyageur, qu’il faut se confier pour aller à la découverte de la ville ».
Voyons encore, rue Saint-Denis, la « forêt d’escaliers » : « Quelques-uns tout droits ne perdent pas de temps à monter au deuxième étage. D’autres prennent des détours, s’arrondissent au centre. Des jumelles siamoises partent dos à dos et se séparent plus tard pour aller chacune à leur maison ». La rue Sainte-Catherine est décrite pour sa part sous un angle métaphorique assimilable à l’animal, en l’occurrence le cheval : après avoir « gravi la côte Bleury à grands coups de collier […] elle se repose un peu, puis se plonge en plein tourbillon […]. Elle s’en va fringante vers ce qu’il y a de plus riche, de plus excessif à Montréal […]. Éperonnée, harcelée par tous les bruits de la piste, elle passe le square Phillips, Edward VII, Morgan […]. La voici qui remorque deux rangs pressés d’automobiles et deux longues files de tramways […]. Elle étouffe. Elle devient haletante, tire son fardeau comme un bouleux épuisé, s’arrête pour souffler aux signaux rouges ou sous l’ordre d’un agent de circulation, provoque des embouteillages, se libère, hennit de mille klaxons ».
Montréal défile ainsi avec ses banques, ses monuments, ses commerces, ses usines, son histoire, dans sa « dualité » et ses contrastes, dans la cohue de ses rues ou le charme de ses parcs, chez les « millionnaires » de Westmount ou le « peuple d’ouvriers et d’ouvrières qui s’épuisent » dans le faubourg Saint-Henri. Les présentateurs affirment avec raison que « [l]es quatre textes composant ‘Tout Montréal’ comptent parmi les reportages de Gabrielle Roy les plus achevés d’un point de vue stylistique ».
La section couvrant la « Gaspésie et [la] Côte-Nord » offre elle aussi de puissants attraits littéraires, auxquels se greffent les préoccupations sociales dont Gabrielle Roy témoignera dans toute son œuvre. Cette série comprend le tout premier reportage de Gabrielle Roy, paru dans le Bulletin des agriculteurs de novembre 1940 : « La belle aventure de la Gaspésie ». On y découvre une péninsule à « deux visages : celui de la tradition et celui du progrès », avec ses attraits singuliers : sa « route sinueuse et magnifique », les usages anciens qu’elle a conservés, ses noms de lieu « chantants et colorés » et son pittoresque environnement de montagnes, de brise-lames, d’étals de morue, de grillage des séchoirs, de cabanes de pêcheurs. La « vive imagination » de son peuple, précise la reporter, toujours attentive aux humains, « s’apparente à celle des naïfs Bretons et des incorrigibles rêveurs de Cornouailles ». Le reportage s’attarde notamment aux deux institutions qui apportent au village de Rivière-au-Renard « une certaine mesure de prospérité » : la coopérative des « Pêcheurs-Unis de la Gaspésie » et l’usine des « Produits Marins Gaspésiens ». Les deux autres textes de cette section sont dévolus à la Côte-Nord, à ses villes, à ses richesses, à son climat et à ses habitants, qui sont de type « tenace, silencieux, endurant » et débrouillard. Le reportage éponyme « Heureux les nomades » s’intéresse tout spécialement aux Montagnais et à leurs mœurs singulières : les présentateurs le considèrent à bon droit « d’une certaine manière comme un essai d’anthropologie ».
La série « Ici l’Abitibi » regroupe pour sa part sept textes qui s’attardent au moins autant aux lieux visités qu’aux gens qui les habitent : Gabrielle Roy y trace le portrait de communautés humaines en général et d’individus en particulier, tels le dévoué chef de district Simard, le curé Arseneault, « Mlle Estelle », l’institutrice, le vieux pêcheur russe Steve. Par la technique du dialogue, la journaliste fait découvrir à plusieurs reprises l’accent breton des uns et le parler « délicieusement archaïque » des autres. Au terme de son reportage, elle se permet de dénoncer les défauts des colons et de leur servir une ferme admonestation.
Curieusement, les six reportages de « Regards sur l’Ouest », dont certains sont très courts, ne sont pas aussi achevés que les autres. Les préoccupations humaines s’affichent encore, mais dans des récits plutôt ternes, voire un peu décousus, comme dans « Les gens de chez nous ».
La cinquième et dernière section, « Horizons du Québec », réunit plusieurs portraits de régions (le Saguenay, l’Île-aux-Coudres, les Cantons-de-l’Est…) et des individus en particulier sont à nouveau mis en évidence : le maraîcher Coya au marché Bonsecours, à Montréal, le pionnier Médéric Sainte-Marie, de Moe’s River, le « maître-flotteur » Télesphore Juteau sur la rivière L’Assomption, les bûcherons Aurèle et Thobus à l’œuvre dans la forêt laurentienne de Saint-Donat, le père Athanase, forgeron-menuisier de Petite-Rivière-Saint-François… L’un des meilleurs reportages d’Heureux les nomades porte du reste le nom de cette agglomération charlevoisienne où la romancière choisira de se ménager une résidence d’été, en 1957 : c’est en termes d’une grande sympathie que la journaliste évoque ce « [s]ingulier petit village, cachottier et cependant affable, tout refermé sur lui-même comme un de ces ruisseaux secrets qui coulent vers leur destin sans bruit, sans plus qu’un glissement imperceptible – et pourtant limpide ! »
Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy
 Ce que les textes d’Heureux les nomades révèlent de la manière de Gabrielle Roy s’accorde bien, par ailleurs, aux réflexions que l’auteure a livrées au cours des rares entrevues qu’elle a accordées durant sa vie. Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy regroupe seize des quelque quarante interviews consenties sur une période de 32 ans (de 1947 à 1979) : les textes ont été retenus, disent les présentateurs, « à la fois pour leur ‘représentativité’, pour la richesse de leur contenu, pour l’accent de sincérité et de sympathie qui s’en dégage » ; « la qualité ultime » de ces entretiens « est sans doute de donner la parole à Gabrielle Roy » et de faire entendre, « malgré l’aspect morcelé et pluriel de l’ensemble, […] sa voix à elle, une voix unique qui nous dit qui elle a été et nous la rend ainsi proche à nouveau ».
Ce que les textes d’Heureux les nomades révèlent de la manière de Gabrielle Roy s’accorde bien, par ailleurs, aux réflexions que l’auteure a livrées au cours des rares entrevues qu’elle a accordées durant sa vie. Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy regroupe seize des quelque quarante interviews consenties sur une période de 32 ans (de 1947 à 1979) : les textes ont été retenus, disent les présentateurs, « à la fois pour leur ‘représentativité’, pour la richesse de leur contenu, pour l’accent de sincérité et de sympathie qui s’en dégage » ; « la qualité ultime » de ces entretiens « est sans doute de donner la parole à Gabrielle Roy » et de faire entendre, « malgré l’aspect morcelé et pluriel de l’ensemble, […] sa voix à elle, une voix unique qui nous dit qui elle a été et nous la rend ainsi proche à nouveau ».
Ces entrevues ont été réalisées dans des lieux différents et de diverses manières : à la télévision (Judith Jasmin), au téléphone (Lily Tasso), par la poste (Gilles Dorion et Maurice Émond), dans le confort du salon de l’appartement du Château Saint-Louis de la Grande-Allée à Québec (Ringuet, Alice Parizeau, Donald Cameron), à l’hôtel Rawdon Inn, dans les Laurentides (Rex Desmarchais), aux éditions Flammarion, rue Racine à Paris (Paul Guth), à Petite-Rivière-Saint-François (Céline Légaré, Jacques Godbout)… Beaucoup, inévitablement, se recoupent sur bien des points. Ainsi, la plupart des interviewers décrivent le physique (agréable) de Gabrielle Roy et font état de ses origines manitobaines, de sa famille, de ses études, de son expérience théâtrale avec le Cercle Molière, de son passé d’institutrice, de son premier séjour européen, de l’énorme succès de son premier roman…

Se dégagent de l’ensemble des propos de la romancière ses précisions sur la genèse de ses récits, en particulier de son premier roman, et sur sa méthode de travail. Ses notations permettent par exemple de reconstituer l’histoire de Bonheur d’occasion. L’œuvre est le fruit d’observations recueillies dans Saint-Henri lors de promenades visant à échapper à l’ennui, à la solitude et à la pauvreté. « En quête de chaleur humaine », l’auteure découvre alors avec stupéfaction l’« humanité misérable » de ce quartier de Montréal : « ce fut une révélation, une illumination ! » « L’indignation fut le moteur de Bonheur d’occasion » et « j’eus un désir ardent de l’exprimer à travers des personnages ». Ce qui devait être au départ une nouvelle se mua en un fort roman auquel l’écrivaine travailla pendant trois ans, à Montréal dans sa chambre de la rue Dorchester, lors d’un séjour en Gaspésie également, et dans une pension du village de Rawdon, dans les Laurentides. Sans notes ni plan rigide, Gabrielle Roy tapa d’abord à la machine à écrire, entre 9 et 13 heures, en trois ou quatre mois, en deux ou trois étapes, un premier jet de 800 pages, sans s’arrêter pour réviser, à raison de six à huit pages par jour. Vinrent ensuite une deuxième, puis une troisième version, le « processus de réécriture » progressant « chapitre par chapitre », afin d’« ordonner, organiser, agencer, polir » l’ensemble. Certains chapitres ont été repris « jusqu’à six ou sept fois – et en entier ». Du premier texte, une centaine de pages ont ainsi été biffées, dont un chapitre complet « d’une vingtaine de feuillets dactylographiés [qui] a dû disparaître, […] parce qu’il ralentissait la marche du récit ».
En retraçant le processus de rédaction de Bonheur d’occasion, dans sa biographie de la romancière, François Ricard a tenu compte de ces interviews. Mais on constate rapidement que l’essayiste les a passées au crible d’un questionnement judicieux, corroborant tantôt la réalité des faits rapportés, concluant tantôt à de simples conjectures. Dans Rencontres et entretiens […], par exemple, Gabrielle Roy dit à Dorothy Duncan et à Rex Desmarchais, en 1947, avoir écrit Bonheur d’occasion à raison de quatre heures quotidiennement (de 9 à 13 h). Vingt-quatre ans plus tard, en présence de Donald Cameron, elle parle plutôt de « huit ou dix heures par jour ».
Rencontres et entretiens […] contient aussi plusieurs réflexions de Gabrielle Roy sur les personnages de son œuvre. Le discours se révèle ici à la fois convergent et crédible. Chacun de ses personnages, « à tour de rôle », lui « a tenu à cœur profondément ». Ceux de Bonheur d’occasion sont « le produit de plusieurs personnes que j’ai observées dans la réalité » ; ce sont des personnages de « composition », comme ceux de La petite poule d’eau, qui « n’existaient pas » et qu’elle a « créés ». « Tout ce que je sais », dit Gabrielle Roy pour l’ensemble de son œuvre, « c’est que je reste un peu en arrière et que j’essaie de suivre mes personnages ».
* Gabrielle Roy à Sept-Îles, source : Album Gabrielle Roy, Boréal, 2014.
1. Gabrielle Roy, Heureux les nomades et autres reportages 1940-1945, édition préparée par Antoine Boisclair et François Ricard avec la collaboration de Jane Everett et Sophie Marcotte, « Cahiers Gabrielle Roy », Boréal, Montréal, 2007, 440 p. ; 27,50 $.
2. Gabrielle Roy, Rencontres et entretiens avec Gabrielle Roy 1947-1979, édition préparée par Nadine Bismuth, Amélie Desruisseaux-Talbot et François Ricard avec la collaboration de Jane Everett et Sophie Marcotte, « Cahiers Gabrielle Roy », Boréal, Montréal, 2005, 269 p. ; 25,95 $.
3. On pourra consulter là-dessus la bibliographie exhaustive mise au point par François Ricard dans la magistrale biographie de Gabrielle Roy qu’il a signée en 1996 sous le titre Gabrielle Roy, Une vie (Boréal, p. 592-605). Cette biographie a été rééditée en 2000 dans la collection « Boréal compact ».
4. Les présentateurs citent un extrait de Gabrielle Roy, Une vie de François Ricard (p. 212). Les deux « Cahiers Gabrielle Roy » ici recensés font du reste constamment référence à cet essai incontournable.
EXTRAITS
L’hiver, dans les bois, l’été, à la mer, les nomades ont une loi qui les apparente aux oiseaux migrateurs.
Le soleil, en juin, se rappelle leur pays désolé. Du golfe Saint-Laurent à la baie d’Ungava passe un souffle clément. Une herbe malingre frissonne au ras du sol. À l’ombre de quelques bouleaux esseulés éclosent les iris sauvages, pâles et fragiles comme du rêve. Et, dans les tentes raidies contre le vent du nord, s’éveille la joie du départ. Chez les Montagnais et Naskapis soudain, branle-bas !
Heureux les nomades, p. 137.
Le flottage ramasse les êtres les plus disparates, les plus variés ; il en prend de tous les âges, de toutes les espèces. Le flottage constitue véritablement la légion étrangère du pays. On y vient par attrait, par désespoir… ou par habitude. On y vient quelquefois parce que c’est la dernière ressource de vies brûlées. Et on y vient parce que la chanson de la rivière, à travers toute une existence, coulait comme un appel irrésistible. Le secret ou le drame de tous ces êtres que je vois fondus en une grande masse bariolée sur le sombre coteau, la munificence ou la pauvreté de toutes ces vies réside dans le motif qui les y a poussés.
Heureux les nomades, p. 430.
Des bruits qui entrent profondément dans les oreilles, des odeurs qui imprègnent les narines, le spectacle d’une humanité misérable qui fuit ses taudis, qui erre et qui flâne, qui ne cherche même plus d’occupation et un travail impossible à trouver. Des vieux, des jeunes, des femmes, des jeunes filles, des enfants dont les visages et les vêtements crient à la détresse. Au-dessus de cette humanité qui a perdu la joie de vivre et même l’espoir de jours meilleurs, les innombrables usines du voisinage, les trains qui circulent près de la petite gare de Saint-Henri, les bateaux qui passent dans le canal de Lachine répandent un voile de fumée épaisse et de suie.
Rencontres et entretiens, p. 58.
On a le trac… C’est affreux ! Puis commence le véritable travail : ordonner, organiser, agencer, polir. On se coupe du reste du monde, on est comme un forçat dans un cachot. Il n’y a pas de recette pour écrire un livre. Chaque sujet déclenche son processus propre ; c’est une émotion authentique qui est nécessaire, non la technique ou les techniques. Quand on ressent fortement, la forme se renouvelle d’elle-même ; chaque roman est une aventure inconnue qui n’offre aucune certitude. Je me suis donné comme règle de ne pas tricher, d’aller au fond des choses, d’essayer d’être un témoin intègre de ce que je voyais et ressentais. J’ai cherché à être juste pour tous, même si le cœur penchait parfois d’un seul côté… Et alors qu’autrefois je cueillais à même ce que je voyais pour le donner aussitôt, je puise maintenant davantage à l’intérieur de moi-même.
Rencontres et entretiens, p. 180-181.









