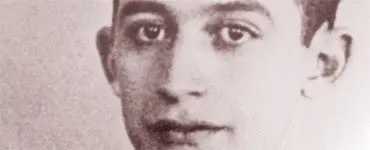Dans son livre Xavier Villaurrutia en persona y en obra, Octavio Paz affirme que la poésie de Xavier Villaurrutia ne peut être définie ni par l’unité de l’essence ni par la substance plurielle, mais plutôt par la dualité.
Pour Paz, on n’observe pas dans les poèmes de Villaurrutia de transmutation, mais une circulation entre opposés, comme entre des états frontaliers. Le concept d’entre-deux, comme chez Giorgio de Chirico, nous dit le poète, est celui qui définit le mieux la tentative villaurrutienne : « […] cette zone vertigineuse et provisoire qui s’ouvre entre deux réalités, cet entre–deux qui constitue le pont suspendu sur le vide du langage, au bord du précipice, sur la rive sablonneuse et stérile ». Ainsi, pour Paz, Villaurrutia ne fusionne ni n’unifie les opposés, il pose plutôt son monde, comme le créateur de Hebdomeros, dans la tempête, révélatrice de dualités, où apparaît non pas l’essence mais la contradiction. D’où la mélancolie et l’agonie qui, comme un état intermédiaire, baignent les textes de Villaurrutia. Le doute, le très long instant entre la création d’un monde et sa destruction. La poésie de Villaurrutia, nous dit également Paz, s’érige sur la pause, sur le pli ; cette doublure qui en s’ouvrant révèle non pas l’unité mais la dualité. Le pli s’ouvre sur lui-même et ce faisant s’immole. Le pli unifie les contraires mais ne les fusionne pas. Ainsi, conclut Paz, la figure géométrique du pli représente l’entre-deux du langage.
Du vide vers la lumière
Héritier du romantisme, Xavier Villaurrutia réussit dans sa poésie à relier intimement la philosophie et l’histoire, et à la fois à dessiner la formule géométrique au sein de laquelle se retrouvent les menus détails de l’individu et la forme vivante, impénétrable. Mais ses liens avec le baroque sont encore plus forts, inspiré qu’il fut en particulier par Quevedo et Sor Juana1.
La lecture de Villaurrutia mène à la lumière, bien que son vocabulaire regorge de vide, de silence, de solitude, d’insomnie, de stérilité, de mort. Si Villaurrutia transcende le surréalisme, ce n’est pas parce qu’il est resté écartelé entre les contraires, dans l’opacité du néant. Le trait baroque est le pli qui va à l’infini, dit Gilles Deleuze, à propos de Leibniz ; et à propos de Villaurrutia, nous pourrions ajouter qu’il y a un pli de la matière qui mène à un repli de l’âme. Ainsi, cette multiplicité que saisissent les poèmes de Villaurrutia ne disparaît pas dans le vide, elle se courbe vers des sens multiples. Si à un premier niveau les mots de la suite des « nocturnes » sont fermés (« Nocturne ») : « Et il est vain d’allumer à mes côtés une lampe : / la lumière rend plus profonde la mine du silence / Et en elle je descends, immobile à moi-même2 » (« Y es inútil que encienda a mi lado una lámpara : / la luz hace más honda la mina del silencio / y por ella desciendo, inmóvil de mí mismo »), la matière verbale et sa musicalité se diversifient en plis comme un être organique qui finit par être lumineux, plein de résonance. Même la statue tant nommée, si fantomatique du « Nocturne de la statue » produit chez le lecteur des formes spongieuses : « La tirer du sang de son ombre / l’habiller en un clin d’œil / la caresser comme une sœur imprévue / et jouer avec les jetons de ses doigts » (« Sacarla de la sangre de su sombra, / Vestirla en un cerrar de ojos, / Acariciarla como a una hermana imprevista / Y jugar con las fichas de sus dedos ») ou des formes caverneuses : « Rêver, rêver la nuit, la rue, l’escalier / Et le cri de la statue dédoublant le coin. / Courir vers la statue et ne rencontrer que le cri, / vouloir toucher le cri et ne toucher que l’écho, / vouloir saisir l’écho et ne rencontrer que le mur / Et courir vers le mur et toucher le miroir3 » (« Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera / y el grito de la estatua desdoblando la esquina. / Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito, / querer tocar el grito y sólo hallar el eco, / Querer asir el eco y encontrar sólo el muro / y correr hacia el muro y tocar un espejo »). La forme de ces poèmes possède une force interne capable d’exister grâce à de nouvelles turbulences, lesquelles poussent la matière verbale à déborder l’espace du poème et à se réconcilier avec la fluidité de sa thématique.
Au-delà du lieu commun
Xavier Villaurrutia, comme Chirico, n’étale ni n’oppose aucun élément discordant ; plutôt il isole chaque figure pour ne pas tomber dans la représentation rhétorique, pour briser la narration que chaque objet porte en lui et que nous appelons souvent lieu commun : « [O]u quand d’une bouche qui n’existe pas / surgit un cri inédit / qui nous jette au visage sa lumière vive / et s’éteint et nous laisse une surdité aveugle4 » (« [O] cuando de una boca que no existe / sale un grito inaudito / que nos echa a la cara su luz viva / y se apaga y nos deja una ciega sordera »). C’est ainsi qu’il s’approche de la sensation du fait ou de la chose en soi et, y touchant, la libère. Chez Villaurrutia, il y a une dépossession, une action qui tend à déformer les objets comme s’ils étaient soumis à des forces invisibles.
Une impression d’infini
Les structures poétiques de Xavier Villaurrutia sont compressées par la cohésion interne des mots, de telle sorte que cette compression donne au poème un mouvement circulaire, comme s’il s’agissait d’une matière poreuse : une caverne à l’intérieur d’une caverne, avec une impression d’infini, dans les termes d’Aristote, pour qui l’infini n’est pas cela au-delà de quoi il n’y a rien, mais cela au-delà de quoi il y a toujours quelque chose. C’est-à-dire l’impression de fluidité et d’unité : « C’est la rose entrouverte / de laquelle jaillit l’ombre, / la rose refermée / qui se plie et se répand / évoquée, invoquée, odorante, / c’est la rose labiale, / La rose blessure5 » (« Es la rosa entreabierta / de la que mana sombra, / la rosa entraña / que se pliega y expande / evocada, invocada, abocada, / es la rosa labial, / la rosa herida »). Dans la poésie de Villaurrutia, le pli et le repli ne sont pas antagoniques, ils font partie de la même impulsion vitale du langage, dont les particules tournent en plis, changent et changent à nouveau.
Ce changement verbal qui progresse vers un mouvement interne, il s’agit d’une matière lumineuse, créatrice de sens. Une poésie qui part de l’immobilité de ses concepts, qui joue intérieurement à se plier et à se déplier, à se contracter et à se dilater, à se comprimer et à exploser, pour finalement atteindre à la beauté au moyen de l’élasticité de ses vers. C’est sans nul doute le rythme, ce mouvement qui parvient à réunir tous les sens, qui fait que chaque image peut se sentir, se toucher, se voir, s’entendre : « Qu’est-ce que des lèvres, des regards des lèvres ? / Et ma voix n’est plus mienne / Dans l’eau qui ne mouille pas / Dans l’air de vitre / Dans le feu livide qui coupe comme le cri6 » (« ¿Qué son labios? ¿qué son miradas que son labios? / y mi voz ya no es mía / dentro del agua que no moja / dentro del aire de vidrio / dentro del fuego lívido que corta como el grito »).
Ce  pouvoir rend l’image écriture vive, espace où coexistent l’organique et l’inorganique, le tout et l’insignifiant. L’unité du rythme villaurrutien, sa puissance proviennent du chaos, de la nuit, de la force de la mort, pour déboucher sur cetentre-deux qui conduit non pas au vide, mais au mouvement de ses pôles opposés, en une projection d’infini et un rythme vital.
pouvoir rend l’image écriture vive, espace où coexistent l’organique et l’inorganique, le tout et l’insignifiant. L’unité du rythme villaurrutien, sa puissance proviennent du chaos, de la nuit, de la force de la mort, pour déboucher sur cetentre-deux qui conduit non pas au vide, mais au mouvement de ses pôles opposés, en une projection d’infini et un rythme vital.
Quetzalcoatl, le dieu du vent
1. Juana Inés de la Cruz, 1648-1695, NdT.
2. Traduction de Louis Jolicœur.
3. Xavier Villaurrutia, Nostalgie de la mort, traduit de l’espagnol par Claude Beausoleil, Écrits des Forges, 1992.
4. Traduction de Louis Jolicœur.
5. Traduction de Claude Beausoleil.
6. Traduction de Louis Jolicœur.
Silvia Eugenia Castillero, née à Mexico en 1963, est poète, essayiste et journaliste littéraire. Elle a publié un essai intitulé Entre dos silencios (1993), consacré à son expérience des ateliers de poésie, ainsi que les recueils Como si despacio la noche (1992), Nudos de Luz (1995) et Zooliloquios (1997), traduit en français par Claude Couffon sous le titre Zooliloques (Indigo, Paris, 1997). Elle dirige le magazine littéraire Luvina de Guadalajara (Mexique).