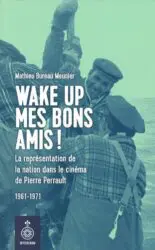Pierre Perrault, pionnier et icône du cinéma documentaire québécois, a tourné cinq longs métrages de 1961 à 1971, les plus connus étant sans doute Pour la suite du monde (1963) et L’Acadie, l’Acadie ?!? (1971). Mathieu Bureau Meunier choisit ici d’examiner cette œuvre sous l’angle du (néo-)nationalisme, mettant ainsi en évidence non seulement les convictions du militant documentariste mais aussi le mouvement de fond de toute une époque, celle où l’appellation Canadien français commençait à faire place à Québécois.
À l’heure où le XXIesiècle achève son premier quart sur fond de dénigrement de l’« identitaire », on se sent bien loin de cette époque où il y avait lieu de mettre en scène des gens ordinaires qui voient une substance évidente dans l’idée de nation canadienne-française et qui montrent du doigt « les Anglais » comme ennemis. Et pourtant. Le monde mondialisé d’aujourd’hui n’est-il pas celui que commentent déjà les pêcheurs de l’île aux Coudres lorsqu’ils dénoncent les grandes entreprises qui les dépouillent de leurs moyens de subsistance et de leur mode de vie, qu’il s’agisse de la pêche, de la construction de navires ou du transport du bois ? « Eux autres ils ont de l’argent, ils s’en fichent ! C’est les capitaux qui manquent. » Les bateaux géants, dorénavant, passent loin devant l’île aux Coudres, sans s’y arrêter, ni d’ailleurs en partir.
La fibre nationaliste de Perrault s’exprime aussi dans les images qu’il rapporte de Moncton, où il a filmé les manifestations d’étudiants réclamant le bilinguisme de la ville. Le mépris avec lequel ils sont reçus par la classe dominante anglophone préfigure pour Perrault ce qui attend les Québécois s’ils ne mettent pas le poing sur la table. Des pêcheurs de l’île aux Coudres aux Acadiens de Moncton, c’est de la fragilité des groupes opprimés qu’il est question, mais teintée d’un discours nationaliste, et c’est bien ce qui détone avec l’époque d’aujourd’hui. Pour les protagonistes de Perrault – et pour le cinéaste lui-même –, la solution s’ancre obligatoirement dans le passé, même si l’avenir reste à bâtir.
L’ouvrage de Bureau Meunier, émaillé de citations colorées tirées des films de Perrault, se lit bien. On aurait peut-être aimé en introduction une simple description des cinq œuvres étudiées avant l’analyse transversale, mais il reste que, malgré un style un peu scolaire, l’auteur nous plonge efficacement dans cette époque qui en a peut-être plus à nous apprendre qu’on ne veut bien se l’avouer.