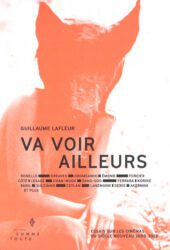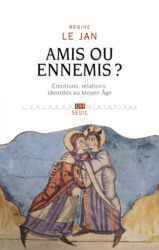Les films sortis il y a cinq, dix ou vingt ans ne méritent pas de sombrer dans l’oubli, surtout s’ils ont été produits au Québec ou en dehors des circuits des grandes salles. Au contraire, ces fictions et documentaires devraient rester accessibles. D’où ce recueil d’essais.
Pour paraphraser le titre d’un film célèbre, il faut « sauver le cinéma québécois », le diffuser, le mettre en contexte, en parler et écrire à son propos. C’est ce que fait Guillaume Lafleur, conservateur à la Cinémathèque québécoise, mais aussi critique pour plusieurs revues comme Spirale et Hors champ. On pourrait dire que Guillaume Lafleur s’est consacré au « cinéma autrement », selon la belle expression forgée par le québécophile Dominique Noguez et que j’appliquerai ici. Les regroupements des essais sont nationaux. Le recueil débute par des analyses approfondies de longs métrages québécois méconnus, dont Je me souviens (2009) d’André Forcier. Il s’intéresse ensuite aux cinéastes indépendants américains (car il y a des réalisateurs aux États-Unis qui échappent au système hollywoodien et qui restent marginalisés), mais il se penche aussi sur des œuvres sud-coréennes et beaucoup de documentaires. Plusieurs pages sont consacrées aux films venus de France, entre autres la fresque Shoah (1985), de Claude Lanzmann, qui montrait la place prépondérante des gens ordinaires dans tout le processus entourant la solution finale.
D’autres critiques avant Guillaume Lafleur – pensons à Serge Daney – ont souvent évoqué « la mort du cinéma » ; il faudrait nuancer cette hantise en parlant plutôt de films invisibles, peu présents dans les salles, introuvables à la télévision et sur DVD : des œuvres qui demeureraient hors-circuit ; un livre comme Va voir ailleurs permet de les réanimer. Il faudrait également préciser que ce sont les cinémas nationaux, et à l’intérieur de cette catégorie, l’industrie du cinéma québécois, qu’il faut faire (re)vivre au lieu de la laisser sur ce respirateur artificiel que sont les (indispensables) subventions. La véritable planche de salut de tout cinéma national sera de le diffuser et de l’étudier, de le rendre accessible autrement que par des réseaux mondialisés et surpublicisés comme Netflix.
Guillaume Lafleur écrit bien et ses textes s’apparentent à ce que l’on pourrait lire de mieux dans les meilleures revues de cinéma – pensons à Positif, à Séquences ; il fournit ses impressions mais aussi des pistes de réflexion. Le point fort de son livre est de se concentrer sur des œuvres qui n’ont pas été souvent commentées de manière approfondie et qui demeurent sans doute trop peu vues. Des films à (re)voir, qu’il nous présente avec verve, et non sans passion. Son point faible est son manque de distance critique face au sujet qu’il veut analyser, particulièrement dans le genre documentaire, et surtout pour un film engagé comme Kanehsatake, 270 ans de résistance (1993) de la cinéaste Alanis Obomsawin : à trop vouloir défendre le – très noble – point de vue autochtone, le critique y perd aussitôt de son objectivité et révèle son parti-pris, son engagement, et par conséquent son manque d’impartialité. Si la situation, les causes et les solutions sont si évidentes, pourquoi le problème a-t-il persisté si longtemps ? Faut-il rappeler que tout film, même documentaire, véhicule implicitement une idéologie ? Et que le travail de l’analyse filmique – comme de la sociologie – est précisément de mettre en évidence les idéologies qui sont à l’œuvre, en premier lieu celles des cinéastes ?