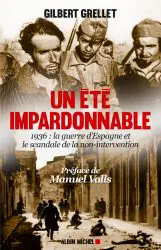On exagérerait à peine en qualifiant l’attitude de Paris face à la guerre d’Espagne de honteux triomphe de la diplomatie sur la démocratie. C’est, en effet, parce que le Quai d’Orsay, repaire et bastion de la diplomatie française, s’est opposé à tout secours au gouvernement élu de l’Espagne que Franco a pu instaurer dans la péninsule ibérique une dictature qui a sévi 40 ans durant. Que le Quai d’Orsay ait lui-même épousé les préjugés et les intérêts du Foreign Office britannique ne fait que confirmer et amplifier la culpabilité des diplomates dans une trahison que l’auteur a raison de juger impardonnable.
Même si plusieurs grandes plumes ont traité de la sanglante guerre d’Espagne – depuis André Malraux jusqu’à Michel del Castillo en passant par George Orwell et Manuel Vázquez Montalbán –, peut-être hésitait-on encore à assener ce verdict. Telle est pourtant la conclusion imparable offerte au lecteur : en s’encarcanant dans une politique de non-intervention, alors que Mussolini et Hitler fournissaient à Franco les armes de la victoire, Paris envoyait à la mort le gouvernement légitime de Madrid et pratiquait la myopie de l’atermoiement dont Berlin et Rome devaient abuser un instant plus tard. Et cette ignominie de Paris est d’autant plus scandaleuse qu’elle est perpétrée sous un régime socialiste français et alors que l’Espagne est gouvernée par un parti frère.
Comment Léon Blum, président socialiste d’une France vibrant aux trémolos de la justice sociale, a-t-il pu en arriver là ? Grellet évoque diverses hypothèses sans jamais en faire lever une qui soit à la fois crédible et respectable. Se pourrait-il que Blum, lui-même lettré de haut vol, ait été victime de l’admiration qu’il ne pouvait qu’éprouver pour le maître du Quai d’Orsay, Alexis Saint-Leger Leger, mieux connu sous son nom de plume de Saint-John Perse ? Pensable, mais insuffisant. Blum a-t-il pu penser, comme Daladier ou Chamberlain, que Hitler et Mussolini seraient hommes de parole et imiteraient la réserve de la France si celle-ci renonçait à intervenir ? Visiblement, Grellet ne croit pas Blum capable (coupable ?) de cette candeur. Se rapproche-t-on de la réalité en pensant que la France, déjà inquiète des bruits de bottes en provenance de l’Italie et de l’Allemagne, craignait que l’imbroglio espagnol l’expose à une menace supplémentaire en provenance du sud ? Peut-être.
Plusieurs sources laissent entendre, il est vrai, que la France accorda quand même une aide discrète et limitée aux républicains espagnols. Blum aurait permis à tel et tel de ses ministres qui partageaient ses vues de livrer quelques avions et des munitions grâce à un contournement du principe de non-intervention. On parla alors de non-immixtion, ce qui, paraît-il, mettait à l’aise les consciences troublées ! Réelle ou imaginée, cette contorsion n’invalide pas le jugement prononcé par l’auteur. On parvient tout au plus à soustraire Blum à l’accusation de mauvaise foi, mais c’est pour l’accuser aussitôt d’incompétence politique. Les gestes déjà posés par Hitler et Mussolini, dans l’asservissement de l’Europe ou celui de l’Abyssinie, auraient déjà dû dessiller les yeux de Blum quant à la fiabilité des promesses de l’Allemagne et de l’Italie. Partager cette crédulité avec Daladier et Chamberlain ne grandit pas Blum aux yeux de l’histoire.
Grellet ne canonise pas pour autant les républicains. Certes, les exactions massives et répugnantes commises par les légionnaires et les mercenaires de Franco lèvent le cœur, mais les républicains ne sont pas pour autant d’une blancheur virginale : ils étripèrent des milliers de clercs, se vengeant ainsi d’une Église espagnole solidement arrimée à une noblesse vorace et haineuse. Grellet insiste d’ailleurs sur l’alliance irrévocable de cette Église avec les généraux révoltés : « L’Église espagnole, incapable du moindre pardon, de la moindre charité chrétienne, a participé activement à cette incroyable épuration, ultime étape de la ‘croisade’, avant de cautionner avec enthousiasme le régime franquiste ». Sanglante surenchère.
Avec cette guerre, l’Europe entrait dans l’ambivalence. Face à deux menaces, celle de l’hitlérisme et celle du bolchévisme, elle hésita à redouter l’une plus que l’autre. Churchill, pourtant très tôt hostile à Hitler, le préférait à Moscou au moment de la guerre d’Espagne. Mauriac fustigeait le gouvernement de Madrid qu’il jugeait embrigadé dans « l’Internationale de la haine ». Mauriac ne mit que trois semaines à réviser son jugement, Churchill plus longtemps, mais d’autres, comme le Quai d’Orsay, ne le firent jamais.
Été impardonnable ? L’expression n’a rien d’inflationniste.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...